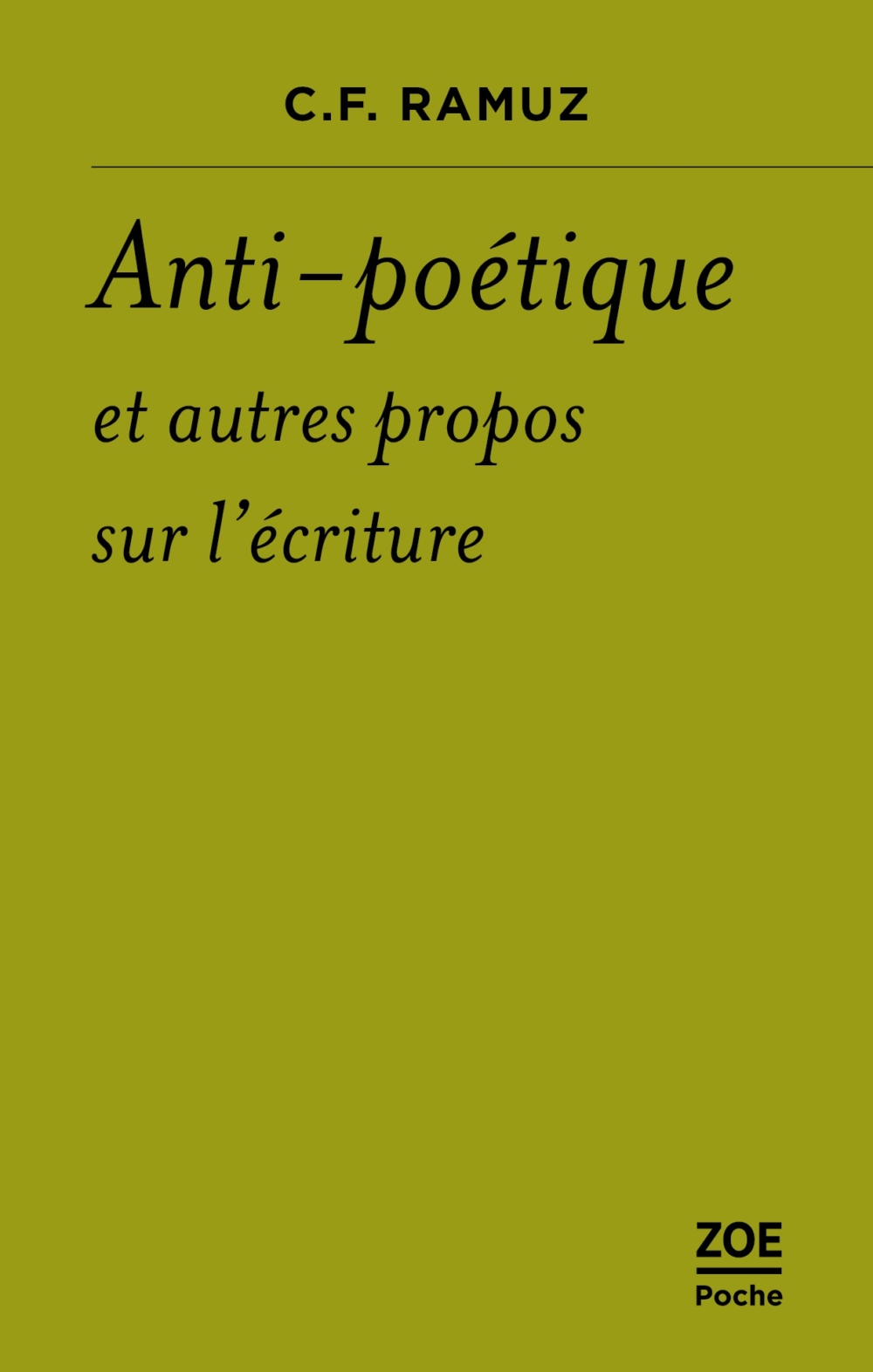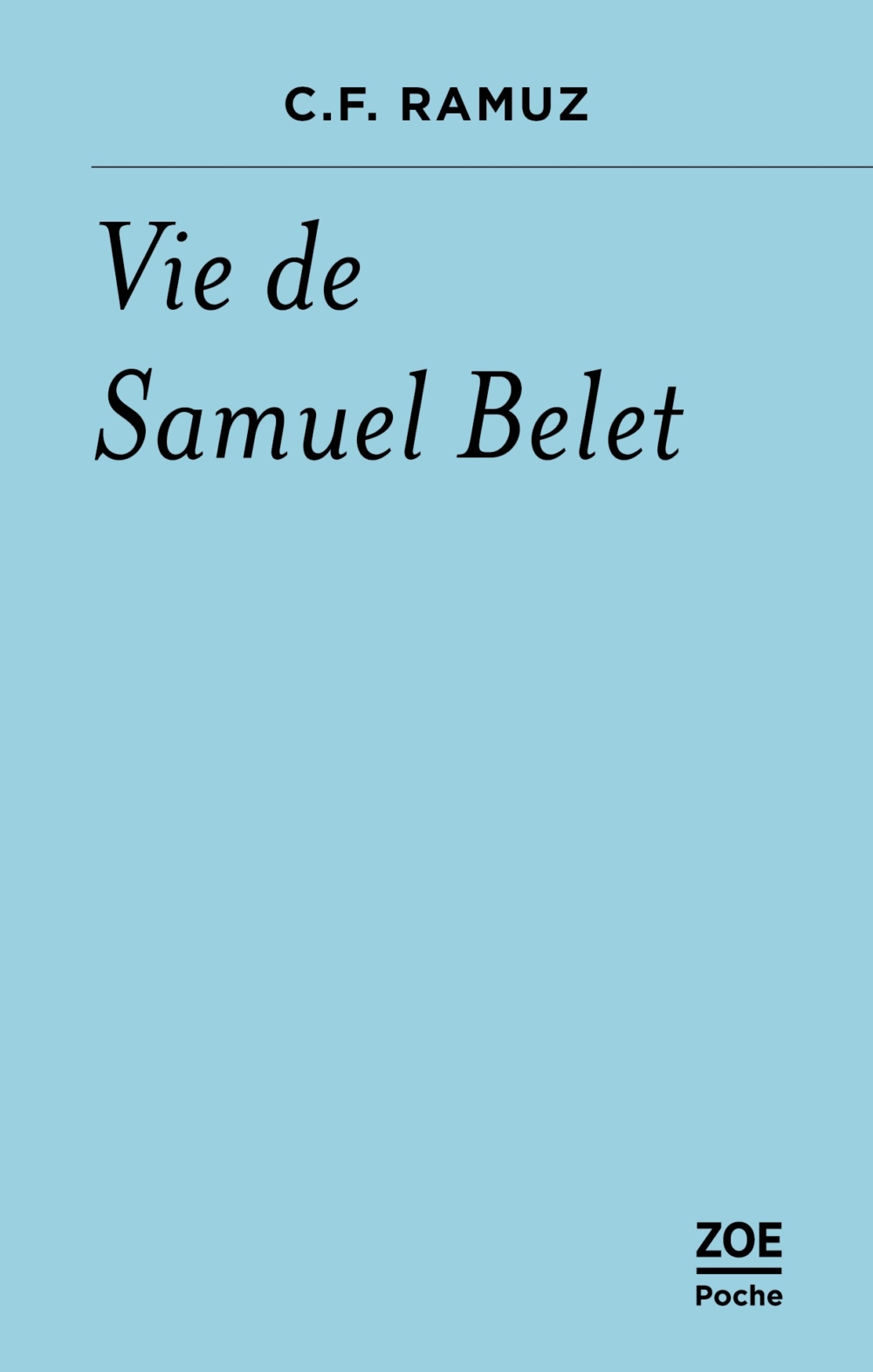I
Il fait, ce matin, un joli temps clair, bien que le soleil ne se montre pas[1]. Il a gelé fortement pendant la nuit, puis un peu de neige est tombée ; il fait gris pâle sur les toits blancs dont il y a une quantité, immédiatement derrière ma maison[2], – bordant une petite place, puis deux ruelles parallèles qui montent vers le village. Dix heures viennent de sonner. Je vais chercher des cigarettes à la boutique. Ce n’est qu’un petit bout de chemin. On traverse la place en passant devant la fontaine ; on remonte ensuite celle des deux rues qui est le plus au couchant, on arrive dans une rue transversale ; et c’est là, et ça prend deux minutes, ou trois, pas davantage. Je sors, je suis sur le perron ; et, me retournant, après avoir fermé la porte, je vois briller avec plaisir la terre toute blanche, tandis que les toits brillent un peu plus haut, après un intervalle gris ; après quoi le gris recommence, pas tout à fait le même gris. Deux bandes blanches, deux bandes grises, et c’est tout dans un grand silence. Et dans une grande immobilité où il y a seulement une cheminée qui fume, fume dans le gris son joli bleu, qui à l’abri de la pente du toit s’étire d’abord mollement, puis tout à coup, ayant dépassé le faîte, fuit de côté, de mon côté, comme beaucoup de rubans bleus.
C’est vu, ça ne prend point de temps pour être vu ; c’est pendant que je descends le perron qui n’a que quatre ou cinq marches ; et je me dis qu’il n’y a pas besoin de temps pour penser et qu’il y a pourtant besoin de temps.
Ce n’est pas tout à fait instantané quand même.
Il y a devant moi, sur une terrasse, une lessive qui sèche. Les draps, qui ont été durcis par la gelée, sont comme des pans de murs passés à la chaux ; ils se déplacent l’un devant l’autre d’un seul grand mouvement, comme dans un tremblement de terre.
Et c’est vu encore, et à peine si j’ai fait un pas sur le chemin ; et c’est à peine si ça a pris du temps, pourtant ça en a pris un peu, mais c’est un temps imperceptible.
Il y a deux temps en nous. Ce qui pense en nous et ce qui agit en nous sont deux choses qui coexistent dans une complète indépendance. Deux choses qui ont deux mesures ; deux choses qui ont chacune sa mesure. Et nous, nous sommes encore ailleurs (je me disais) : nous, c’est-à-dire ce qui a la conscience, ce qui réconcilie, ce qui introduit l’unité. Mais il arrive qu’on s’absente. Alors on est comme un homme décapité. On est un homme qui a des jambes et qui ne connaît plus ses jambes ; et il va sans savoir qu’il va, ou il pense sans savoir qu’il pense, n’étant plus à son centre, mais quelque part à ses extrémités : tantôt à l’une, tantôt à l’autre. De sorte que c’est tantôt ses actes qui sont inconscients, tantôt ses pensées qui sont inconscientes ; mais ses actes s’inscrivent du moins sur un plan déterminé. Ses actes sont vus quand ils se font, ils obéissent aux horloges ; tandis que sa pensée va et vient sur tous les plans à la fois, n’étant liée ni à un lieu, ni à un moment, étant secrète, aussi bien occupée des choses qui se voient que des choses qui ne se voient pas, étant surtout douée de ses vitesses à elle, qui sont sans rapport avec celle du corps. Je regardais le mien qui avait à peine avancé. Combien, me disais-je, faudrait-il de pages, si on voulait essayer de noter ce qu’on pense, c’est-à-dire aussi ce qu’on voit et ce qu’on sent pendant seulement trois minutes ? C’est-à-dire le temps d’aller à la boutique acheter des cigarettes, comme ce matin : ce qui se passe dans une tête, tout ce qu’elle tire de l’air, de la lumière des choses ; tout ce que d’autre part elle tire d’elle-même, tout de ce qui s’y agite en fait de souvenirs, d’images, d’inventions.
Il y a eu beaucoup de distraction dans mon cas, je dois le dire, ce matin-là.
Je n’avais fait que jeter mon manteau sur mes épaules ; je n’avais même pas remarqué que le terrain était singulièrement glissant.
Il y avait une petite couche de neige sur du verglas ; la neige était la chose qu’on voyait ; le verglas ne se voyait pas.
Le verglas, il fallait le deviner, et, par voie de déduction, distinguer ensuite en soi-même les précautions qu’il y avait à prendre : c’est justement ce que je n’avais pas fait. J’allais rapidement, selon mon corps, et très lentement selon mon esprit ; j’étais arrivé dans le haut de la rue : là il y avait une chambre à lessive[3]. Une porte basse ouvrait sur un réduit obscur plein d’une grosse vapeur, qui sortait en un large copeau plat sous le linteau à l’angle duquel il se repliait, montant ensuite contre la façade de la maison.
On pense toujours à beaucoup de choses (et pas à celles qu’il faudrait).
Il fait une jolie lumière voilée à cause d’une mince vapeur, qui est sur tout le ciel comme du verre dépoli et le soleil éclaire derrière. Tout est tranquille. On est content. Pourquoi est-ce qu’on est content ?
Je vois la boutique. J’arrive à la boutique.
J’entre. Je vois deux demoiselles, une rousse, une noire. Elles ont des blouses en toile blanche. Elles sont devant des cartes postales où on s’embrasse et d’autres où on ne s’embrasse pas, fixées les unes à un tourniquet, les autres à un autre tourniquet de tôle vernie en noir.
J’achète des cigarettes. Je paie mes cigarettes.
Je loge le paquet dans une de mes poches, à moins que je ne l’aie gardé à la main ; je salue, je sors.
Et, à ce moment-là, je me souviens, je pensais à un livre d’astronomie que je venais de lire[4].
Il y était question, entre autres choses, des deux théories qui sont en présence touchant l’âge des étoiles.
D’après la première de ces théories, elles auraient les âges les plus divers, et il serait donc impossible de leur attribuer une origine commune ; d’après la seconde, au contraire, elles auraient à peu près le même âge, la diversité de leurs états : grosseur, couleur, éclat, densité, étant la conséquence, non pas de durées inégales, mais des seules conditions mécaniques, elles-mêmes très variables, auxquelles elles sont soumises dans leur mouvement de gravitation.
L’auteur du livre prenait parti pour la seconde des deux théories. Il faisait un raisonnement. Il comparait le monde des étoiles avec nos sociétés humaines. Nous y naissons successivement. Il s’ensuit que le nombre des vieillards y est dans une proportion assez constante avec celui des adultes, celui des adultes avec celui des enfants. Si donc les étoiles, comme nous, naissaient les unes après les autres, naissaient isolément, de qui ? et où ? et comment ? (mais c’est autre chose), étant vraiment nos sœurs d’en haut, la même proportion devrait s’y retrouver.
Ce n’est justement pas le cas. Il y a beaucoup d’adultes parmi les étoiles, très peu de vieillards et très peu d’enfants.
Il semble bien que toutes les étoiles soient nées à la fois, – contrairement à notre destinée d’hommes ; non une à une, ni continuellement, mais toutes ensemble et en un seul moment ; et avant il n’y avait point d’étoiles, et après il n’y en aura plus.
Je redescends maintenant la rue. Je vois une femme qui sort de la chambre à lessive avec des bras mauves, terminés par des grosses mains toutes blanches qui ont de la peine à s’ouvrir. Je suis frappé par leur aspect et en même temps, je vois qu’elles se soulèvent comme quand on a de la peine à garder son équilibre et balancent un peu de chaque côté du tablier à rayures tout mouillé pendant que la femme traverse la rue ; puis, avant d’arriver à la maison d’en face, s’arrête prudemment, et avec mille précautions, tendant le bras, empoigne le bouton de la porte.
Je n’y prends même pas garde.
Toutes ensemble, toutes à la fois.
Celles qu’on voit à l’œil nu, celles qu’on ne voit qu’au télescope, celles qu’on ne distingue qu’à peine dans le plus puissant des télescopes ; celles qui font partie de la voie lactée, celles qui à elles seules sont une voie lactée, celles qui sont une, celles qui chacune à part soi sont des milliers et des millions : – comme quand une énorme grappe d’œufs de grenouille crève dans l’eau noire de nos ruisseaux, une nuit de printemps…
Les deux pieds me manquent à la fois ; je bascule sur moi-même. Je retombe en arrière, la tête la première, les jambes en l’air, de tout mon poids…
[1] Le manuscrit d’Une main (collection particulière, Suisse) porte une épigraphe empruntée à Goethe : « Utilise ce qui t’advient » (Entretiens avec le chancelier F. de Müller, traduction par Albert Béguin, Paris, Stock, 1930, p. 183 ; note du traducteur citant les Xénies apprivoisées de Goethe). Ramuz l’a écartée lors de la publication, mais il relève cette phrase dans un article donné à la revue Aujourd’hui le 26 mars 1931 (« Textes », pp. 6-7).
[2] La Muette, à Pully (4, chemin Davel), dans laquelle Ramuz s’est installé en mai 1930, et où il a vécu jusqu’à sa mort en 1947. Dans la suite du texte, l’écrivain en décrit de manière fidèle les alentours et, plus loin, les espaces intérieurs.
[3] Équivalent romand de « buanderie ».
[4] Les lignes qui suivent font songer (mais en partie seulement) à des propos contenus dans l’ouvrage d’Arthur Eddington La Nature du monde physique (Lausanne, Payot, 1929), en particulier aux pages 175-176. À ce sujet, voir l’introduction, p.***.