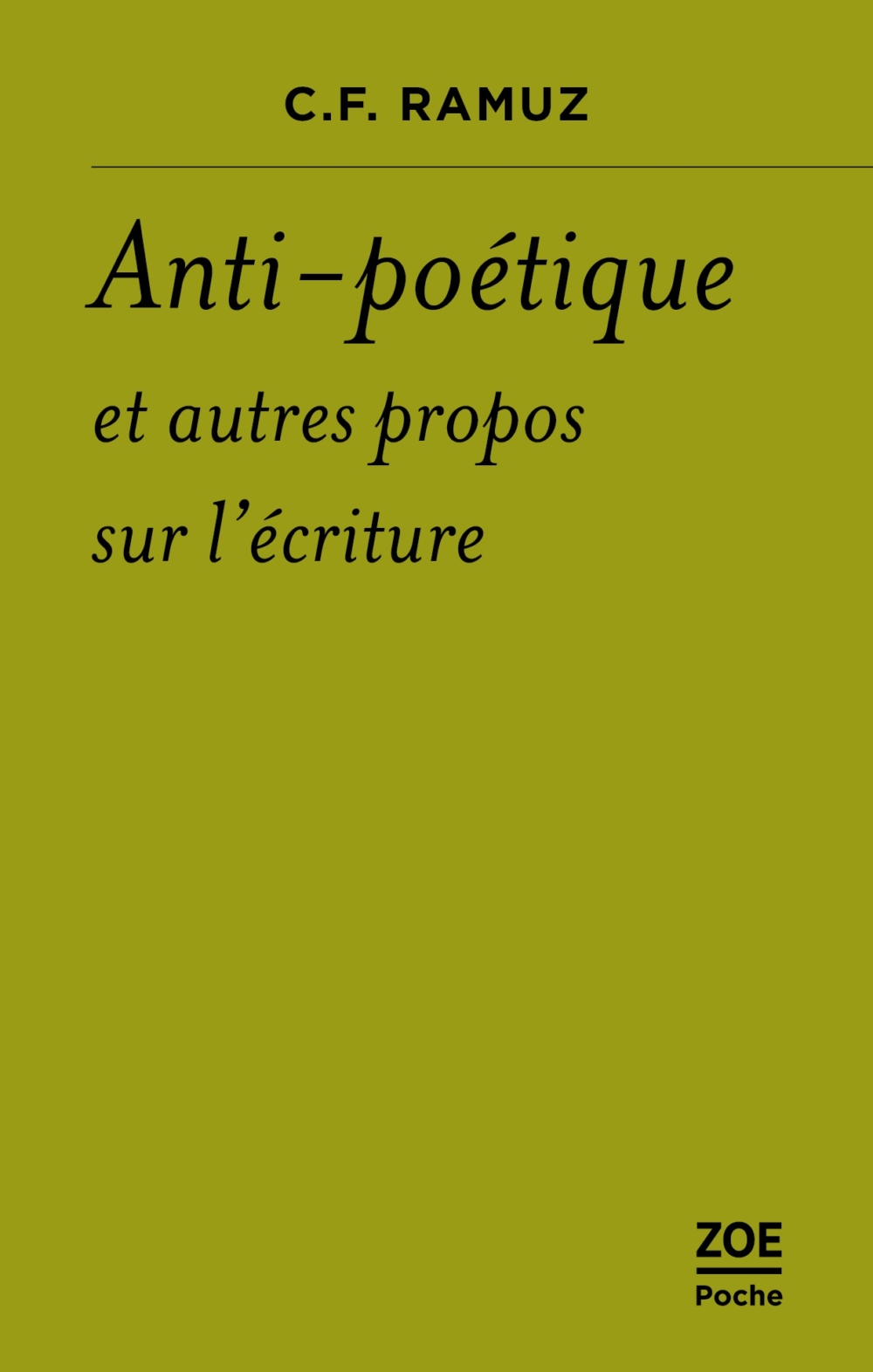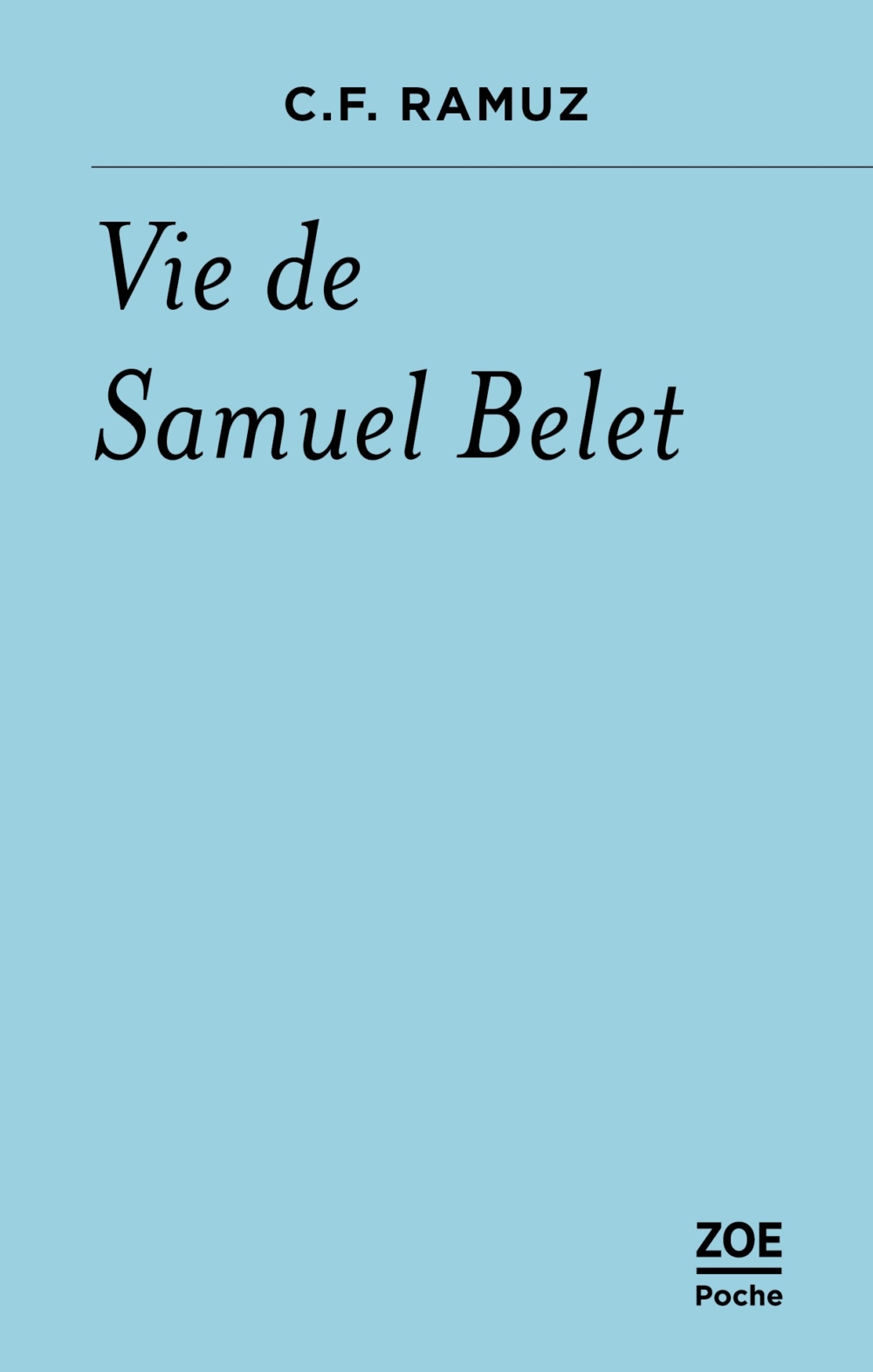Retour aux lieux aimés
Il est loin d’être arrivé qu’il voudrait déjà arrêter le train. Mais c’est une force aveugle qui agit là-bas, sourdement, dans le foyer de la locomotive ; malgré lui, il est emporté. Là le chauffeur à veste bleue se penche devant l’ouverture ronde où il enfonce sa pelle à charbon ; il a le visage tout rouge du reflet de la flamme, et quelque chose gronde et tressaille dans le ventre de la machine, pendant qu’il se redresse et s’essuie le front avec son mouchoir.
On sent bien qu’il n’y a rien à faire. Et glisse ainsi la riche plaine[1] où les gens sont en train de labourer ; passent des villes, des villages ; le large fleuve vient, comme un fleuve de lait entre ses bancs de sable fin (du moins il était comme du lait au moment de la fonte des neiges, mais depuis il a déposé) ; viennent à droite des carrières dans lesquelles sont percés des trous, et, de temps en temps, un homme sort, poussant devant lui sa brouette qu’il vide d’un geste du bras droit.
Un nom est crié ; il faut descendre. C’est une toute petite station, avec rien que la maison du chef de gare, et, séparée d’elle par la route, une auberge adossée à l’escarpement de la pente.
On ne prend pas par la route qui fait trop de lacets. Il y a un petit sentier connu des seuls habitués qui se faufile entre les murs de vigne ; tout de suite, on est engagé en pleine falaise rocheuse. On grimpe droit devant soi. Par moments, le sentier se perd entre les ceps ; à certains endroits, il est tout à fait coupé par ces profonds fossés qu’on creuse pour les provignages ; il faut un moment pour le retrouver. Mais on voit aussitôt la différence de pays et combien c’est ici plus pierreux, plus aggloméré, plus massif. Et les rudes soleils d’ici ! C’est quand chantent les sauterelles, qui, avec leurs pattes qu’elles se frottent sur le dos, font un bruit comme celui d’une lame qui vibre ; et il vous vient un coup de poing de chaleur en plein visage, à chaque tournant de mur. Mais déjà l’automne est tombé avec des rousseurs de plus en plus sombres ; l’astre se diminue là-haut ; silence des grillons maintenant, plus que des mouches.
On se retourne, on voit qu’on s’est élevé. Et tout à coup on se trouve perché sur une espèce d’avancement en éperon d’où on domine tout l’arrangement désordonné des casiers de vigne sous soi ; le toit de la gare semble posé à plat sur le sol au bord de la voie ; encore un pas ou deux, et la pente faiblit et on est parmi les vergers.
Il y a là deux ou trois hameaux où les gens du village d’en haut viennent passer l’hiver ; Julien pense : « Je vais arriver devant la maison peinte » ; il arrive devant la maison peinte[2]. Un vieillard y est logé qui ressemble à un bonhomme de baromètre, c’est-à-dire qu’il sort et rentre mécaniquement et toujours par la même porte.
Il guette les gens sur la route pour leur montrer les peintures de sa maison dont il est fier, et il raconte à leur sujet des histoires pleines de mensonges, mais de mensonges auxquels il croit, tout en vous tendant un verre d’amigne[3], parce qu’il est généreux aussi et toujours il vous offre à boire.
Aujourd’hui pourtant il n’est point sorti ; Julien d’ailleurs a pressé le pas ; il serait incapable d’entretenir la conversation. Il y a dans sa tête un tel embrouillement d’idées que s’il tirait dessus ce serait comme pour les pelotons noués : elles se noueraient toujours plus. Et il ne veut même pas voir les femmes, qui entourent la fontaine, avec des seilles et des enfants, lesquelles se tournent vers lui, et, quand il passe et dit bonjour, elles disent aussi bonjour et longtemps le suivent des yeux.
[1] Ce morceau relate la montée à Lens de Julien, qui traverse la plaine du Rhône et s’arrête à la petite halte ferroviaire de Granges. Il emprunte ensuite un sentier pédestre qui relie les deux villages en passant par Flanthey (Vaas puis Chelin) et le long duquel se trouve la Pierre des Morts dont Ramuz a déjà donné une description dans Jean-Luc persécuté (Œuvres complètes, XIX, Genève, Slatkine, 2011, p. 460). À l’arrivée du chemin sur le plateau de Lens se dresse une croix avec un christ doré. Lorsqu’il quitte le village, Julien s’arrête à Sion, chef-lieu du canton du Valais.
[2] Vraisemblablement le château de Vaas, dont les façades sont décorées de fresques datant de 1576.
[3] L’amigne est un cépage souvent dit valaisan, mais dont l’origine n’est pas établie avec certitude ; il a notamment des affinités génétiques avec des cépages valdôtains. Uniquement cultivé dans le Valais central – essentiellement sur le coteau de Vétroz –, il constitue le premier indice de la région où se trouve Julien.