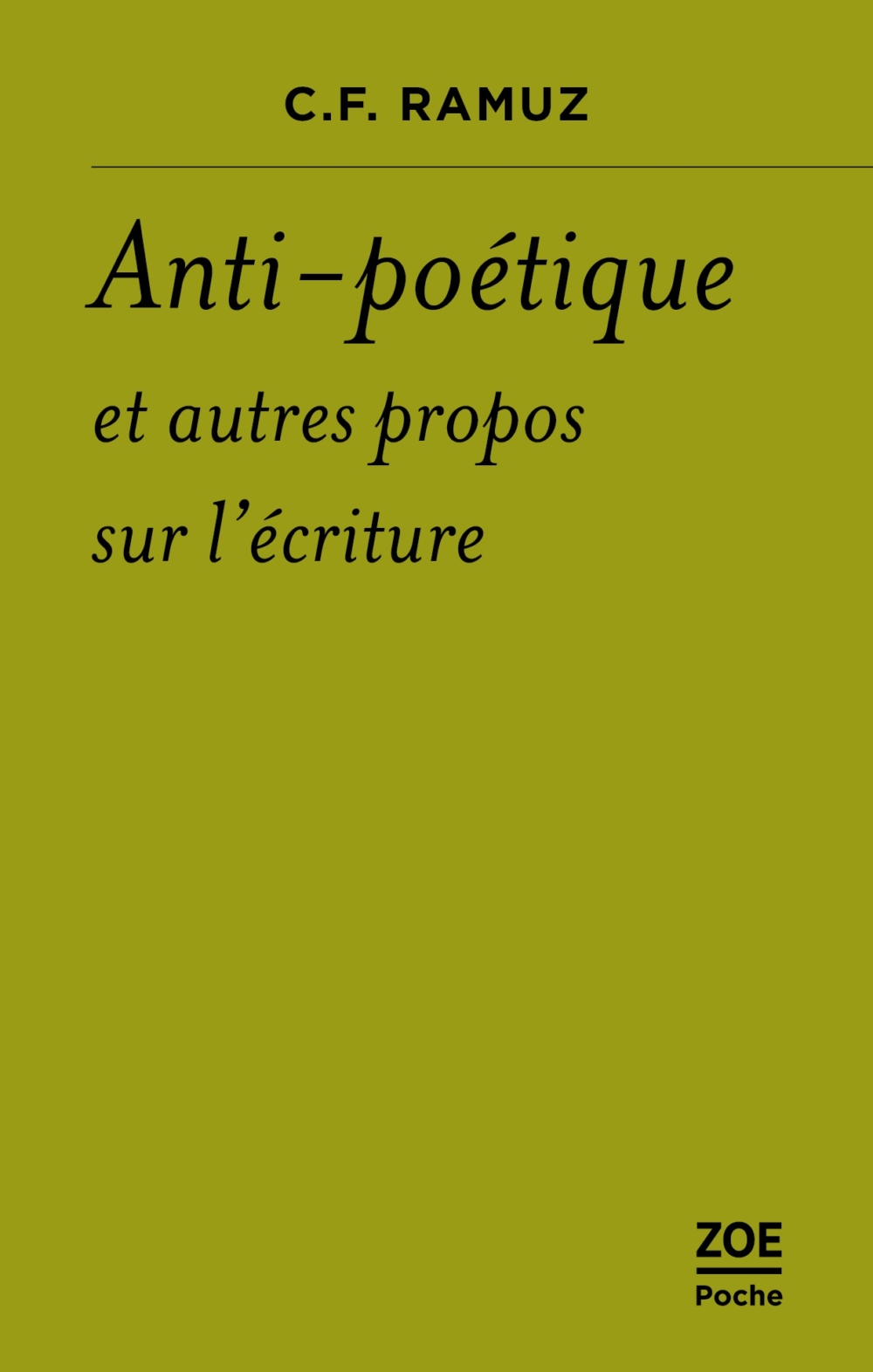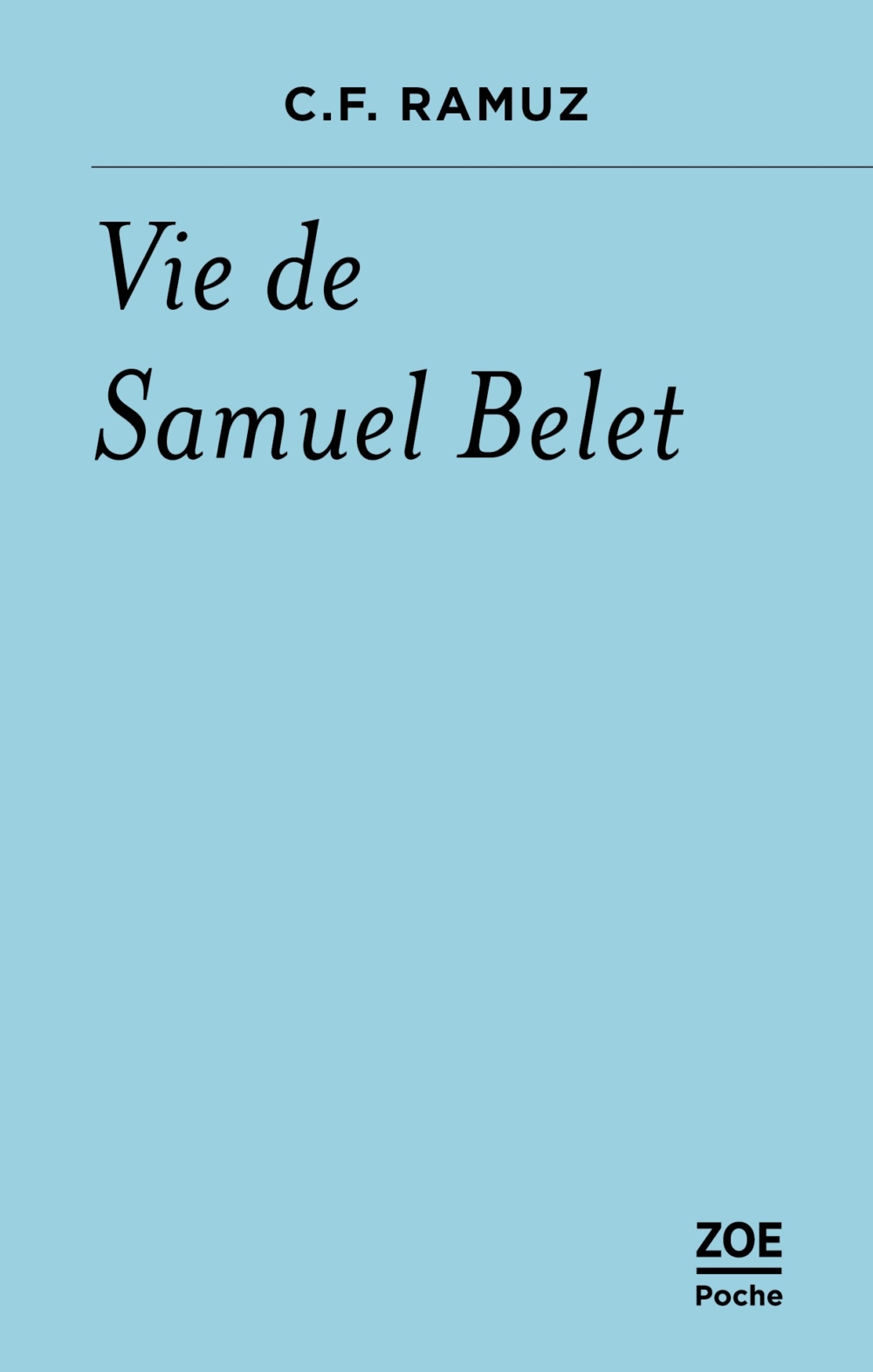I
C’est vers ce temps-là qu’il a commencé à se hasarder jusque dans les rues de la ville, ce qu’il n’aurait pas osé faire auparavant, mais il y avait des choses qui n’étaient pas permises et, à présent, elles l’étaient.
Il y avait des choses qui avaient semblé impossibles et qui ne semblaient plus impossibles.
Vers ce temps, c’est-à-dire vers le milieu de mai, il a commencé à s’aventurer jusqu’en plein centre de la ville ; et, comme il faisait chaud déjà, il portait des vêtements en toile blanche.
Il tenait à la main une branche qu’il avait cassée en passant dans une haie et ayant encore ses feuilles ou même toute fleurie, quand c’était une branche d’aubépine ou de fusain.
On n’a guère fait attention à lui, les premiers jours, sauf que ceux qui n’avaient pas encore eu l’occasion de le rencontrer se retournaient sur son passage, demandant : « Qu’est-ce que c’est que ce particulier-là ? » mais on leur disait :
– Comment, vous ne savez pas ? C’est le pensionnaire du docteur Morin…
– Ah !
– Il croit qu’il est Jésus-Christ.
On riait. Et, lui, continuait sa route, sa branche de feuilles à la main, comme quand on portait autour de Lui des palmes ; – c’était après qu’Il avait dit à ses disciples : « Allez me chercher ce poulain d’ânesse »[1], et ses disciples avaient été Lui chercher le poulain.
On est vers la fin de mai ; toutes les fenêtres étaient ouvertes. L’homme s’avançait dans la rue : une tête, de place en place, se penchait hors d’une de ces fenêtres. Il était grand, il était beau, il était large d’épaules ; il portait toute la barbe, il avait les cheveux longs.
Il est arrivé pour finir à une petite place où il y a une fontaine à double tuyau de laiton toujours couvert de sueur, tellement l’eau est froide, et à double bassin de granit ; là se tenaient quelques femmes dans leurs modestes jupes de toile, dans leurs modestes corsages de toile, tête nue, les manches troussées ; elles parlaient entre elles, en attendant que leurs seaux fussent pleins.
Il était venu jusque sur la place ; voyant les femmes, il s’était arrêté.
Il s’arrête au sortir de la rue et à l’endroit même où elle débouchait sur la place de la fontaine ; il a regardé les femmes sans rien dire, et elles, tout d’abord, n’ont pas pris garde à lui.
Elles étaient trois ou quatre, qui se tenaient sous un petit carré de ciel très bas, peint en bleu, faisant comme un plafond ; et la place sous ce plafond était comme une petite chambre pleine d’ombre, car le soleil n’était pas encore venu jusqu’ici, et il n’y venait que tard et occasionnellement ; pleine de silence aussi, où il y avait seulement la façon de chanter de l’eau qui est de commencer par les notes d’en haut pour finir par les plus basses, il y avait quelques mots échangés, le cri métal contre métal des seaux qu’on tire sur les traverses.
Les femmes tournaient toujours le dos à l’homme ; elles ne l’ont pas vu tout de suite, ni en même temps ; c’est Mme Reymondin qui l’a aperçu la première.
Il ne bougeait pas, elle n’a pas bougé ; et c’est seulement en voyant Mme Reymondin rester si longtemps immobile que les autres ont fini par se douter de quelque chose ; alors elles ont vu l’homme à leur tour ; elles se sont mises aussi à le regarder, qui les regardait donc et qui a continué à les regarder sans rien leur dire.
Pour finir, elles ont baissé la tête. Elles ont baissé la tête, elles la relèvent ; l’homme n’était plus là.
Un petit moment se passe.
Tout à coup, on a entendu Mme Reymondin dire quelque chose.
Et les femmes : « Qu’est-ce que vous dites ? » n’ayant pas compris ; c’est que Mme Reymondin avait parlé très bas et comme pour elle- même.
– Ah ! a-t-elle dit alors… C’est drôle comme il ressemble à l’Autre. Et vous savez qu’on prétend justement qu’Il va revenir.
Regardant avec fixité la place que l’homme occupait, qu’il n’occupait plus, la place qui avait été occupée par lui, qui n’était plus occupée ; et il y a eu donc ce vide et à présent il y avait ce vide, avec l’étroite rue s’ouvrant plus en arrière : puis le vide n’a plus été.
Pendant que les autres femmes attendaient une explication, mais rien n’est venu ; et elles n’ont rien vu, et elles n’ont pas dû comprendre.
Elles n’ont pas pu voir, ni savoir le changement qui se faisait là pour cette autre : c’est pourquoi elles ont pris leur seau par l’anse et leur corps a ployé dans le milieu sur le côté opposé.
Mme Reymondin, elle seule, n’avait toujours pas bougé.
Et c’était aussi, dans ce temps-là, une étroite petite rue ; alors les maisons n’ont pas eu de peine à être seulement un peu plus basses, un peu plus blanches, la pente de leurs toits allant de plus en plus en arrière et vers en bas, les trous des fenêtres bouchés.
Mme Reymondin regardait toujours le même point et c’était la rue ; – il y a eu cette petite rue toute blanche d’un côté, toute bleue de l’autre côté. Et cet arbre était un palmier.
Des enfants nus couraient sans bruit dans la poussière.
Il avait une robe blanche. Il avait cette même barbe noire, les mêmes beaux yeux, les mêmes longs cheveux bouclés.
Il y avait là un puits, non une fontaine. Il s’était assis sur la margelle de ce puits, et, avec une branche qu’Il tenait à la main, Il s’est mis à écrire des choses dans le sable.
C’est alors qu’une femme est arrivée, levant ses bras nus au-dessus de sa tête ; et des hommes la suivaient, une pierre dans chaque main.
Il écrivait toujours avec le bout de sa baguette des choses qu’on ne savait pas dans le sable[2].
[1] Ces deux allusions bibliques renvoient à Matthieu, XXI, 1-11 (récit de l’entrée de Jésus à Jérusalem) et à l’Apocalypse, VII, 9-17 (mention des palmes et des vêtements blancs).
[2] Le récit enchaîne deux allusions à des épisodes de l’Évangile de Jean, d’abord celui de la Samaritaine (Jean, IV, 6-7), puis celui de la femme adultère (Jean, VIII, 6-7).