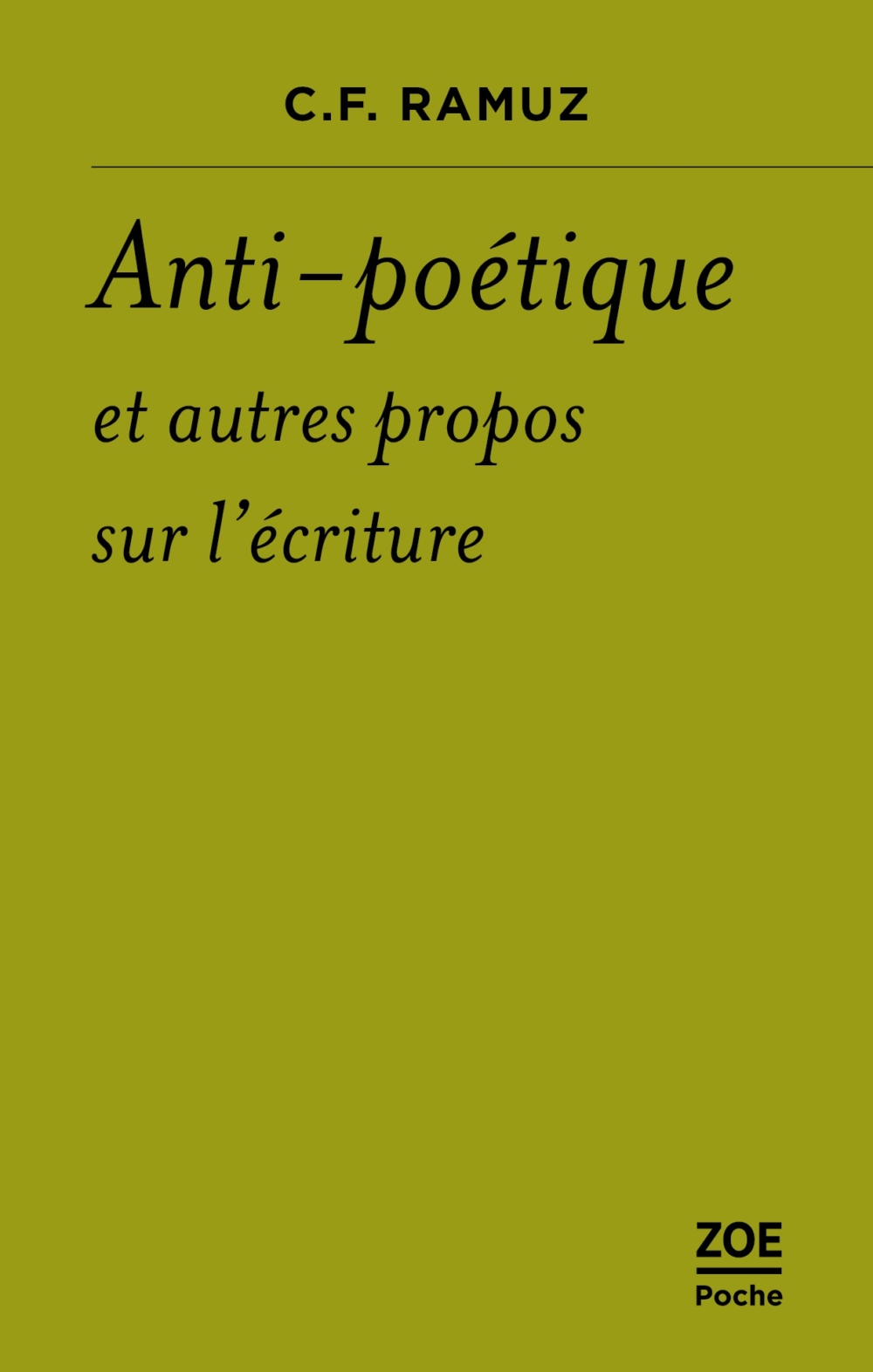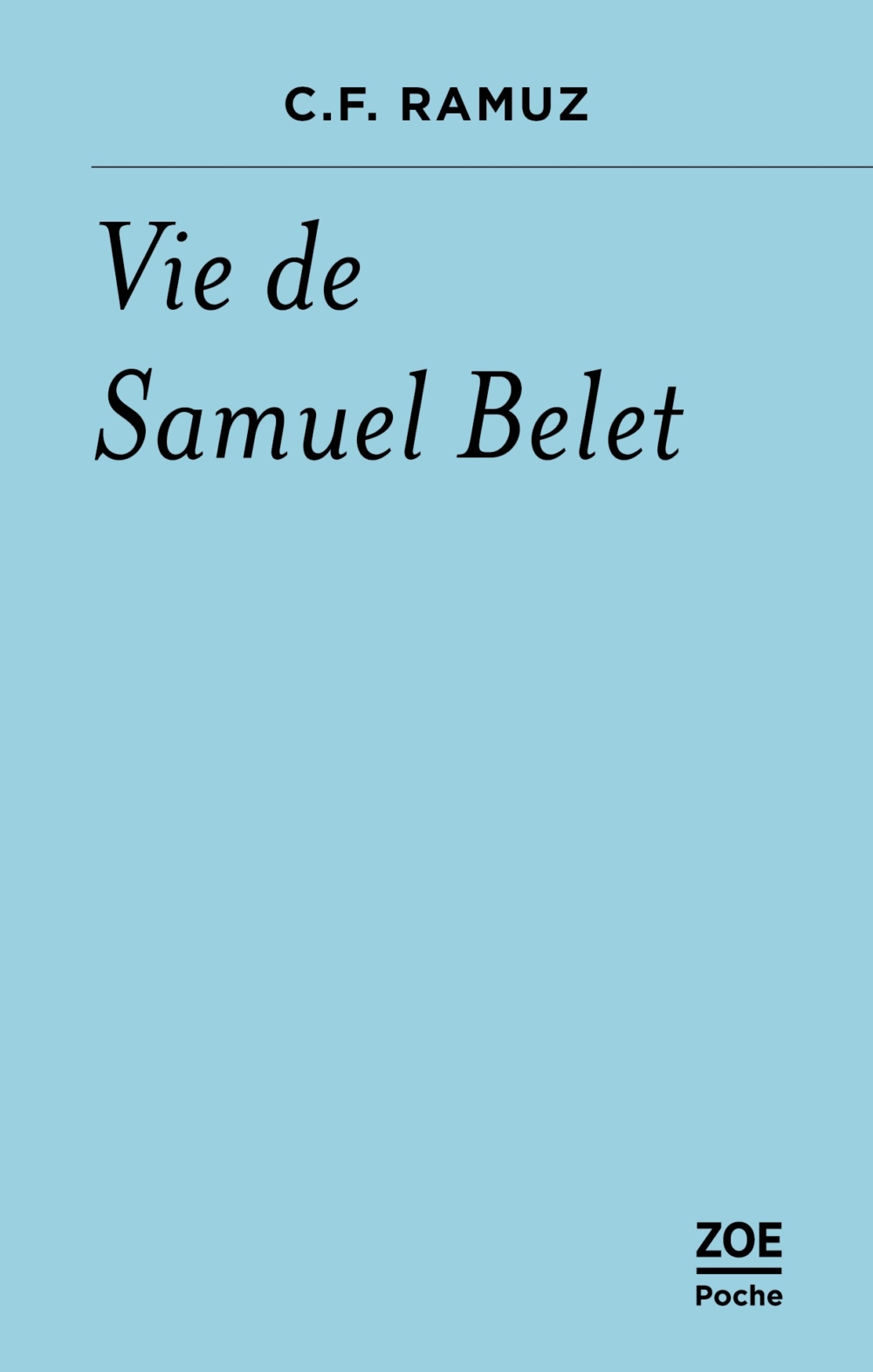I
Julien Damon rentrait de faucher. Il faisait une grande chaleur. Le ciel était comme de la tôle peinte, l’air ne bougeait pas. On voyait, l’un à côté de l’autre, les carrés blanchissants de l’avoine et les carrés blonds du froment; plus loin, les vergers entouraient le village avec ses toits rouges et ses toits bruns ; et puis des bourdons passaient.
Il était midi. C’est l’heure où les petites grenouilles souffrent au creux des mottes à cause du soleil qui a bu la rosée, et leur gorge lisse saute vite. Il y a sur les talus une odeur de corne brûlée.
Lorsque Julien passait près des buissons, les moineaux s’envolaient de dedans tous ensemble, comme une pierre qui éclate. Il allait tranquillement, ayant chaud, et aussi parce que son humeur était de ne pas se presser. Il fumait un bout de cigare et laissait sa tête pendre entre ses épaules carrées. Parfois, il s’arrêtait sous un arbre ; alors l’ombre entrait par sa chemise ouverte ; puis, relevant son chapeau, il s’essuyait le front avec son bras ; et, quand il ressortait au soleil, sa faux brillait tout à coup comme une flamme. Il reprenait son pas égal. Il ne regardait pas autour de lui, connaissant toute chose et jusqu’aux pierres du chemin dans cette campagne où rien ne change, sinon les saisons qui s’y marquent par les foins qui mûrissent ou les feuilles qui tombent. Et il songeait seulement que le dîner2[1] devait être prêt et qu’il avait faim.
Mais, comme il arrivait à la route, il s’arrêta tout à coup, mettant la main sur ses yeux. C’était une femme qui venait. Elle semblait avoir une robe en poussière rose. Il se dit : « Est-ce que ça serait Aline ?… » Et, lors- qu’elle fut plus près, il vit que c’était bien elle. Alors il sentit un petit coup au cœur. Elle marchait vite, ils se furent bientôt rejoints.
Elle était maigre et un peu pâle, étant à l’âge de dix-sept ans, où les belles couleurs passent, et elle avait des taches de rousseur sur le nez. Pourtant, elle était jolie. Elle avait les yeux indécis comme l’aube. Son grand chapeau faisait de l’ombre sur sa figure, jusqu’à sa bouche qu’elle tenait fermée. Ses cheveux blonds, bien lissés devant, étaient noués derrière en lourdes tresses. Elle portait un panier au bras, et ses gros souliers dépassaient sa jupe courte.
Julien dit :
– Bonjour.
Elle répondit :
– Bonjour.
C’est de cette façon qu’ils commencèrent. Et puis il dit de nouveau :
– D’où est-ce que tu viens ?
– De chez ma tante.
– Il fait bien chaud.
– Oh! oui.
– Et puis c’est bien loin.
– Trois quarts d’heure.
– C’est, dit-il, que c’est pénible avec ce soleil et cette poussière.
– Voilà, je suis habituée.
Ils se tenaient comme des connaissances qui se font une politesse de causer un peu, s’étant rencontrées. Julien avait une main dans sa poche, l’autre sur le manche de sa faux, et il tournait la tête en parlant. Mais les oreilles d’Aline étaient devenues rouges. Et lui aussi, malgré son air, il avait quelque chose à dire, qui n’était pas facile à dire. Il reprit :
– Où est-ce que tu vas ?
Elle dit :
– Moi, je rentre.
– Moi aussi.
Pendant qu’ils marchaient tous les deux l’un près de l’autre, Julien cherchait dans sa tête. Il y a des fois où on a les tuyaux de la tête bouchés. Alors, il regarda en l’air. On apercevait dans les branches les cerises blanches du côté de l’ombre et rouges du côté du soleil. Les abeilles buvaient aux fleurs toutes ensemble, avec un bruit de cloches.
Bientôt le village parut. Et Julien, parce que le temps pressait, alla plus profond dans sa tête, là où les idées se cachent, et dit :
– J’ai fauché toute la matinée, c’est pas commode par ce sec. C’est des jours de la vie où on n’a pas courage à vivre.
– C’est vrai, répondit Aline, on n’a de plaisir à rien.
– Et puis, dit-il, ayant trouvé son idée, il y a longtemps qu’on ne s’est pas revus.
Aline baissa la tête. Elle dit :
– C’est que c’est le moment où le jardin demande. Et puis, maman qui est toute seule.
Mais, comme il était têtu, il secoua le front.
– Ecoute, qu’il reprit[2], si tu étais bien gentille, eh bien ! on se reverrait.
Alors Aline pâlit.
– Hein ? dit-il.
– Je ne sais pas si je pourrai.
– Du diable pourtant ! on a des choses à se dire.
Ce fut le moment où elle hésita et son cœur se balançait comme une pomme au bout d’une branche, et puis l’envie fut la plus forte.
– Si je me dépêche bien, dit-elle, peut-être une fois.
– Alors quand ?
– Quand tu voudras.
– Ça va-t-il ce soir, vers les Ouges[3] ?
– Oh ! oui, peut-être.
Ils arrivaient au village; les maisons se tenaient au bord de la route avec leurs jardins, leurs fontaines et leurs fumiers. Julien dit encore :
– A ce soir, pour sûr.
Et elle répondit :
– Je tâcherai bien. Pour sûr.
[1] En Suisse romande, particulièrement à la campagne, le dîner désigne le repas de midi (DSR).
[2] L’incise « qu’il reprit » (et non pas « reprit-il ») induit un ancrage du narrateur dans le monde de ses personnages. Le narrateur et les héros de cette «histoire» semblent proches par la langue et la culture populaires. Cette proximité assure le ton du roman et son unité. Pour une étude des faits de langue propres à l’écriture romanesque de Ramuz le lecteur se reportera à l’article de Rudolf Mahrer : « Un français de plein air : la langue romanesque de C. F. Ramuz », Le Français moderne, n° 2, Paris, 2006, pp. 219-235.
[3] Toponyme attesté en Suisse romande. Dans Aline les repères géographiques précis sont rares.