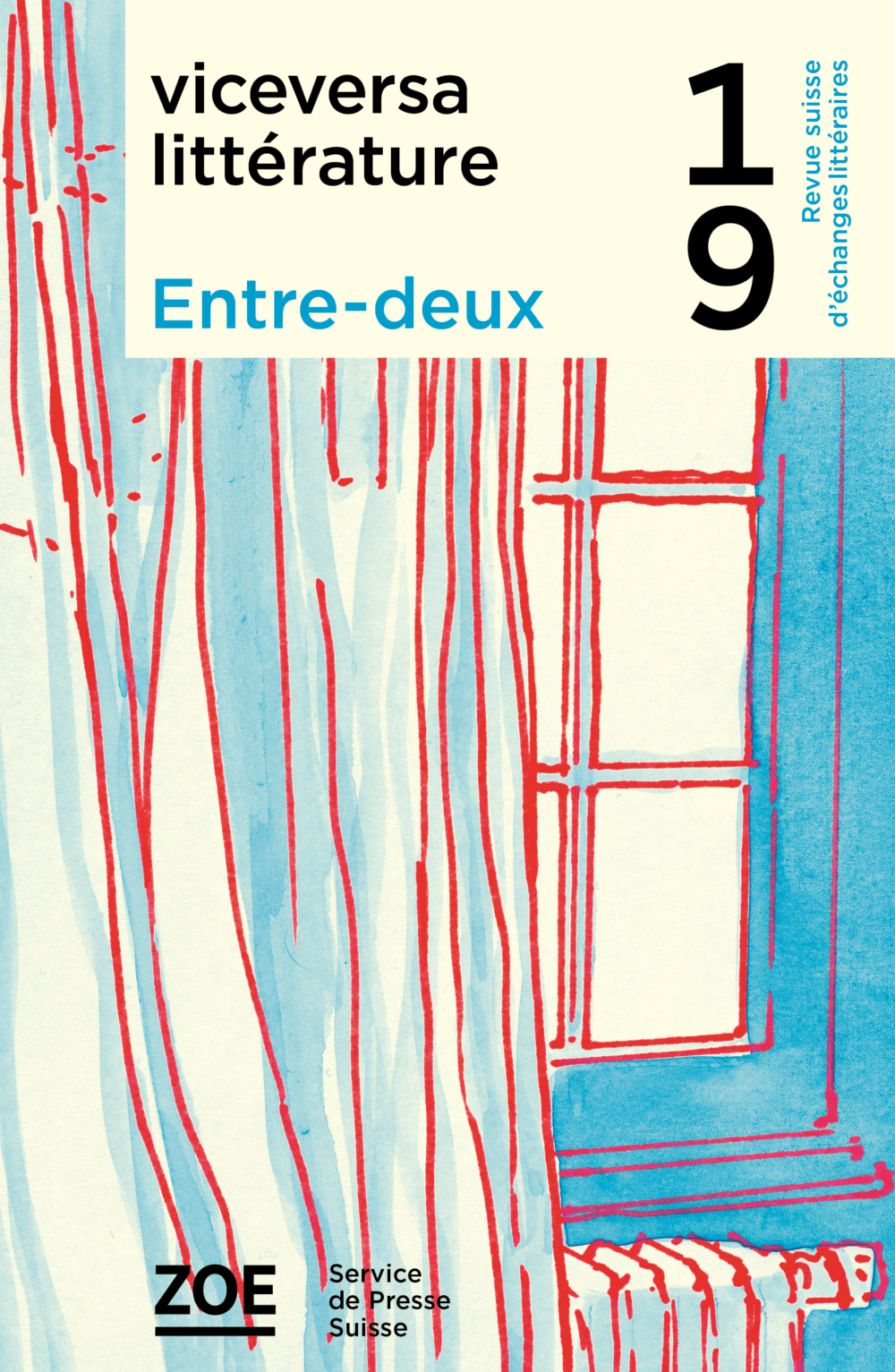Préface
Sylviane Dupuis
Adrien Pasquali :
du silence de l’infans au secret du Pain de silence,
une trajectoire d’écrivain
l’enfant ne parle pas ; en lui, la parole n’a pas encore été brouillée par le langage.
Mais le temps nous reprend […]. Son appel nous éveillera plus tard,
quand nous aurons déjà trop grandi et appris à utiliser le langage
pour faire taire le silence et son repos…[1]
A. Pasquali
Que le malheur nous laisse toujours dépourvus, que nous n’ayons pas encore
trouvé une phrase à effacer les larmes, depuis le temps.
Une phrase qui veuille tout dire, qui retienne tout ensemble…[2]
R. Pinget
Dans mon livre. Je serai. Chez moi.[3]
S. Doubrovsky
Dix ans déjà nous séparent de la disparition prématurée de l’écrivain Adrien Pasquali – qui fut aussi chargé de cours pour la littérature de Suisse romande au Département de langue et de littérature françaises modernes de l’Université de Genève.
Il nous a semblé qu’à l’Hommage à Adrien Pasquali publié chez Zoé la même année, « à chaud », et où se mêlent textes et témoignages d’amis, et premières (brèves) analyses de l’œuvre, pouvait et devait succéder aujourd’hui l’exercice d’un recul critique qui n’exclut en rien l’empathie. Que le moment était venu de nous interroger, en consacrant pour la première fois un colloque à « Adrien Pasquali romancier, chercheur, critique et traducteur », sur les enjeux majeurs et la cohérence (ou les contradictions) de cette œuvre encore trop peu étudiée, dont l’exigence et la variété formelles, l’étendue des curiosités, des savoirs et des compétences qui s’y manifestent, les hantises récurrentes et la quête de sens têtue qui la traverse, mais aussi l’énigme sur laquelle elle se fonde, justifient largement qu’on s’y arrête.
En proposant une première esquisse de « poétique de l’œuvre », en la donnant à lire un peu plus loin, le présent ouvrage devrait, espérons-le, ne constituer que le prélude à d’autres questionnements d’une œuvre dont l’inachèvement pourrait bien représenter l’une des clés, non seulement d’ordre biographique (Adrien Pasquali ayant brutalement mis fin à ses jours en mars 1999), mais aussi et surtout d’ordre esthétique (comme le montre Chloé Gabathuler), et devrait encourager chercheurs et étudiants à se pencher sur les manuscrits et les archives déposés à la Bibliothèque de Genève, dont Doris Jakubec nous donne ici un premier aperçu.
Passer de « l’aliénation » à « l’altérité » en s’interrogant sur toutes les formes de frontières (qu’elles soient celles du monde réel, celles de la raison et de la folie, du silence et de la parole, de la naissance et de la mort, ou celles des langues) ; passer de l’imitation à l’invention, et du pastiche qui est exercice d’admiration à la création personnelle (comme le montre Roger Francillon), l’écriture seule pouvant ici (re)conduire à une « naissance », ou à une « résurrection d’ordre poétique » (G. Roud) ; tenter de « guérir » d’un défaut d’origine et d’être, par le biais de l’exercice de traduction, par l’étude « intéressée » du processus de création des autres (c’est ce que montre Daniel Maggetti) et par son propre travail d’écrivain : telle fut l’ambition d’Adrien Pasquali dont l’œuvre protéiforme ressemble, lorsque, se retournant sur elle, on en interroge le dessin, à une « autobiographie de l’esprit ».
Né en 1958 à Bagnes, en Valais, de parents italiens émigrés avec lesquels l’échange de parole fut toujours problématique – ce dont témoigne un récit d’enfance autofictionnel, à valeur testamentaire : Le Pain de Silence[4], qu’analyse plus loin Antoine Raybaud –, cet immigré de la deuxième génération était pourtant devenu, à quarante ans, après des études menées à Fribourg et à Paris, et une thèse de doctorat, l’un des écrivains et des intellectuels de Suisse romande les plus remarqués de sa génération. Doué d’une capacité de travail peu commune, et d’une soif insatiable de connaissance qu’orientèrent dès l’origine le besoin de se construire une langue, une identité et un « lieu » à soi, comme l’espoir d’atteindre enfin ce qu’il nommait une « sérénité active de l’être », Adrien Pasquali, « passeur » entre les langues mais aussi arpenteur de l’imaginaire s’interrogeant sur la poétique du voyage – et « migrant » d’une culture, d’un espace géographique et mental, d’un genre littéraire ou d’une voix (et d’un style) à l’autre, se définissait lui-même avant tout comme traducteur : « mes propres écritures me sont toujours apparues comme un exercice de “ traduction ”, voire de disparition, entre deux langues, entre l’infans et le vir, le silence et le langage […], la reproduction et la construction… »[5]. Au défaut de « langue maternelle », à la douleur du manque d’origine, il avait choisi (par une « stratégie inconsciente de dispersion » devenue peu à peu consciente et revendiquée) de substituer le jeu infini des possibles, traduisant tour à tour de l’italien (Alice Ceresa, Giovanni Orelli, Aldo Gargani, Mario Lavagetto, le poète Aurelio Buletti…), de l’allemand (Felix Ph. Ingold, lui-même grand traducteur) ou encore de l’anglais (John Sturrock, Lawrence Venuti), multipliant les apprentissages et les défis. Et aimant à rappeler, en citant Balzac, que lire – et souvent aussi, écrire – est une « création à quatre mains ». Mathilde Vischer, elle-même traductrice en français de l’italien, analyse le rapport complexe d’Adrien Pasquali à ces deux langues, qui s’entrelacent intimement dans son écriture.
« Migrant » d’autant plus fasciné par les récits de voyage qu’il ne voyageait pas, ou guère, étant plutôt voué à l’élucidation de lui-même et de son origine qu’aux horizons géographiques ; écrivain hanté par la question du langage, par ses jeux et ses pièges, qui attendait de l’écriture (et d’elle seule) qu’elle lui offre un lieu où être et habiter enfin ; chercheur curieux de génétique textuelle que le travail sur les œuvres d’autrui ramène en définitive à soi : ce sont tous ces aspects d’Adrien Pasquali (à la fois disparates et intimement reliés et cohérents, comme on le verra) que les études ici rassemblées abordent successivement et articulent entre eux. Elles sont issues de trois générations de chercheurs (manière de démontrer que cette œuvre n’a cessé depuis dix ans de requérir l’attention, et de trouver de nouveaux lecteurs) et renvoient aux trois volets déjà mentionnés de la création romanesque, de la critique universitaire – principalement sur Ramuz, Bouvier et Gustave Roud – et de la traduction, activités que Pasquali mena constamment de pair avec son enseignement ; mais renvoient aussi parallèlement aux trois pôles complémentaires de l’exil, de la quête d’identité, et de la genèse de soi.
Comme le suggère la troublante photographie de l’écrivain (par Yvonne Böhler) qui figure dans Voix et visages[6] et sur laquelle, tourné vers nous, il semble imposer silence à on ne sait quel secret en posant un doigt sur sa bouche, nul mieux que lui n’aura su à la fois « s’exposer et se dérober » par un double geste contradictoire qui, selon Jean Roudaut (dont on lira plus loin une étude consacrée au Veilleur de Paris), est celui-là même de l’écriture. « Cacher, lit-on dans Le Pain de Silence, c’est montrer à l’envers ». Ce qui nous est demandé, c’est donc non seulement de savoir lire, mais de percer le mystère, de savoir regarder sous la trame, dans l’entrelac des fils, des leitmotivs récurrents, et dans la dislocation même de la syntaxe, ce qui se tisse de secret et d’allusif, de très savant mais aussi de très obsessionnel, au sein du texte, et qui renvoie d’une part à la question sans réponse du « Qui suis-je ? » (posée dès le premier texte publié, qu’analyse ici Muriel Zeender), et d’autre part à la mère.
Pasquali n’ignorant rien des formes romanesques les plus contemporaines – on connaît sa dette envers Pinget, Beckett, ou Claude Simon, entre autres –, il y aurait sans doute à s’interroger sur les liens de filiation possibles (et sur les « fils » secrets) unissant Le Pain de Silence et Fils[7] de Serge Doubrovsky (lui-même écrit, de l’aveu de son auteur, « sur le modèle de Joyce, dans Ulysse », ou de Claude Simon, dans Histoire), considéré comme le texte fondateur de « l’autofiction »[8]. Dans les deux cas, sur fond de mère manquante, ou défaillante, un fils s’« engendre » lui-même par l’écriture, métamorphosant un « je » biographique en « je » fictif qui lui ressemble et devenant à lui-même son propre père et sa propre mère, par le biais de sa narration et du travail de la langue. Ainsi, chez Pasquali, c’est une phrase attribuée à la mère (qui ne l’a pas réellement prononcée), puis une seconde attribuée au père, qui lancent le processus d’écriture du fils, seul à « détenir l’autorité du langage »[9] – mais qui sera à la fin renvoyé à ce silence contre lequel s’érige tout le texte et qui est aussi, écrit-il, « la seule chose que nous avons eue en commun ». C’est pourquoi, tout au long du Pain de silence (formé de deux immenses phrases sans début ni point final), et qui s’ouvre avec l’exergue : « Pourquoi parler quand on peut se taire ? (proverbe chinois) » mais substitue les mots du fils aux « pages blanches du cahier de [la] mère » et au silence du père), un interdit rigoureux pèse sur la parole : car atteindre son but (le point final) serait ici synonyme, à la fois, d’achèvement, de naissance (par rupture définitive du cordon ombilical) ou de résurrection, et de trahison ou de mort… Adrien Pasquali: ou comment aller, dans la fiction et dans la vie, qui ici se confondent, au bout d’une rêverie sur le nom qui prend la forme tragique d’un destin. Reste, entre nos mains, au-delà de l’effacement volontaire de son auteur rendu au « rien », ce livre qui nous est tendu à la fois comme un testament et une hostie : comme un morceau de pain à se partager autour de la table (motif – eucharistique et pascal – omniprésent dans Le Pain de silence) « en mémoire de lui ».
En articulant, du premier au dernier texte de l’écrivain, les multiples facettes de cette œuvre qui est loin d’avoir livré tous ses secrets, les lectures qui suivent permettront, espérons-le, de mieux faire lire et aimer la voix de celui qui, parti de l’espoir d’une « réinsertion dans le monde », en 1982, décrivait sa situation, en 1998 – entre « étrangéisation dans la langue » et « étrangéisation dans le monde » – comme une « impasse irrésolue ».
[1] Adrien Pasquali, Nicolas Bouvier. Un galet dans le torrent du monde, Zoé, 1996, p. 149.
[2] Robert Pinget, chute inédite de Passacaille (tiré de : Fonfon, tapuscrit 1968, Archives nationales, Paris).
[3] Serge Doubrovsky, Le Monstre, feuillet 1277. Le Monstre (1968, date de la mort de la mère de Serge Doubrovsky – 1976) constitue le dossier génétique, encore inédit, et composé de plusieurs milliers de feuillets, de Fils (cf. infra, note 7, et http ://www.everyoneweb.com/doubrovskymanuscrit.com).
[4] Adrien Pasquali, Le Pain de silence, Zoé, 1999 (réédité en 2009 en format de poche).
[5] Adrien Pasquali, L’Ecrivain et son traducteur, Zoé, 1998, p. 48.
[6] Yvonne Böhler, Voix et visages – Ecrivains romands, Zoé, 1996. La même photographie est reprise en couverture de l’Hommage à Adrien Pasquali (dir. Michel Jeanneret), Zoé, 2009.
[7] Serge Doubrovsky, Fils, Galilée, 1977.
[8] Le mot « auto-fiction » apparaît explicitement, dans Le Monstre (cf. supra, note 3), au feuillet 1637.
[9] Expression empruntée à Adrien Pasquali, Portrait de l’artiste en jeune tisserin, vol. I. L’Histoire dérobée, Editions de L’Aire, 1988, p. 180.