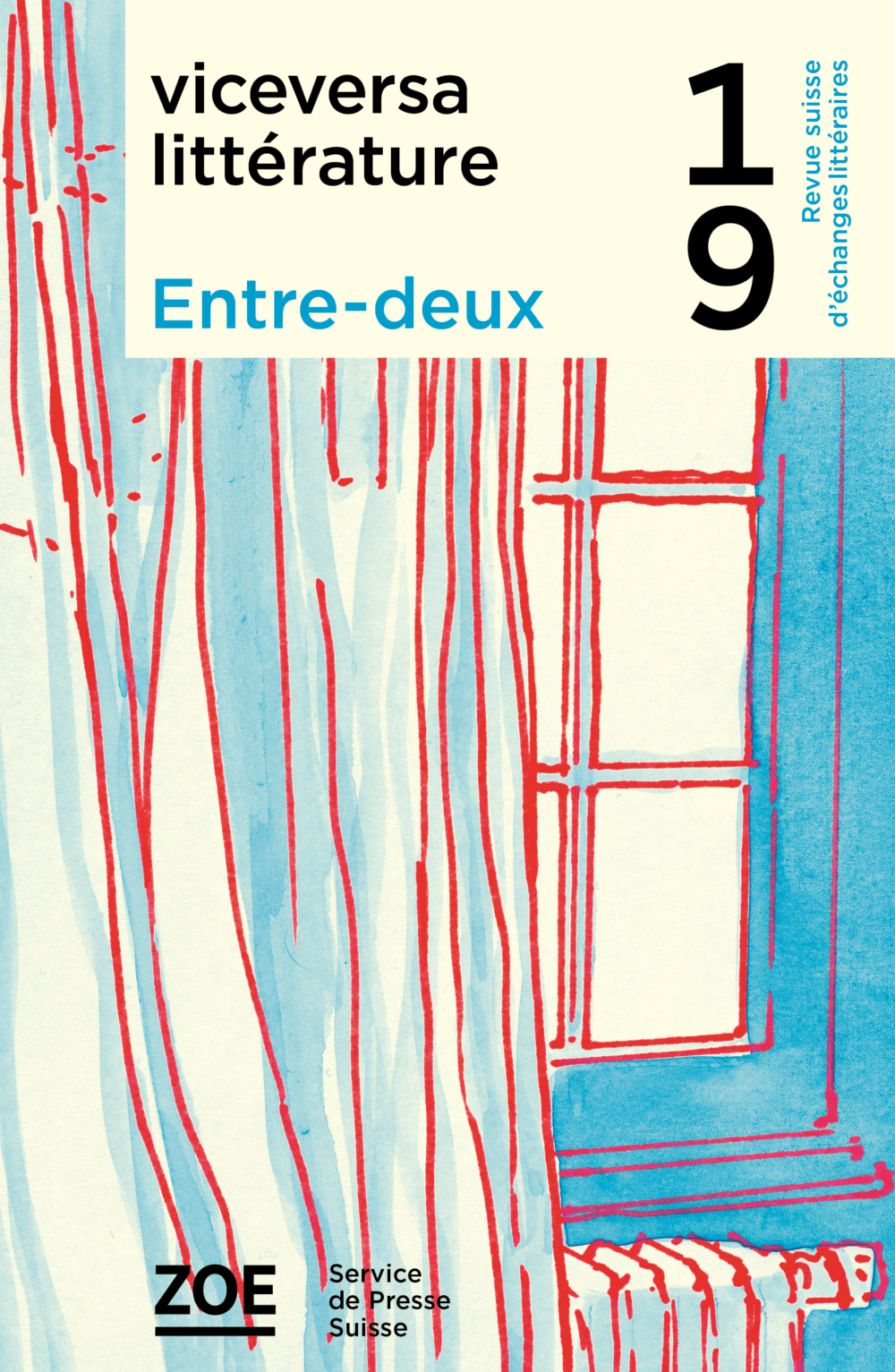Jean de Léry,
ou le roman d’aventures du calvinisme
Une vie mouvementée
Né en 1536 dans le bourg de La Margelle, en Bourgogne, Jean de Léry est cordonnier de son état. Pour raison de religion, il s’est réfugié à Genève, peu de temps avant qu’on l’adjoigne, comme « mécanique » (travailleur manuel), à la mission que Calvin dépêche au Brésil auprès de l’amiral de Villegagnon, sur sa demande (embarquement en novembre 1556, arrivée au Brésil en mars 1557). Avec l’appui de l’amiral de Coligny, Villegagnon vient d’établir, en novembre 1555, une petite colonie sur une île de Guanabara (actuellement : baie de Rio de Janeiro). Il s’agit à la fois de prendre de vitesse les Portugais, qui n’ont pas encore colonisé cette région commercialement importante, et de fonder une sorte de refuge où partisans de l’ancienne et de la nouvelle foi pourront coexister. Après cinq ans, l’entreprise sera totalement abandonnée. André Thevet (1502-1590), celui qui deviendra le cosmographe du roi, fait partie de l’expédition. Mais, éprouvé par la maladie, il est rapatrié moins de trois mois après son arrivée. Autant dire qu’il ne rapporte presque pas d’observations directes. La mission calvinienne doit aider à résoudre certains différends en matière de dogmes et de liturgie. Son échec sera total, car, en deux ans, Villegagnon est passé d’une position ouverte, inspirée par Coligny, à une orthodoxie sourcilleuse. Au lieu de développer la colonie et de l’établir sur terre ferme, on se met à disputer, pendant de longues semaines et à quelques encablures des Tupinambas anthropophages, de cette autre anthropophagie que représente la manducation du corps du Christ ! Se soumettre ou partir : à la fin, les Genevois n’ont plus d’autre alternative. Que choisir, du danger représenté par Villegagnon (trois calvinistes furent noyés par lui après le départ des autres) ou des immenses périls auxquels exposent la violence de l’océan et la vétusté d’un bateau vermoulu ? Avec le pasteur Pierre Richer, Léry préfère rentrer (janvier 1558). On lira, aux chapitres XXI et XXII de l’Histoire d’un voyage[1], le récit de l’horrible traversée. De retour à Genève en 1559, Léry se marie (union peu heureuse), devient bourgeois de la ville et reçoit une formation (accélérée ?) de théologien. Il exerce alors une activité pastorale en France, au plus dur des guerres de religion. Après la Saint-Barthélemy (24 août 1572), on le trouve réfugié dans la place forte de Sancerre, qui résiste une année aux troupes catholiques. Il sera le témoin de la famine et d’un cas de cannibalisme. Il négociera la reddition de la place. Après des années de ministère en Bourgogne, il devient pasteur chez Leurs Excellences de Berne : à Aubonne (1589-1595), puis à L’Isle et Montricher, où il mourra de la peste en 1613. Étroitement associé au calvinisme, ministre en Pays de Vaud pendant un quart de siècle, diffusé par les presses genevoises, Léry a plus d’un titre pour figurer parmi les auteurs romands.
Léry a rédigé deux chroniques de deux événements marquants de sa vie : L’Histoire memorable de la ville de Sancerre, contenant les entreprinses des assiegeants, les resistances, et la delivrance notable des assiegez […] (s.l., 1574), et l’Histoire d’un voyage faict en la terre du Bresil […]. Cette œuvre connaît cinq éditions du vivant de Léry : en 1578, en 1580 (édition augmentée de manière sensible), en 1585 (augmentation significative de la préface), en 1594 et en 1599-1600. On la traduira, du vivant de l’auteur également, en latin, en hollandais, en anglais (abrégé). Une traduction allemande sera publiée à la fin du XVIIIe siècle.
Thevet et Léry
Thevet publie ses Singularitez de la France antarctique en 1557. C’est le premier récit de l’entreprise de Villegagnon ; il paraît un an après le retour du géographe. Celui-ci a connu « Fort Coligny », mais y a été malade et l’a quitté après dix semaines. Thevet s’entoure donc de témoignages recueillis sur place pour décrire de façon assez complète la région que les Français espéraient coloniser. Un polygraphe, Mathurin Héret (1518-1585), fournit les rapprochements avec les auteurs de récits de voyages antiques. Le contenu ethnographique de l’ouvrage est de première importance, et Léry n’ajoutera pas grand-chose, dans son propre récit, aux renseignements apportés par Thevet : organisation sociale, croyances, guerre, cannibalisme, récits cosmogoniques, faune, etc.
Cette expédition chez les Tupinambas participe vite de la polémique entre catholiques et protestants. Villegagnon, en 1561, se défend contre les accusations dont il est l’objet ; Crespin, comme par riposte, insère en 1564, dans son Livre des martyrs, le récit de l’exécution des trois calvinistes par Villegagnon. La polémique reprend avec la publication de la Cosmographie universelle de Thevet (1575), où l’auteur accuse les calvinistes d’avoir fait échouer l’entreprise de colonisation. Léry se sent alors investi d’une mission de témoignage. Par deux fois, il aurait perdu, nous dit-il, le texte de son Histoire, écrite d’« encre de Bresil » ; il l’aurait miraculeusement retrouvé en 1576. Vérité ou artifice pour souligner le caractère providentiel de son œuvre ? Peu importe. Elle « apparaît donc comme le fruit d’un long mûrissement […]. Loin de surgir ex nihilo un beau jour de l’an 1578, elle a été préparée par une méditation personnelle nourrie au fil des années par les déconvenues domestiques, l’épreuve renouvelée des sièges de La Charité et de Sancerre en 1572-1573 et la prédication de l’Évangile dans les circonstances dramatiques d’une France déchirée par les guerres civiles »[2]. En 1580, l’Histoire comprend une épître dédicatoire à François de Coligny, une longue préface et vingt-deux chapitres ainsi répartis : motifs du voyage (I), voyage et description des phénomènes maritimes et des animaux marins rencontrés (II-V), accueil et comportements de Villegagnon (VI), description de l’île et du Fort Coligny (VII), description physique des Tupinambas (VIII), leur alimentation et boisson de base (IX), faune et flore (X-XIII), guerre et anthropophagie (XIV-XV), religion (XVI), polygamie et police civile (XVII-XVIII), mort et funérailles (XIX), ce que l’on pourrait appeler le « vocabulaire de base Berlitz » nécessaire à un francophone pour nouer des relations avec les Tupinambas (XX), l’atroce voyage de retour (XXI-XXII).
Léry ethnologue, écrivain et historien
Sans Thevet, premier ethnologue français moderne, Léry n’aurait peut-être pas écrit son Histoire. C’est pourtant ce dernier texte qui est, pour Lévi-Strauss, le « bréviaire de l’ethnologue »[3]. Pourquoi ? D’abord, parce qu’il relate une expérience de presque un an dans la baie de Guanabara et une cohabitation de deux mois, sur terre ferme, avec les Tupinambas. Léry est un témoin oculaire, il peut se prévaloir de l’autopsie[4]. Il a participé, comme un reporter moderne, à une entreprise guerrière de ses hôtes ; il a vécu en leur compagnie une convivialité dont il se souvient avec émotion. Sur les mêmes sujets, Léry est souvent un narrateur plus complet que Thevet et un témoin comme fasciné par l’autre. Une telle familiarité ne lui a rien ôté cependant de la distance nécessaire à une bonne observation. Cette distance ressortit à des exigences ethnologiques évidentes, à des exigences littéraires aussi : l’écrivain médite avec lui-même, revient sur son texte, s’interroge en écrivant. Il a le sens de la disposition rhétorique dont il déplore l’absence chez Thevet, dans sa préface de 1585 notamment. La littérature digne de ce nom est souvent le lieu de conflits et d’ambiguïtés que l’écrivain essaie de résoudre en les exprimant. A ce titre, Léry présente une contradiction dramatique entre la nostalgie de la réminiscence (le jeune cordonnier, peu soucieux de théologie, s’est trouvé à son aise chez les Tupinambas) et le jugement qu’un pasteur d’âge mûr porte sur les sauvages abandonnés par la grâce de Dieu. Calvin n’était pas très ouvert à l’évangélisation des Américains. Léry se réfère d’ailleurs à la théorie de Francisco Lopez de Gomara, l’historien de la conquête des Indes par Cortés, selon laquelle l’Américain descendait de Cham, le fils maudit de Noé. Pour juger de l’espace littéraire contradictoire dans lequel se meut l’imaginaire de Jean de Léry, opposons deux passages. Le premier est extrait du chapitre XXI :
[…] plusieurs d’entre nous, ayant là non seulement moyen de servir à Dieu, comme nous désirions, mais aussi goûté la bonté et fertilité du pays, n’avaient pas délibéré de retourner en France, où les difficultés étaient lors et sont encore à présent sans comparaison beaucoup plus grandes, tant pour le fait de la Religion que pour les choses concernant cette vie. Tellement que pour dire ici Adieu à l’Amérique, je confesse en mon particulier, combien que j’aie toujours aimé et aime encore ma patrie, néanmoins voyant non seulement le peu, et presque point du tout de fidélité qui y reste, mais, qui pis est, les déloyautés dont on y use les uns envers les autres, et bref que tout notre cas étant maintenant Italianisé, ne consiste qu’en dissimulations et paroles sans effets, je regrette souvent que je ne suis parmi les sauvages, auxquels (ainsi que j’ai amplement montré en cette histoire) j’ai connu plus de rondeur qu’en plusieurs de par-deçà, lesquels, à leur condamnation, portent titre de Chrétiens.[5]
Les lignes suivantes, elles, font partie du chapitre XVI :
D’autant donc que quant à ce qui concerne la béatitude et félicité éternelle (laquelle nous croyons et espérons par un seul Jésus-Christ), nonobstant les rayons et le sentiment que j’ai dit qu’ils en ont, c’est un peuple maudit et délaissé de Dieu, s’il y en a un autre sous le ciel (car pour l’égard de cette vie terrienne, j’ai jà montré et montrerai encore, qu’au lieu que la plupart par-deçà étant trop adonnés aux biens de ce monde n’y font que languir, eux au contraire ne s’y fourrant pas si avant, y passent et vivent allègrement presque sans souci), il semble qu’il y a plus d’apparence de conclure qu’ils soient descendus de Cham […].[6]
Sans cesser d’être véridique, le témoignage fluctue, au gré de la subjectivité de l’auteur.
Léry fonde aussi une méthode historique. Par la pratique de l’autopsie, par la volonté d’imposer à ses allégations ce qu’on appelait la conférence, c’est-à-dire un contrôle comparatif par le récit d’autres chroniques de l’histoire universelle, Léry met en perspective son Histoire. Il compare ce que disent Flavius Josèphe (siège de Jérusalem), Chalcondyle (cruautés des Turcs et d’Amurat contre les Grecs), Bèze (horreurs des guerres de religion), et juge par d’autres cas d’anthropophagie celui des Tupinambas. Par ce qu’on appelle un effet boomerang, et qu’on retrouvera souvent, c’est le sauvage, que l’on tenait de prime abord pour inférieur, qui met en question l’Européen : l’anthropophagie du premier dépend de ses lois guerrières et d’un code de l’honneur, celle du second provient d’une barbarie extrême et anomale. On constate une aggravation du péché d’Adam dont la dégénérescence européenne est le signe. Comme Viret, Léry n’est pas loin de penser à la proximité de la fin des temps. En tout cas, l’histoire doit montrer que toute œuvre humaine est vaine et que la rédemption viendra pour les chrétiens d’un don gratuit.
L’Histoire d’un voyage et son devenir
Le récit de Léry est solidaire de l’Histoire nouvelle du Nouveau Monde, de l’Italien Girolamo Benzoni (1579), traduite par Urbain Chauveton. Léry et Chauveton militent contre le parti pro-espagnol qui sévit alors en France, en montrant le rôle important que des huguenots ont joué et qu’ils peuvent jouer encore pour coloniser une terre d’outre-mer où la tolérance soit possible. La compréhension dont Léry fait preuve pour les populations sauvages encouragera les pays protestants d’Europe du Nord dans leurs entreprises.
Montaigne suit Léry de très près dans son essai « Des cannibales » (I, 31). Lui aussi met en cause l’Européen dont il oppose le vice à la vertu naturelle de prétendus barbares. Le mythe du Bon Sauvage est né. On en connaît la fortune au siècle des Lumières ; Léry sera lu et cité en particulier par l’abbé Prévost et l’abbé Raynal (dans l’Histoire des deux Indes). Comme le remarque Frank Lestringant, éditeur de l’Histoire d’un voyage, le XVIIIe siècle a déformé le message ; il veut rationaliser ce qui échappe à l’interprétation, alors que le XVIe siècle se contentait de l’enregistrer. Léry et ses lecteurs des Lumières s’accordent, mais sur des prémisses divergentes : le pessimisme calviniste et l’anticolonialisme doctrinaire. Enfin, l’Européen libertin projette ses propres fantasmes érotiques sur le sauvage américain, ce que Léry, décrivant les mœurs sexuelles des Tupinambas, n’avait jamais fait. Notre auteur était destiné à rencontrer un meilleur lecteur : Claude Lévi-Strauss. L’un et l’autre ont travaillé sur le terrain, l’un et l’autre pratiquent à la fois la distance et la sympathie, l’un et l’autre, surtout, n’expliquent pas les sociétés qu’ils étudient par la nature. Malgré Montaigne, malgré Rousseau, foin du Bon Sauvage ! Les sociétés, quelles qu’elles soient, appartiennent à la culture. Même nus, les sauvages ne ressortissent pas à la nature :
[Je ne veux pas] en façon que ce soit approuver cette nudité [celle des Tupinambas] ; plutôt détesterai-je les hérétiques qui contre la Loi de nature (laquelle toutefois quant à ce point n’est nullement observée entre nos pauvres Américains) l’ont autrefois voulu introduire par-deçà.[7]
Pour le dire avec Lestringant, « telle est en définitive la plus haute leçon de l’œuvre de Léry : tournant le dos au mirage d’un âge d’or illusoire, auquel s’attarde au même moment Montaigne, et qui, pendant deux siècles encore, bercera les libertines rêveries des Philosophes, il considère dans les Tupinambas du Brésil une société indigène séparée de la nature et sans doute aussi du rachat. Ce pessimisme historique autorise une remarquable quiétude du regard. Surmontant la tentation primitiviste et débarrassé d’autre part du devoir de prosélytisme, Léry peut alors voir l’autre – pour la première fois »[8].
André Gendre
Rousseau fut l’accusateur de la société de son époque. Il en fut aussi le séducteur. Et il voulut en être, du fond de sa solitude, l’éducateur. Il sut déployer dans sa critique les formules les plus vives et les plus provocantes. Il opposa aux maux qu’il dénonçait les images d’un monde heureux, le tableau d’une société juste, les principes du gouvernement légitime. Dans un langage chargé d’antithèses qui ne laissent pas immédiatement percevoir les dépassements et les conciliations proposés, Rousseau développa une pensée dont il revendiqua, notamment dans ses Dialogues (1772-1776), l’aspect systématique. Et c’est bien là un système, dont il fait remonter la genèse à la vision subite d’un ensemble de vérités : à l’« illumination » qui fit irruption en lui sur la route de Vincennes, en septembre 1749. L’ampleur et la cohérence de ce système, épars en plusieurs ouvrages publiés entre 1755 et 1762, ne furent pas immédiatement reconnus. Kant sut en saisir les thèses essentielles et les organiser. Mais il n’en alla pas de même pour tous les lecteurs. On ne retint de Rousseau que quelques traits isolés et quelques images simplifiées. Les malentendus furent longs à se dissiper, notamment ceux qui réduisaient Rousseau à la seule idée du « retour à la nature ». Les grandes vues d’ensemble sur la pensée de l’écrivain datent du XXe siècle.