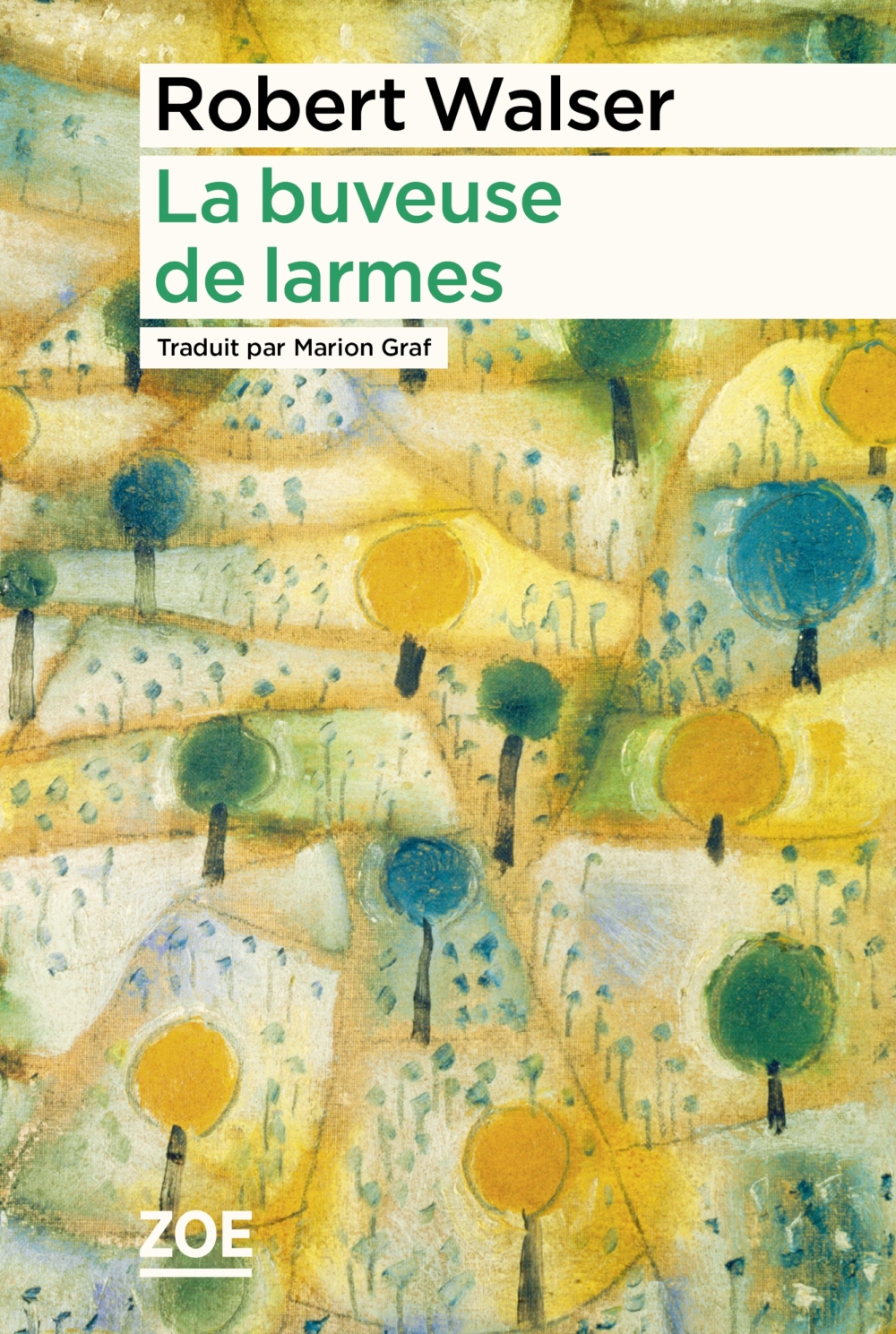I Jeunesse et Berlin
1
À sa sœur Lisa
Zurich, le 30 juillet 1897
Chère Lisa!
Je pense à l’instant à ta dernière gentille lettre qui, je dois le dire, m’a arraché un soupir, peut-être même deux. Bon, abstraction faite du soupir, c’était une gentille lettre et elle m’a fait plaisir ! Comment vas-tu maintenant ? Et quel plan as-tu déjà esquissé pour ton proche avenir ? Quand tes études vont-elles commencer et dans quelle ville, où penses-tu aller étudier ? Et quelles fleurs encore, sur les rameaux de tes plans ? Tout cela m’intéresse beaucoup ! Vas-tu venir à Zurich, peut-être? Faut-il que ce soit Berne ? Je te prie de me donner quelques explications.
J’ai faim ! Et chaque fois que j’ai faim, j’ai envie d’écrire une lettre ! À n’importe qui ! C’est facile à comprendre! Le ventre plein, je ne pense qu’à moi, jamais à autrui. Je suis donc plus heureux le ventre plein ! Car il n’y a pas de bonheur à languir après quelque chose de lointain! Je me trouve à présent à un stade dont j’aimerais bien, dont j’aimerais beaucoup parler avec toi dans cette lettre verte, si seulement je le pouvais. Mais je vais essayer : pour ce qui est de la Sehnsucht, du désir ardent, c’est premièrement quelque chose de superflu, deuxièmement, quelque chose de compréhensible, et troisièmement, quelque chose d’incompréhensible ! Superflues ces aspirations les sont parce qu’elles ne font que nous troubler, compréhensibles, elles le sont aussi bien que la maladie ou le péché sont compréhensibles; mais incompréhensibles, elles le sont parce que tant de gens ne peuvent pas vivre sans ce superflu, parce que tant de gens s’adonnent à ces aspirations, se consument de désir et ne sortent plus du désir, y trouvant même une sorte de douceur. Le fait que les hommes aient un penchant si fréquent et si marqué pour quelque chose de douloureux, quelque chose d’aussi épuisant que le désir, c’est bien là notre côté maladif ! Le christianisme est la religion du désir ! Pour cette raison déjà, cette religion est si peu naturelle, si indigne de l’homme ! Tel homme qui s’est débarrassé du désir a mieux fait que tel autre qui a écrit cent chansons bien rimées, mais pleines de vagues aspirations. De telles chansons ne devraient pas être imprimées du tout. La police, ici, devrait intervenir avec détermination ! Oh, Uhland et consort ! Mais en voici assez pour aujourd’hui ! Ah, que vais-je manger ce soir ? Question difficile, par les temps de mangeaille qui courent ! Tu vois, là, le désir le plus ardent ne sert à rien ! Est-ce que le désir d’un rôti savoureux et d’un verre de Valteline me procurera l’un et l’autre ? Le désir aura-t-il peut-être pour effet que je n’aie pas des choses aussi ennuyeuses à manger que d’habitude ? Seule l’action peut être de quelque secours, ici ! Et la prochaine fois, je disserterai sur l’action ! Adieu !
19
À sa sœur Lisa
[Zurich, 1902/1903]
Chère Lisa,
Non seulement tes lettres m’ont fait plaisir, mais encore, elles m’ont bien fait réfléchir. J’aurais tant de choses à te dire, tant de choses à te demander. Si seulement les journées n’étaient pas aussi courtes. C’est souvent effrayant. La vie t’est-elle aussi insupportable, souvent ? Oui ? Souvent ? Qu’y faire ? Veux-tu venir chez moi ? Avec mes 150 – fr. de salaire, je pourviendrai à nous deux. Nous mangerons comme à Täuffelen, peu, mais bien. Tu feras la cuisine et tu t’occuperas du petit logement, une cuisine et deux ou trois pièces. Je serai aux petits soins! Le crois-tu ? Je parodierai Widmann pour te faire rire. Il y a souvent de quoi rire, ici. C’est une ville si folle, si légère. On y pleure en douceur et en beauté. Tu pourrais peut-être aussi gagner un peu d’argent chez des maîtres distingués. Ou bien allons-nous tous les deux prendre un emploi pour une vie entière, toi comme bonne, moi comme chien ? Pour ma part, au moins, je rêve toujours d’une telle chose. Il faut tout trouver beau. Il ne faut rien vouloir fuir. Ton destin me touche beaucoup. Tu sais, j’aime tellement les filles qui souffrent. Sinon, je suis un forban sans cœur, mais là, alors ! Veux-tu abandonner ta patrie ou ton bien-être ? N’arrives-tu plus à te sentir bien à Bienne ? Tu vois, je comprends très, très bien tes douleurs. On en parlera. Surtout, ne pas penser. Chère Lisa, voilà le plus grand péché qui soit. Plutôt la débauche que la tristesse. Dieu hait les tristes. Mais tout va si vite. On meurt si vite. Juste devenir idiot. Il y a quelque chose de merveilleux à devenir idiot. Mais il ne faut pas le vouloir, cela vient tout seul. Pense que je suis ton frère fidèle. Faut-il te dorloter, comme un tout petit enfant malheureux ? Je suis bien en état de le faire. Je le peux. Ton Robert
50
À Christian Morgenstern
Charlottenburg, Kaiser-Friedrichstr. 70 IV
[fin nov. 1906]
Cher Monsieur,
La démarche auprès de Mlle Dernburg s’est conclue par le fait qu’elle m’a remis deux livres à lire. Il est toujours précieux de faire de nouvelles connaissances, et cette dame est très intelligente. Je vous remercie de tout cœur pour votre dernière lettre et pour la recommandation. Je vais sans doute repartir bientôt, probablement pour Zurich, qui de tout temps, a été pour moi une station très agréable, où j’ai toujours très bien pu penser à l’avenir. Il ne faut pas écrire trop de romans d’affilée, c’est après tout une activité pénible, qui nécessite un feu toujours renouvelé. Je dois abandonner l’idée de partir dans les colonies, il en coûterait beaucoup d’argent, et surtout, trop de temps. Il ne faut pas fuir aussi loin, sans quoi on risquerait vraiment de perdre le contact avec tout ce qui nous lie encore à l’art et à la vie artistique. De plus, c’est tout aussi beau de n’être rien, cela implique une ardeur plus haute que d’être quelque chose. Un métier pour la vie est une chose encombrante et belle à la fois, une conclusion, mais qui aimerait conclure, et moi donc ! non, l’Afrique, je n’en ai pas envie pour l’instant et je n’ai pas à en avoir envie. Je considérerais comme une expérience plus profonde de me retrouver en prison, mais je dis-là des folies. Que faites-vous de vos journées et comment vous portez-vous ? Bien, je l’espère. Ici, il ne se passe pas grand chose, M. Frisch a gardé le lit quelques jours, les Kammerspiele ont obtenu des critiques élogieuses et Kerr est devenu presque fou, assoiffé qu’il est de beautés à la Duse, qui d’ailleurs jouerait actuellement encore mieux que jamais, elle donc, la Duse, pas les beautés. Je n’écris rien en ce moment, mais peut-être que je vais très bientôt me remettre au travail, et je le ferai alors comme un tigre dépèce une proie. Oui, c’est bien ça, l’esprit doit être comme des griffes et une illusion d’une chose doit nous habiter comme une soif de sang, et on se jette dans le travail dans ce but. Par là, je veux juste dire que je me réjouis terriblement de me remettre au travail.
Bien cordialement à vous, portez vous bien, votre Robert Walser
II Bienne
115
Aux Éditions Rascher
Bienne, le 5. 10. 16
Monsieur,
En réponse à vos messages du 29. 8. et du 1. 9., j’ai fait preuve de diligence, comme vous le voyez, et je vous remets ici, comme contribution à la Collection « Schriften für Schweizer Art und Kunst» un travail de 18 pages intitulé
Morceaux de prose
Vous voudrez bien m’adresser confirmation immédiate de leur bonne réception[1]. Nous nous sommes mis d’accord quant aux conditions, et je crois pouvoir encore déclarer que les conditions posées sont modestes. C’est exactement la somme que je devrais demander pour des textes déjà publiés ailleurs. Je vous demande de lire le présent ouvrage, auquel je vous prie d’accorder tous vos soins, du moment que je crois être en droit de lui attribuer beaucoup de valeur, et de bien vouloir me communiquer le plus rapidement possible votre précieuse décision. – Je souhaiterais que ce travail soit publié le plus rapidement possible, et j’insisterais alors vivement sur un travail de correction soigneux. En cas d’accord, vous m’enverrez promptement les épreuves.
Sans aucun doute, une table des matières des différents morceaux enjoliverait et agrémenterait ce petit livre, et chaque pièce devrait commencer à une nouvelle page, cela aurait alors bonne allure. De manière générale, je suis d’avis que ce petit livre produira une bonne impression, et que son contenu ne restera pas sans effet.
Ce travail que je vous confie, je puis dire avec une ferme conviction que je le tiens pour bon, et de ce fait, je vous le propose avec pleine confiance. Chaque morceau est écrit avec une attention inflexible et une vigilance des plus pointilleuses, et j’ai mis tous mes soins à produire quelque chose de solide à votre intention.
Les morceaux sont de nature tantôt sérieuse, tantôt gaie, mais ils atteignent tous à une qualité tout à fait certaine, j’en suis persuadé.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueusement amicaux, Robert Walser
161
À Frieda Mermet
[Bienne, septembre ? 1918]
Chère Madame Mermet,
Je vous remercie cordialement pour les bonnes choses comme le fromage, le beurre, les tranches de jambon et de beefsteak, et pour le pain, autant de bonnes choses dont je me suis régalé. Être lié à une femme aussi bonne est un plaisir, croyez-moi. Un peu de beurre sur du pain, voilà un repas délicieux, et l’humanité est trop stupide de vouloir se gâcher tout ce qui est bon et sain. On ne voit de tous côtés que têtes de linottes et têtes de moutons. Des ânes qui courent dans des fabriques pour fabriquer des munitions, et d’autres ânes et des moutons en quantité. Cent millions de stratèges à des tables où il n’y a plus rien à manger. Tout un écheveau de faiblesse et de fainéantise. La misère qui se répand actuellement dans le monde entier a l’air d’être un châtiment divin, parce que tout ce qui est beau, bon et sacré est aussi méprisé par les hommes. Des enfants, chère Madame Mermet, des petits enfants, de stupides petits garnements avec leurs gamineries dans leurs petites caboches, dirigeraient et mèneraient mieux le monde que ces maigres conducteurs des États et du monde d’aujourd’hui, ou alors, des femmes comme vous ou comme tant d’autres, devraient être reines, souveraines, c’est ue chose évidente à mes yeux. Les hommes courent en tout cas à une catastrophe épouvantable, avec toutes leurs sottises, faiblesses éhontées. Oui, on le voit aujourd’hui et on peut le toucher du doigt, où cela mène quand les hommes rejettent tout ce qui est grand pour ramper comme des fourmis dans la mesquinerie et l’indignité. Tous ces soldats sont des benêts plutôt que de vrais soldats, et tous les enfants sont trahis par ces imbéciles d’adultes parce que les adultes sont plus infantiles que les enfants. Mais au lieu de débiter ainsi toutes sortes de choses que vous n’appréciez peut-être pas beaucoup, je préfère vous dire que je continue à penser à vous chaque jour et que vous êtes belle et chère à mes yeux et dans mon for intérieur. Hier je suis allé dans les pâturages de Studtmatten, dans les noisetiers. Flâner ainsi entre les doux buissons est charmant. J’ai aussi ramassé des faînes, et j’ai songé à l’automne dernier, où il faisait si beau sur le Montbautier, lorsque nous cueillions des noisettes. Je vous remercie de votre lettre où vous défendez l’idée que nous nous entendrions bien si nous pouvions bavarder ensemble. Je suis entièrement de votre avis et je le crois aussi, et je trouverais beau de m’entretenir avec vous paisiblement dans une jolie pièce. Cela pourrait durer des heures, et nous ne nous ennuyerions sûrement pas, et je présume que vous, vous ririez souvent. Espérons que nous trouverons bientôt une telle occasion. Entre-temps, je continue à bien vous aimer et reste avec mes cordiaux messages
votre Robert Walser
III Berne
266
À Max Rychner (rédaction de Wissen und Leben)
Je viens de redéménager.
Berne, Thunstrasse 20 III [septembre 1925]
À la rédaction de Wissen und Leben
à l’attention de mon irremplaçable
dr. Mäxchen Rychner
à Zurich, arrondissement Inteligentika
Cher Monsieur,
J’ai considéré comme judicieux de proclamer et de faire savoir à Vienne, dans le style impérial, que vous avez dit que j’étais quelque chose comme un Shakespeare de la petite prose. À Bienne, dans ma jeunesse, je me rendais parfois dans la confiserie Piécette pour acheter des pièces à dix ou à vingt. Moissi un jour m’avoua qu’il aimait beaucoup Bienne et je vous avoue pour ma part que votre lettre m’a fait plaisir, dans laquelle vous avouez à votre tour que vous prendrez le manuscrit que je vous ai envoyé très civilement. Max Brod, lui aussi docteur et Mäxchen, mais quant à lui rédacteur au Prager Tagblatt, loue mes vers, ce que je n’aurais pas dû vous dire, au fond, mais du moment que cela me fait plaisir, je tombe dans une humeur potinière que vous aurez la bonté de me pardonner. J’ai envoyé à Berlin une étude littéraire de grandes dimensions, en quelque sorte bien dressée, corsettée. Il semble qu’une revue est en train de voir le jour là-bas. Je demeure, mon cher ami, si vous me permettez de vous donner ce titre, cent mille fois votre obligé et vous envoie un salut grandiose, votre Röbeli Wauser
269
À Therese Breitbach
Berne, Thunstrasse 20 III
[mi-octobre 1925]
Rösi Breitbach !
Très honorée Mademoiselle,
Formant le vœu que si cela vous est possible intérieurement, vous donniez simplement, et généreusement et gentiment mes lettres à lire à vos parents, j’aimerais vous faire savoir que pendant un certain temps, je n’avais plus ici aucun sujet poétique, du moment que j’ai déjà tellement écrit, vous me comprenez. J’ai alors lu par hasard un jour un petit livre tout bête, de ceux qu’on achète pour trente centimes au kiosque, et cette lecture a représenté pour moi une distraction très agréable. J’étais un peu saturé de bons livres. Est-il imaginable que vous me compreniez ici ? Si tel était le cas, cela serait très gentil de votre part. Toutes les jeunes filles d’ici me trouvent terriblement ennuyeux, parce qu’elles sont toutes immensément gâtées par des jeunes gens géniaux et pleins d’élan. Notre monde masculin dispose d’une assurance très marquée dans sa façon de se présenter en public. Un jour, je me suis permis, par exemple, d’envoyer à l’une des cantatrices de notre méritant théâtre de Berne, en signe d’admiration, un exemplaire des Rédactions parues chez Kurt Wolff. Le livre m’a été retourné avec la remarque que je ne savais pas encore du tout écrire en allemand. On me considère ici comme un élément à tous égards encore immature. Il y a aussi Thomas Mann, vous savez, ce géant dans le domaine de l’écriture romanesque, qui lui me considère au moins comme un enfant très futé. À Zurich, je devais faire une lecture de mes livres publiés, mais le président du cercle littéraire a prétendu que j’étais tout à fait incapable de parler allemand. Un temps, ici, on me prenait pour un fou et quand je passais, on disait à voix haute sous les arcades : il faut le mettre à l’asile. Notre grand écrivain suisse Conrad Ferdinand Meyer, que vous connaissez certainement, a aussi passé un certain temps dans un sanatorium pour ceux qui psychiquement, ne sont plus tout à fait à la hauteur. À présent, on célèbre le centenaire de ce pauvre homme avec des discours et des déclamations hymniques. Et lui, à l’époque, osait à peine prendre la plume, de crainte d’être un vil bousilleur de papier. Un beau jour, je suis entré dans un café et je suis tombé amoureux d’une petite jeune fille qui avait l’air très romanesque, ce qui bien sûr était de ma part une grande sottise, toutes les natures utilitaires m’ont sauté dessus et m’ont rappelé les nobles obligations de mon métier si beau et précieux, qui a la propriété de ne pas rapporter d’argent. J’aimais cette belle jeune fille, qui semblait déjà tendre à la corpulence, en conséquence de la musique que j’entendais tous les jours dans ce café. Grand est le pouvoir de la musique, ou même, parfois, immense. Soudain, tout a basculé, j’avais fait la connaissance d’une sorte de fille de salle, autrement dit d’une serveuse, et dès lors, la première n’exista plus pour moi qu’à moitié, ou même plus du tout. Aimer et ce qu’on appelle être amoureux sont deux états très, très différents, deux mondes différents. Dès lors, je pris l’habitude d’aller souvent dans la nature, c’est-à-dire dans la campagne, où je trouvais passablement d’inspiration, des idées que je creusais. Entre-temps, elle quitta la salle où elle servait, et dès lors je ne la vis plus ; je me mis alors à lui consacrer des poèmes, mais il y a maintenant chez nous et sans doute aussi chez vous beaucoup des gens qui estiment que les poèmes ne sont pas un travail, mais bien plutôt quelque chose de bizarre, de méprisable. Il en a toujours été ainsi au pays des écrivains et cela restera ainsi. Notre ville est très belle. Je me suis baigné aujourd’hui dans une eau délicieusement froide, par un soleil discret, subtil, dans le fleuve qui circonscrit notre ville en scintillant comme un serpent. Personne ne sait rien bien sûr de celle que j’ai d’une part cruellement raillée dans ma prose pour d’autre part, la porter aux nues dans mes vers. J’ai logé dans des chambres dans lesquelles, des nuits entières, la peur m’empêchait de fermer l’œil. Aujourd’hui, la situation est la suivante: je ne sais plus très bien si je l’aime encore. C’est un fait, chère Mademoiselle, qu’on peut tenir des sentiments bien en éveil, ou les laisser refroidir, les négliger. Et puis il y a bien d’autres choses qui retiennent notre attention. Dans l’espoir que vous êtes sereine, que les jours s’écoulent pour votre plaisir et que vous êtes un peu contente et peut-être aussi un peu mécontente de cette lettre, je vous adresse mes salutations cordiales, et pour ainsi dire naturellement respectueuses, Robert Walser
IV Waldau
365
À Therese Breitbach
Berne, Luisenstr. 14 III [Waldau]
le 23 décembre 1929
Chère, très honorée mademoiselle,
J’ai reçu votre lettre dans le courant de l’année qui touche à sa fin. Espérons que vous ne m’en voulez pas trop de ne pas vous avoir écrit depuis longtemps, cela s’explique par le fait que je vis maintenant à l’extérieur de la ville, dans une maison de repos admirablement située. Je suis en parfaite santé et en même temps très sérieusement ou gravement malade, et là vous pourrez m’excuser d’avoir tout d’abord éludé votre question. Votre frère est donc reparti pour Paris. J’aimerais aussi aller à Paris, mais pour l’instant, cela m’est impossible. Le printemps, l’été et l’automne ont été très beaux ici, c’est maintenant l’hiver, et je continue à décocher quelques petits travaux dans quelques journaux de votre patrie. Comment vous plaît l’endroit où vous vous trouvez actuellement ? La Prager Presse[1] a presque cessé de publier mes textes. Actuellement, la radio joue un certain rôle par rapport à la littérature. On dirait que votre frère est devenu un véritable écrivain. J’ai eu l’occasion d’apprendre ici à jouer au billard et de renoncer complètement à l’alcool, par exemple. En ville, stupidement, je buvais un peu trop. C’est venu ainsi, sans que je m’en rende compte, alors qu’autrefois, j’étais un des plus endurants de Suisse. En général, je vais d’ailleurs très bien et j’espère qu’il en est de même pour vous. On peut apprendre à se passer d’énormément de choses et se sentir bien. Chaque jour, je me rends utile la moitié de la journée, c’est-à-dire pendant trois heures, au jardin ou ailleurs, à l’extérieur. Ma maladie est une maladie de la tête difficile à définir. Il paraît qu’elle est incurable, mais elle ne m’empêche pas de penser à ce qui me plaît, ou de compter ou d’écrire ou d’être poli avec les gens ou d’apprécier les choses, par exemple un bon repas, etc. J’ai écrit ici près de Berne, comme en avant-poste, une série de nouveaux poèmes. Aimez-vous votre travail ? Je le souhaite vivement et vous souhaite par ailleurs de joyeuses fêtes et une bonne année. Et je reste avec mes salutations cordiales votre Robert Walser
V Herisau
411
À Carl Seelig
Herisau
[date ajoutée par le destinataire : 10 juillet 1949 ?]
Cher Monsieur Seelig,
Tout en vous remerciant pour votre offre, je préfèrerais que vous veniez me voir une autre fois, un dimanche, du moment qu’en semaine, j’ai toujours passablement à faire.
Avec les cordiaux messages de votre très affectionné
Robert Walser
[1] En 1929, la Prager Presse publie 3 poèmes et 6 proses de Robert Walser, elle en publiera bien davantage durant la seconde moitié de son séjour à la Waldau : entre 1929 et 1933, ce seront en tout 42 poèmes et 31 proses.
[1] « Morceaux de prose » paraît en novembre 1916 chez Rascher, la couverture est illustrée par Karl Walser.