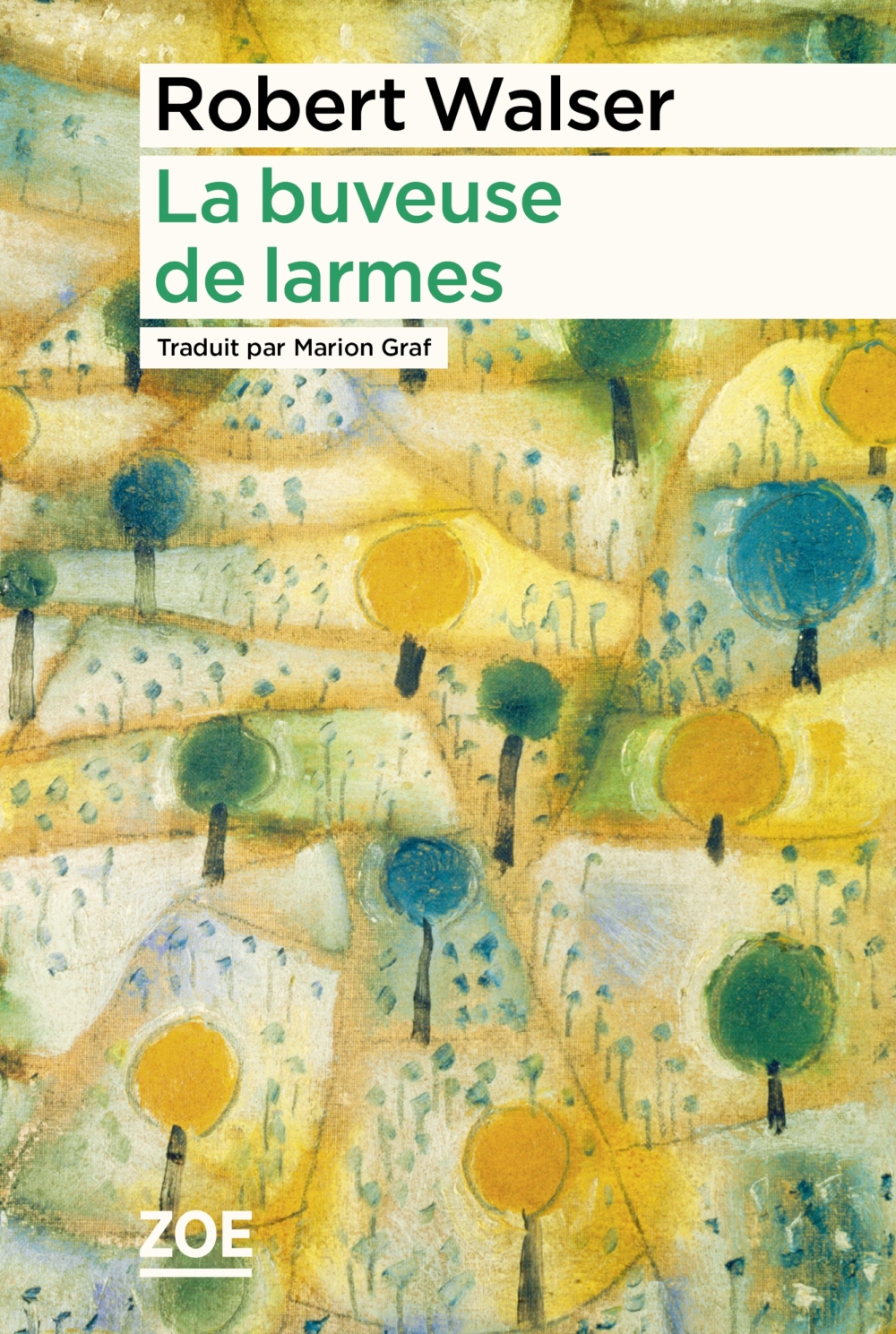intrigues amoureuses.
Il habite à Berne où il loge dans des chambres louées dont il déménage fréquemment. Mais à partir de 1929, à la suite de crises d’angoisse, il entre de son plein gré à l’hôpital psychiatrique de la Waldau d’où il continue à écrire et à publier avant son silence définitif dès 1933.
Quels sont les livres qui l’inspirent ? La curiosité de Marion Graf l’a conduite à découvrir que dans ces années-là, Robert Walser était un grand lecteur de petits romans sentimentaux français, publiés en petit format pour un prix dérisoire. Il les achetait à la gare de Berne. Pourquoi Walser s’intéressait-il, comme lecteur, à des romans à l’eau de rose venus de France ? Pourquoi pas à la littérature populaire de langue allemande ? C’est le propos de son essai, illustré par trois exemples de proses walsériennes publiées en 1928 et1929.
Walser grand lecteur, des classiques aux contemporains, refuse la ségrégation entre bonne et mauvaise littérature. Il met en doute la possibilité de tracer une frontière entre elles. Il observe alors que la littérature cultivée tend nécessairement à s’étioler, à s’éloigner de son public, et il a l’espoir que la littérature populaire pourra contribuer à la revivifier.
Or le roman sentimental français de la Belle Epoque ne ressemble en rien au roman populaire allemand d’alors, le fameux Heimatroman qui célèbre les valeurs de la famille, de la pureté campagnarde et du chauvinisme. Les «Petits livres» français, c’est le nom de la collection, font entrer le lecteur dans un univers urbain de la petite bourgeoisie pour y vivre, aux côtés d’héroïnes modernes, des intrigues psychologiques et sentimentales qui culminent dans des scènes mélodramatiques jusqu’à un épilogue qui marque nécessairement le retour à l’ordre. Cet univers-là est plus proche de Walser. Il se délecte à y entrer, à commenter l’intrigue à sa manière imaginative en la prolongeant et la détournant de son premier objectif moral.
Trois exemples :
1.
À PROPOS DE DEUX PETITS ROMANS
1929
«Ici ou là, je lis des petits romans que l’on peut acheter pour trente centimes. Les petits volumes comptent à peu près quatre-vingt pages et je trouve qu’ils valent la peine d’être traités avec attention. L’un de ces récits s’appelle « Le Semeur de larmes », il est rédigé par quelqu’un qui peut-être n’écrit des livres qu’en à-côté, probablement pour son plaisir personnel. L’auteur a la gentillesse de conduire le lecteur qui suit de bonne grâce ses indications d’auteur dans un milieu qui peut être nommé un milieu d’avocats. Un papa possède une épouse et deux filles adolescentes. Quant au semeur qui disperse les épreuves etc., qui fourre toutes sortes d’idées dans les petites têtes, on pourrait dire qu’il subit au jeu une malchance qui le laisse froid. Il gaspille l’argent dont il ne semble pas exactement savoir d’où il lui est venu. Dans tout ce qui ressemble à l’amour, il se distingue par un succès visible. Les cœurs tendres, vacillants, l’adorent, lui attribuent de la beauté et de la bonté. Les deux filles d’avocat brûlent pour lui, car il leur paraît terriblement mondain. La maman l’avait embrassé, s’était laissée embrasser par lui bien avant que les filles s’en doutent. Qu’il ait en lui quelque chose de quasiment démoniaque, il le prouve dans une chambre d’hôtel en faisant savoir à la plus douée, la plus éduquée, la plus importante des deux filles, qu’elle se trouve en son pouvoir. Elle ouvre les yeux les plus étonnés qui soient à cette révélation. « Abject individu », chuchote-t-elle, et elle est assez fière du tremblement de son chuchotement et du chuchotement du tremblement de tous ses membres. D’ailleurs, le fait d’être livrée à son arbitraire lui paraît follement intéressant. Heureusement, il n’arrive rien de grave à cette occasion. La jeune fille est arrachée à temps aux griffes ou aux serres du tigre. La petite maman paie au gracieux voyou une coquette somme tout en lui disant : « Je vais ai aimé. Je vous ai considéré comme aussi séduisant que remarquable. Prenez ce que je vous offre ici et disparaissez de notre cercle. » Il ne se le fait pas dire deux fois, il décampe en emmenant une femme de chambre qui semble fort bien convenir comme compagne de voyage. Hop, les voici installés dans un wagon, en première classe, même, et la famille qui se voit délivrée du distributeur de larmes et dispensateur de mauvaises expériences est confortablement assise autour du thé de cinq heures et échange des souvenirs.
Y eut-il jamais amour plus rose, plus vibrant d’espoir, que celui qu’éprouvaient l’un pour l’autre une jeune fille bourgeoise et un jeune musicien misérable ? Ils s’aimaient d’une façon carrément provinciale, mais elle était pauvre et lui aussi. Pauvre de fond en comble, non, elle ne l’était pas, mais ses parents avaient fait des dépenses, depuis longtemps, qui allaient bien au-delà de leur revenu, je veux dire qu’ils faisaient sortir leur fille avec de riches jeunes gens qui cependant ne lui faisaient pas une impression favorable. Elle voulait son musicien ; mais on le lui interdisait. Lorsque vaillamment, il vint demander sa douce main, il lui fut répondu : « Ne voulez-vous pas plutôt renoncer à cette intention en soi certainement honnête ? » Elle devait faire un riche mariage, par conséquent, il chercha des richesses afin d’acquérir un droit sur elle. Un soir, il se trouva, avec ses brillantes qualités, qui semblaient le rendre encore plus beau qu’il ne l’était déjà, dans le salon d’une obligeante demi-mondaine qui lorsqu’elle l’eut aperçu, se proposa de le prendre sous sa protection autant que possible. Une chanteuse du Grand opéra était présente, parmi d’autres. Lorsqu’elle eut chanté, ce fut au tour d’une danseuse, et lorsqu’elle eut fini sa danse, le musicien commença de jouer, et il joua si merveilleusement bien et si agréablement que la jolie maîtresse de maison en pleura de plaisir. Elle se figurait que son âme s’était transformée en une prairie couverte de rosée matinale. Lorsqu’il eut terminé, elle le nomma en pensée un brillant concertiste et lui fit un compliment parfumé de bonté, avec un sourire obligé. Par hasard, elle possédait un précieux collier de perles et comme lui, nous le savons déjà, avait le dessein de devenir riche, nous allons couper court et dire ouvertement et franchement qu’il l’emporta illicitement chez lui. On trouva bientôt sa trace. Il se vit obligé de comparaître devant sa protectrice avec un sentiment d’oppression, et d’avouer son crime, ce qu’il exécuta avec tant de gentillesse et de sincérité qu’elle crut avoir des raisons de lui demander de prendre place à côté d’elle, sur le canapé. Une demi-heure plus tard, ils étaient dans les bras l’un de l’autre et se dévoraient de baisers sur les lèvres, tant ils trouvaient merveilleux, après tout ce qu’ils avaient vécu, de se trouver charmants. On se fait parfois d’autant plus confiance que l’on était méfiant. Ils se remerciaient de tout cœur et savaient à peine de quoi, pour tout dire. Elle lui pardonna non seulement une fois, mais vingt ou cinquante fois son forfait inconsidéré, et le nomma dans son cœur son bienfaiteur, quand bien même c’était elle, en fait, qui était sa prévenante bienfaitrice. Soudain, pourtant, il lui avoua qu’il aimait avec une extraordinaire ténacité une jeune bourgeoise qui figurait pour lui le comble du bonheur. À cet aveu, elle commença par faire la grimace. Mais en voyant qu’il était sérieux et lorsqu’il lui eut raconté qu’il ne lui manquait que cent mille francs à peu près pour pouvoir épouser l’élue de son cœur, elle déclara : « Je vais vous procurer ce qui vous manque. » Apparemment, cela lui faisait plaisir d’être généreuse. Elle souhaitait faire le bonheur de son bien aimé. Un oncle de la jeune fille qui avait beaucoup d’argent était du nombre des admirateurs de la demi-mondaine. Elle lui laissa entrevoir qu’elle deviendrait sa femme s’il voulait bien être gentil. Elle l’instruisit de ses conditions, auxquelles, après quelques hésitations avunculaires, il accéda volontiers. Il paya, et les deux couples furent contents. L’histoire s’appelle « Le Pardon dans un baiser ». Je l’ai trouvée agréablement racontée. Comme elle me plaisait, elle m’a suffi.»