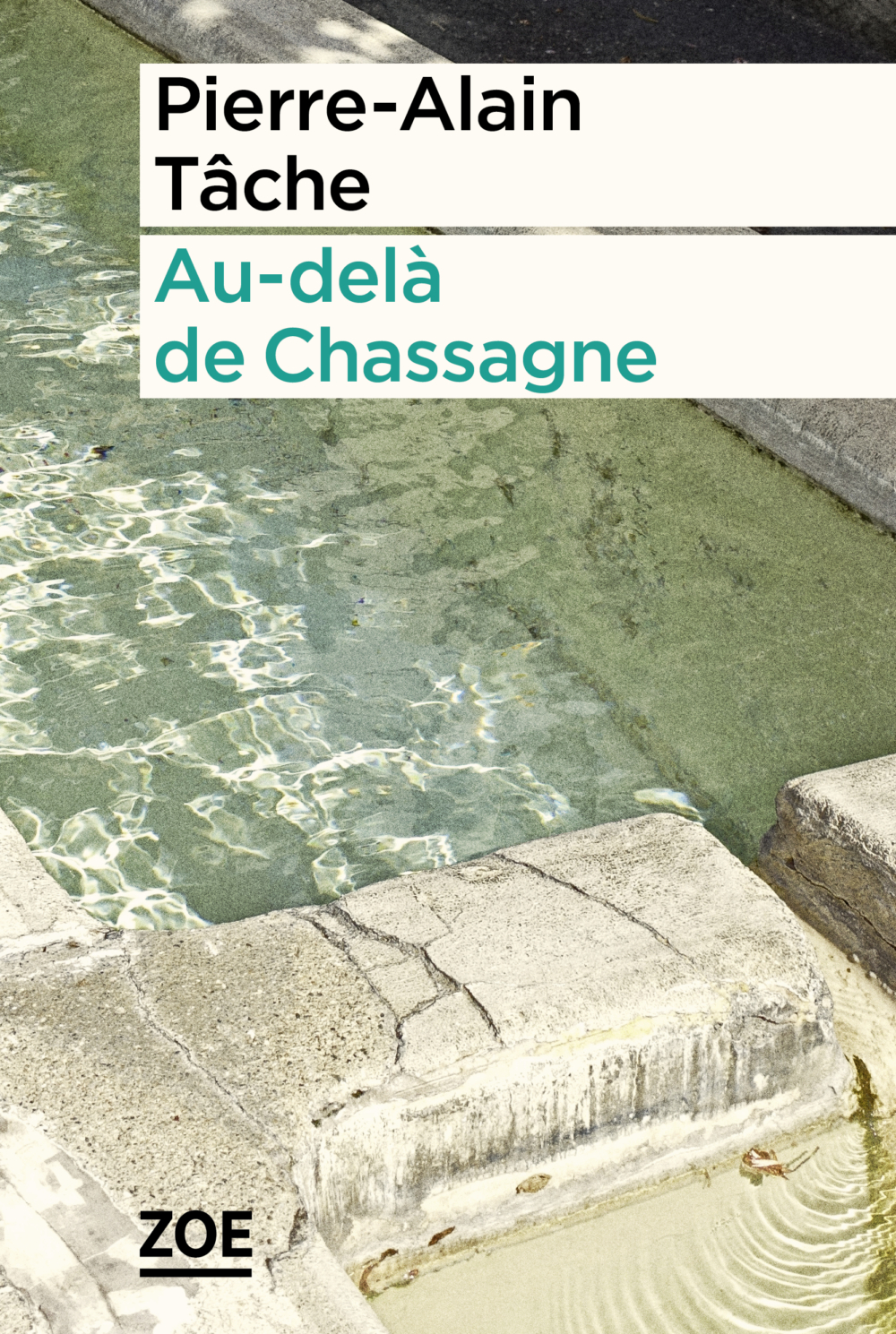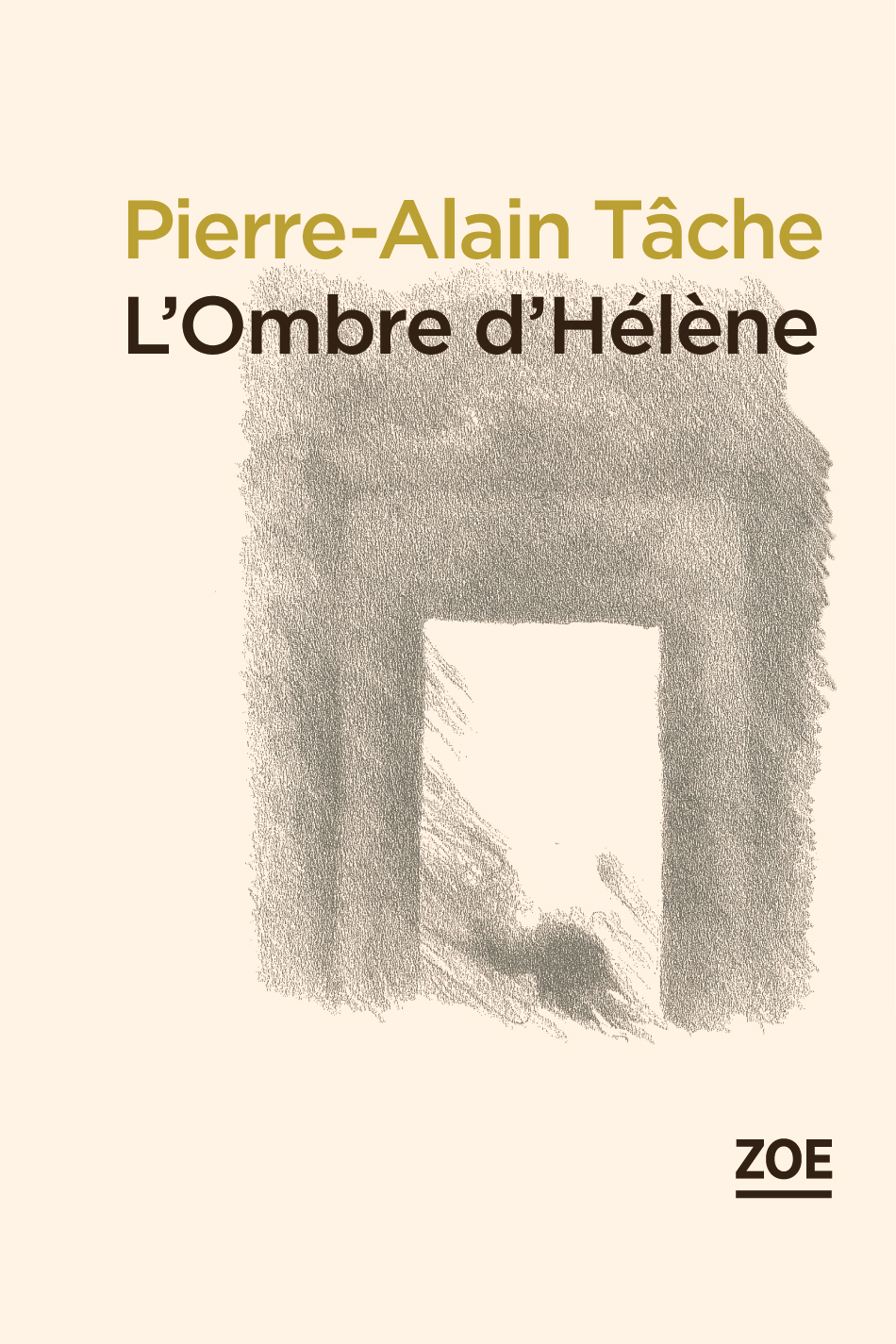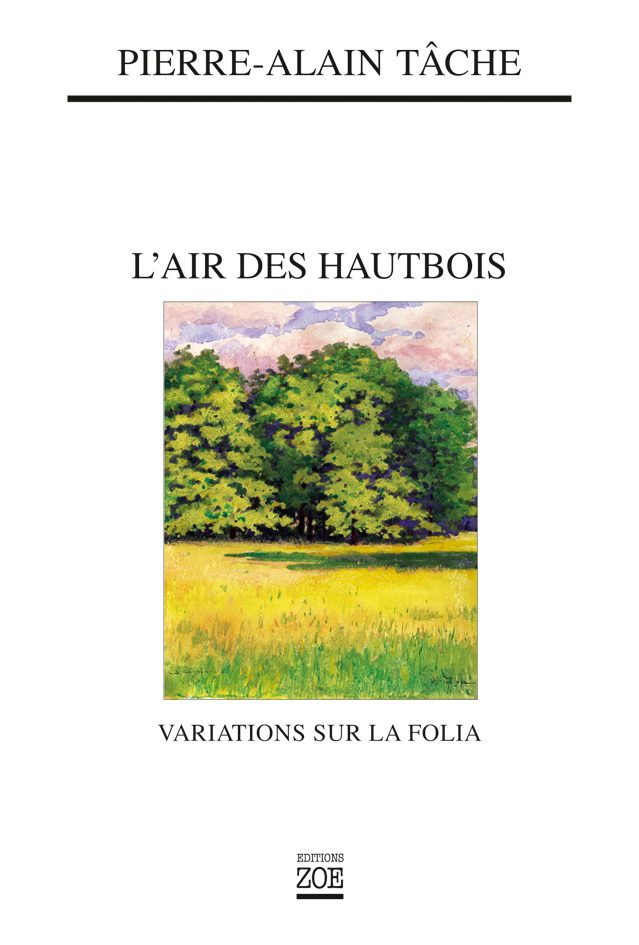Mes adhésions, comme on l’aura compris, sont assez rares, mais puissantes. Elles impliquent l’émotion plus que la raison. Elles surviennent d’ailleurs, généralement, dans l’ignorance ou dans la négation d’un texte qui les rattacherait à une espèce connue, à un genre déterminé – pour parler comme un botaniste ! La classification viendra après coup, à supposer que j’en éprouve le besoin ; elle sert alors à dissiper le flou suscité par l’accumulation des découvertes et des expériences. Mais l’œuvre demeure toujours l’objet de ma préoccupation première ; elle reste sur le devant. Si bien qu’il m’importe peu, par exemple, qu’un tableau relève du cubisme ou de l’expressionnisme allemand. Je ne le vois ni ne l’interroge à raison d’une telle appartenance – même si, pour certains, il est d’un grand secours, apparemment, qu’un tel rattachement soit envisageable. À cela s’ajoute que mes vraies rencontres (celles qui auront incontestablement compté) ne sont jamais la conséquence, et comme la consécration, d’un intérêt marqué pour une démarche dont je me serais tenu informé. Car l’œuvre d’art n’est pas là pour vérifier ce que j’ai lu ou pour se conformer au savoir que j’ai d’elle. Elle s’offre à ma curiosité, à ma libre attention ; s’impose-t-elle à moi, ce sera par quelque élément qui lui appartient en propre et qui est donc consubstantiel à ce que je vois. Tout le reste est mise en réseau, organisation d’une connaissance, culture – et je ne m’en détourne nullement ; mais cela vient en plus – et après.
Il se pourrait, en conséquence, que la sévérité dont je fais preuve face à beaucoup d’œuvres contemporaines soit tenue pour la conséquence d’une position dogmatique (ce que je n’ai pas sérieusement envisagé de prendre en considération, dans un premier temps). Elle paraîtrait alors être le reflet de principes affirmés de manière péremptoire, quand il s’agirait plutôt, selon ce que je puis percevoir, d’une défense plus ou moins consciente, plus ou moins agissante, de ma sensibilité. Je tends sans doute, pour rester maître de ma propre création, à me replier sur moi-même. Mais n’est-ce pas aussi une manière d’entrer en résistance ? Une résistance qui, je m’en avise, n’a pas pour vocation première de s’en prendre aux idées ou aux valeurs relayées par les œuvres qui me sont proposées (et donc d’instaurer avec elles une relation dialectique). Car de cela, je serais, le plus souvent, incapable, au motif que ce n’est pas du domaine de ma compétence. Je ressens plutôt devoir refuser, malgré tout ce que l’on peut m’avoir dit, que l’œuvre en soit réduite (du moins dans les cas extrêmes) à se réclamer en vain de son fondement textuel ou à désespérer, en quelque sorte, d’exister sans lui. Le noyau dur de mon attitude serait alors à rechercher dans la profonde méfiance que m’inspire une volonté assignant à l’œuvre d’art une fonction que je peine à lui reconnaître. Et voilà qui me reconduit aux artistes qui semblent envisager l’illustration de la pensée comme la seule justification acceptable d’une matérialisation.
En automne 2009, le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne a présenté une importante exposition consacrée à Renée Green, artiste américaine de renommée internationale, qui semble être aussi bien philosophe et sociologue, qu’historienne ou ethnographe. On en était averti par le carton d’invitation : héritière de l’art conceptuel et du post-minimalisme, elle nous proposerait une réflexion complexe, multidisciplinaire, portant, notamment, sur la circulation des idées et des formes ou sur les relations existant entre « mémoire personnelle et collective, histoires individuelles – la sienne, celle des autres – et événements historiques ». Voilà qui me semblait de nature à susciter un débat passionnant. Pour conduire cette réflexion, elle engagerait de nombreux moyens techniques, multipliant les approches « dans un va-et-vient incessant entre documentaire et fiction » impliquant les disciplines où elle excelle.
Et de fait, au musée, la présentation des installations et des vidéos documentait soigneusement son travail, mais de manière telle que le visiteur était insidieusement conduit à douter que l’image fut d’un quelconque secours pour préciser sa pensée ou la compléter. Il lui suffisait, pour s’en convaincre, de confronter le discours introductif qu’il venait de lire à la réalité de ce qu’il voyait. Les images proposées (ainsi d’une scène montrant des femmes vêtues d’un tissu reprenant, à l’identique, les motifs floraux de la tapisserie du salon où elles se trouvaient – sans que l’on sache vraiment pourquoi elles étaient là) ne paraissaient nullement valider le propos. Ou de manière si discursive qu’il devenait urgent de revenir au texte. Mais, pour la majorité d’entre elles, qui (faut-il encore l’ajouter tant cela va de soi) ne présentaient aucun attrait esthétique, le lecteur constatait bientôt qu’elles ne signifiaient rien qui soit clairement en relation avec ce qu’il venait de lire. Il lui était donc pour le moins difficile de penser avec elles, à partir d’elles. En retour, le regardeur, dont on se souvient qu’il fait le tableau, selon Duchamp, était bien en peine de leur imposer ses propres lois, qui n’avaient aucun objet à régir. Il lui était donc impossible, l’eut-il souhaité, de se réapproprier ce fatras d’intentions.
Les salles, ainsi, formaient le flux navrant de ce que j’ai ressenti comme un vide abyssal. Et c’était là l’exemple même de ce qui, dans l’art, me bloque, me paralyse et, finalement, m’insupporte pour des motifs qui ne renvoient, il est vrai, qu’à moi-même (je veux bien, cela étant, que l’œuvre de Renée Green, à la limite, ne soit pas en cause.)
On pourrait, dès lors, passer à autre chose. Si je m’attarde, malgré tout, aux leçons de cette exposition, c’est qu’elle me paraît exemplaire d’une évolution de l’art qui fausse le cadre du débat qu’elle entend favoriser en l’élargissant à l’excès ; une évolution qui ne me semble pas avoir abouti dans sa tentative de substituer à l’illustration ou à la transmission des idées, auxquelles nous sommes accoutumés, une mise en scène de la pensée que l’installation devrait transformer en interpellation du spectateur. Or, cette pratique provoque un glissement sémantique important, dont les effets se révèlent être beaucoup plus insidieux qu’il n’y paraît ; car, symboliquement, l’apport du visible tend avec elle à se réduire comme une peau de chagrin : l’effet produit par l’image se trouve appauvri par un texte qui, paradoxalement, travaille à son abolition.
Dans un tel contexte, l’artiste s’approprie un champ d’une portée considérable (que certaines avancées technologiques ne vont d’ailleurs pas manquer d’agrandir). De cela, nous devons prendre acte. Mais cette emprise me paraît devoir cesser au point précis où le discours l’emporte sur la matérialisation (au sens aussi large que l’on voudra), qui reste indissociable d’un « geste » créatif. Alors, ce que je vois reste peu signifiant ou, du moins, n’a plus qu’un sens subordonné ou dérivé – observation qui conduit à me demander si l’artiste se sent encore assuré du pouvoir suggestif ou même subversif d’une image qui réalise l’exploit de faire oublier l’art !
L’exemple que j’ai donné est loin d’être un cas isolé. En effet, cette appétence de l’art pour la pensée n’échappe pas à la globalisation. Elle est en passe de devenir universelle. Et cela, je l’ai vérifié, ad nauseum, en témoin le plus souvent perplexe d’une pratique qui cumule les effets imprévisibles de l’invention et de la prétention. C’est ainsi que m’étant rendu, en 2009, à la cinquante-troisième Biennale de Venise, j’ai d’emblée été frappé par l’omniprésence de l’argumentation écrite. La pensée, ici, se déclinait en d’innombrables panneaux explicatifs. On les trouvait au chevet des œuvres exposées, mais aussi à l’entrée des divers pavillons nationaux. Il m’est arrivé de traverser l’un d’eux, où s’engouffrait, en quelque sorte, le jardin des alentours, sans prendre conscience d’avoir parcouru, par la même occasion, l’étendue verdoyante d’une œuvre d’art ! Et pour cause : j’avais négligé de lire, avant d’entrer, l’exposé des idées, le mode d’emploi, qui aurait eu pour effet de transformer ma promenade ignare en visite éclairée !
J’exagère à peine. Mais il faut dire que je n’ai pas été beaucoup plus concerné (bien que la présentation en fût particulièrement bien documentée et très soignée) par Le grand soir de Claude Lévèque, qui convoquait, dans une sombre soufflerie, le fameux drapeau de Delacroix – teint d’un noir du plus bel effet pour une apologie de l’idéal anarchiste. L’installation, dont un imposant générique donnait à penser qu’elle avait été conçue comme une véritable affaire d’État, était d’une froideur glacée qui n’était pas sans évoquer un couloir de la mort. Il n’empêche qu’elle ne me parut pas transposer lisiblement l’essentiel du projet intellectuel dont j’avais pris connaissance. Autant dire que la figuration étouffait sous la pensée ; au point que sans le texte qui la mettait en forme j’aurais sans autre et rapidement passé outre. Là encore, l’œuvre échouait à trouver, à donner un sens par elle-même.
À côté de cela, les sculptures d’un Bruce Neuman (un ancêtre, il est vrai), déclinant têtes et mains jointes, me parurent appartenir à un temps soudain révolu. J’avoue les avoir trouvées pathétiques dans le contexte si particulier de la foire vénitienne. Peut-être, et c’est ce qui me paraît grave, était-ce parce que je n’étais pas préparé à les croiser là. Aucun texte ne plaidait en leur faveur (ce qui n’a d’ailleurs pas empêché leur auteur d’obtenir un Grand prix qui honorait aussi, j’imagine, ses personnages bricolés au néon et ses fontaines aux crânes en latex perforé). Je pris conscience, un peu plus tard, de cette absence de tout soutien rhétorique, en constatant les généreux efforts consentis pour assurer l’approche adéquate du néo-concrétisme brésilien de Lygia Pape (que j’allais découvrir un peu plus loin).
On pourrait continuer ainsi (et presqu’à l’infini) en évoquant des mètres et des mètres carrés de photographies bien léchées, manifestement pensées, mais comme déconnectées du réel, qui n’auront pas réussi à me héler au passage (à défaut de m’émouvoir) ; ou avouer la lassitude qui m’a détourné d’une installation conceptuelle interactive, dont je peinais à percevoir la finalité, avant que les miroirs sobrement flingués du bien nommé Michelangelo Pistoletto ne me restituent mon image brisée, à l’autre bout de l’Arsenal. Mais, à quoi bon ? Car cela ne ferait que renvoyer, une fois de plus, à mes propres limites – pour ne pas dire : à mes insuffisances. Je ne puis m’en prendre qu’à moi-même si l’espace des Giardini me parut exagérément encombré de penseurs ! Malgré cela, je garderai le souvenir du sentiment jailli de ce joyeux et turbulent tourbillon ; il avait à voir, en effet, avec le foisonnement même de la vie. Je me trouvais presque surpris d’en convenir sans grande réticence.
En revenant vers San Marco, par le quai des Schiavoni, il me vint à l’esprit que le point sensible de toute cette affaire pourrait bien être (comme je l’ai déjà laissé entendre) que je ne parviens pas à faire entièrement le deuil du statut esthétique de l’œuvre et à accepter que cette dernière aspire d’abord à être la mise en forme d’une pensée, l’expression d’une conscience, la quête obligée d’un sens. Je me suis alors souvenu d’une remarque de Milan Kundera, dans Une rencontre, où ce dernier reproche à Céline d’avoir procédé, à propos de Rabelais, à la « réduction de l’esthétique au linguistique ». Il me sembla que c’était exactement là l’effet que je déplore, s’agissant d’un art qui s’est détourné de la beauté vers une langue (qui ne se contente plus d’être celles des signes) qu’il envisage, en elle-même et pour elle-même, pour formater le message de sa création.