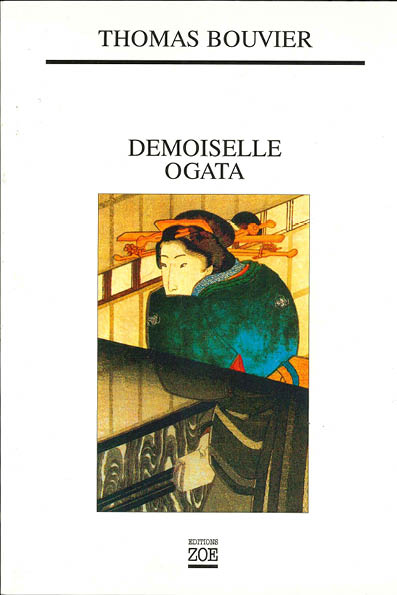Chapitre 1
« Un corps me fut donné – pour quelles fins ? –
Ce corps qui est un seul, tellement mien. »
O.Mandelstam
Je n’ai jamais aimé l’odeur de l’hôpital. Une puanteur, si déplaisante soit-elle, a le mérite d’être franche. Elle se présente de face, sans minauder. L’odeur de l’hôpital, plus sournoise, fait d’abord croire qu’elle n’est pas là. On passe la porte principale, on dilate une narine suspicieuse et l’on se dit : « Aurait-elle pris congé ? » Chaque révolution du tambour de l’entrée fait s’engouffrer dans le hall une bouffée de ville. La cafétéria apporte des effluves de cuisine qui persistent en s’affadissant après que le monde est retourné au travail, et chaque visiteur sain traîne dans son sillage un parfum qui s’attarde avant de se résoudre dans l’odeur-somme de l’entrée principale.
Avançant, on comprend que cette concurrence ne menace pas la maîtresse des lieux. Discrète, elle se dissimule encore sous les émanations ordinaires des bâtiments publics : un parfum de graisse chaude qui monte des escalators, un autre de linoléum frelaté par les produits de nettoyage, celui d’un spray pour les vitres. Le bâtiment de liaison a aussi son odeur, tout comme l’aluminium rarement immaculé des ascenseurs. Une puanteur timide rayonne des boutons d’appel, sur lesquels se sont empilées les empreintes de doigts.
Dans la cabine, l’odeur reine se fait plus nette, quoique encore dissimulée par le shampooing de l’infirmière qui s’est éloignée au deuxième, l’after-shave du stagiaire qui se rend au cinquième et la fragrance d’une femme élégante qui, sans s’excuser, vous a bousculé’ en sortant au huitième.
Aux étages, elle est défiée encore par un distributeur de boissons d’où exhalent les relents d’un café discutable. On s’approche des chambres et les odeurs ordinaires commencent à perdre la guerre quand la maîtresse des lieux, elle, commence à la gagner. S’avancent encore des parfums spécifiques : savon bactéricide, désinfectant, parfum âcre échappé d’un stock de médicaments. Se mélangeant tous, ils forment une odeur qui pourrait passer pour celle, véritable, de l’hôpital quand ils n’en sont qu’une composante superficielle.
Dans l’air vibre autre chose qui n’est pas reçu par le nez seul mais par le corps entier. C’est sur lui, tympan complexe, que tambourinent continûment les messages immatériels qu’il perçoit en sourdine, incapable de déterminer précisément la source des sensations qui l’assaillent.
Dans les chambres, les couloirs, les ascenseurs, dans le hall, à l’accueil, dans les salles de réunion, les sous-sols, les salles d’attente et les réserves, dans les salons où somnolent des malades oubliés, une polyphonie muette rassemble des chants singuliers. Celui de l’os rompu enserré dans l’attelle, celui du foie cirrhosé à l’étroit dans un ventre, celui de l’intestin piqué de tumeurs sourdes, celui du cœur fragile qui pousse sa chanson tachycarde… On entend les voix piteuses des veines encombrées, du pancréas qui se dévore lui-même, de l’estomac qui ne digère rien. On devine les soupirs des articulations enflées, les voix sourdes des mains, des pieds, des visages, déformés par l’effet de graves maladies. On ressent la voix aigre des peaux qui s’irritent, éclatent sous forme d’escarres répugnantes, se desquament, sèchent, se rident ou s’affaissent sur l’espace laissé vacant par l’atrophie des muscles. On perçoit la lamentation d’yeux gagnés par l’opacité, la tristesse d’une oreille où, après un sifflement funeste, s’établissent des bourdonnements pérennes. On entend les chœurs tristes des poumons et de la rate, de la gorge et du sein, des ovaires et de l’utérus, dévorés par un crabe insouciant des corps qu’il conduit à l’extinction. Des voix faibles, perdues dans les couleurs de l’orchestre, sourdent de têtes déréglées, gagnées par un oubli qui défait chaque lien avec le monde, sépare des proches et du plus proche, c’est-à-dire de soi-même.
Sous les crânes naissent en continu des inquiétudes, des questions, des angoisses : la tumeur continue-t-elle de croître ? Mon cœur tiendra-t-il ? Pourrais-je enfin manger ce que j’aime? Combien de temps me reste-t-il à vivre ? Cette faiblesse dans mon ventre m’inquiète et me dégoûte. Mon frère viendra-t-il ? L’opération a-t-elle réussi ? J’ai mal ! J’ai la nausée ! Je m’ennuie ! L’alcool me manque. J’en ai assez de la douleur. Ma femme n’est pas venue. Où sont les enfants ? Qu’ont-ils mangé à midi ? Aurais-je la force de me traîner jusqu’aux toilettes sur ces jambes en coton ?
La nuit, sous les plafonds, dans les couloirs déserts, au ras des linos froids, les corps, en proie à des rêves pipés par les drogues, continuent d’émettre leurs complaintes muettes.
D’où vient que dans ce silence surpeuplé, on ne décèle pas mieux les voix du soulagement, de l’apaisement, de la chair qui lentement reprend des forces ? Je l’ignore. Elles sont noyées dans le concert de la contrariété, de la frustration, de la douleur. Elles sont trop peu nombreuses pour contrer le malaise qui assaille le visiteur sain et plombe mystérieusement ses jambes.
Chapitre 2
« Le soleil est la lampe, l’univers la lanterne
Et nous, les images qui tournent. »
O.Khayyam
Je pousse la porte de Grand frère.
Il fait nuit. Il pleut. C’est une chambre à deux lits. Le sien est près de la fenêtre, l’autre est inoccupé. Un courant d’air soulève le rideau de coton grège. Je referme la porte et lentement le rideau revient à sa place.
Grand frère gît sous son drap blanc. Il a l’air minuscule. À de courts intervalles, sa poitrine se soulève puis retombe. Je lui prends la main. Sa chaleur me rassure. Je la caresse. Il ouvre des yeux hébétés qui ne regardent rien. Son expression est étrangement faussée. Je me penche sur lui et chuchote : « Grand frère, c’est moi ! Comment ça va ? » Il tourne lentement vers moi son visage émacié. Son regard me traverse sans me voir. Je repose la question. Me serrant la main, il tente de se redresser en poussant un grognement presque animal. Il en émet un second et, comme étonné par le son produit, laisse tomber sa tête sur l’oreiller. Mes yeux s’embuent. Je comprends qu’il ne peut pas parler.
Il fixe un point par-dessus mon épaule. Je me retourne.
Sur fond de mer turquoise, un mâle alpha étreint une femelle du même type. Ils décochent des sourires qui frisent les quatre-vingt-huit dents. Au bas de l’écran glissent sans interruption les cours de la Bourse. En surimpression fleurissent de petits drapeaux accompagnés de numéros de téléphone, si vous appelez d’Espagne faites le… si vous appelez de France… S’affiche ensuite une adresse Internet en lettres violettes d’une laideur étudiée. Plan final : le couple est assis près d’un feu en compagnie d’un bon sauvage. Le soleil vient de passer sous l’horizon. Hauts dans le ciel flamboient des nuages roses et jaunes. Sans oublier de sourire, le couple alpha dévore des poissons pêchés de frais dans le lagon.
Le bonheur est simple : il suffit d’être riche et d’avoir quarante-quatre dents.
Je me détoure de l’écran. Sur le drap sautent les coupes de la publicité suivante. Grand frère semble dormir, mais il ne dort pas. Il encaisse le choc qu’il vient de subir. Regardant mieux son visage, je comprends ce qui en fausse l’expression : la moitié de la bouche est affaissée, la paupière tombe sur l’œil droit. D’un coup de télécommande, je fusille le poste. Grand frère s’agite et gémit en remuant. Ne sachant que comprendre, je rallume l’appareil. Ça le calme. Je lui souffle à l’oreille : « Je repasserai tout à l’heure, repose-toi bien… » J’ouvre la porte. Le rideau se soulève mollement. En contrebas, des voitures circulent sur l’avenue mouillée. À son chevet, un bouquet de tulipes dont les têtes s’affaissent sous leur propre poids. Grand frère a bougé faiblement. Sous le drap blanc, son petit corps fait à peine un tumulus. Jamais il n’a paru si fragile.
Dehors il fait nuit. Avril. Treizième jour du printemps.
L’infirmière me fait asseoir dans le bureau. Le professeur a du retard. C’est un espace standard : cinq mètres sur trois, pupitre en mélamine, sous-main, rainuré sur le pourtour, écran, clavier, souris. Il y a dans le monde des centaines de couleurs de moquettes. Dans ce genre d’endroit, elles sont toujours marron. Plafond en carreaux de plâtre perforé. Néons dans des cagettes de métal émaillé crème. Chaises en tube d’acier. Siège et dossier imitation laine assortis au brun douteux de la moquette. Les murs ont été blancs un jour. Deux photos en couleurs ornent celui de droite. Cadres bon marché. Baguettes en plastique – les biseaux s’ajointent mal – plexiglas au lieu de verres anti-reflet autrement coûteux.
Première image : deux fillettes hirsutes jouent sur la plage. Il doit être midi. Elles fixent l’objectif par en dessous en inclinant la tête et plissent beaucoup les yeux à cause de l’ardeur du soleil. Leurs petites mains étreignent des râteaux où s’accroche du sable humide. À leurs pieds se délite lentement une forteresse dont les bastions, émoussés par les vagues, sont sapés par la mer.
Seconde image : bien des années plus tard, enfants et mère assis sur un muret devant un glacier qui n’en a plus pour longtemps. La femme au centre tient ses filles par les épaules et les serre contre elle. Des bustes des adolescentes émane une réticence, comme si cette proximité forcée les mettait dans l’embarras. Sourire épanoui de la mère encore belle, encadré par ceux plus ambigus des filles enlaidies par l’âge ingrat.
L’une, l’air mou, sourit à demi, tentant de dissimuler les fils d’acier qui sertissent ses dents.
L’autre, mèches rouges dans les cheveux, a l’air plus énergique. Un anneau perfore sa narine. Son regard dit qu’elle pose à contrecœur sachant d’avance qu’elle sera horrible sur la photo, ce qui n’est pas complètement faux.
La petite dernière, debout entre les cuisses de maman, a peut-être sept ans. Ses yeux pétillent. Elle n’a pas l’air fatiguée. Son visage rieur est troué par l’absence d’une incisive. Ses lèvres sont violettes (peut-être des myrtilles glanées à la montée). Fière, elle défie l’objectif de son’ torse malingre. Elle flotte dans un short hérité des grandes et ses jambes allumettes sont plantées dans des chaussures de montagne qui paraissent énormes. Sous l’étreinte de ses petits doigts forts, un orchis et deux gentianes achèvent d’agoniser. S’ils pouvaient émettre un vœu, nul doute qu’ils troqueraient volontiers un empire contre un filet d’eau.
Les couleurs des photographies commencent à virer. L’éclairage néon ne les aide pas beaucoup. Une dominante jaunâtre gagne patiemment le territoire de la représentation. Ces images sont là depuis longtemps et si on les retirait, on découvrirait la marque claire des cadres. Je pense aux images de ces femmes, la nuit, dans le bureau désert, éclairées seulement par les lumières de la ville, fixant dans la pénombre la nudité terne du mur adverse.
Porte ouverte en coup de vent, le professeur fait irruption. Poignée de main rapide et chaleureuse. Lunettes à grosse monture, barbe soignée, crâne dégarni. Il s’assied, se tourne vers l’écran, bricole avec sa souris et clique pour ouvrir un document. J’observe les sauts des yeux qui survolent le texte. Il lâche le clavier, tourne le buste et joint les mains sur le bureau. L’opération s’est déroulée sans anicroche. Grand frère se portait bien lorsqu’on l’a conduit en salle de réveil. C’est là – personne ne sait quand – que l’incident s’est produit. Il a fait un accident vasculaire cérébral. Son côté droit est paralysé. Il ne peut pas s’exprimer. On ne sait combien de temps le caillot a encombré l’artère, demain, on fera un scanner pour y voir clair.Ce genre d’accident n’est pas rare, surtout chez les personnes âgées. Il n’est pas exclu qu’il puisse recouvrer une partie des facultés perdues. Le professeur m’enjoint de ne pas évoquer l’accident en sa présence, me dit encore que les visites ne peuvent faire que du bien, qu’il faudra patienter.
Mon corps s’est crispé au cours de l’explication. Je suis trop atterré pour formuler le moindre commentaire. L’opération s’annonçait bénigne. On nous avait dit qu’après deux jours Grand frère pourrait rentrer à la maison et qu’après une semaine de repos, il pourrait reprendre une activité normale. Le médecin se lève, m’accompagne à la porte. Il a encore du travail. D’une voix blanche, je le remercie de m’avoir reçu à cette heure tardive.
Avant de rejoindre les ascenseurs, je repasse à la chambre 721. Elle baigne dans une obscurité douce. On a fermé la fenêtre, la télévision s’est tue. Je m’approche du lit et caresse doucement le front de Grand frère. Il y a seulement trois jours, il mettait la dernière main à un instrument superbe. Nous étions allés marcher dans la campagne qui s’éveillait aux douceurs du printemps. Il était vif, disert et gai. Ses yeux bleus brillaient de malice. Toute sa vie, il s’était plié à une stricte discipline et il n’était pas rare qu’on lui donnât vingt ans de moins que son âge. Son corps tout en tendons le servait admirablement. Sa main ne tremblait pas. Tout en lui fleurait la verve d’un vieux maître chinois.
Je ne peux croire qu’il soit là, dans ce corps diminué, incapable de parler. Je reste un moment à son chevet, serrant sa main dans la mienne. J’essaie de pleurer. Les larmes ne viennent pas.
Au moment de saisir la poignée, elle s’abaisse d’elle-même et je me trouve poitrine à nez avec une infirmière rondelette. Je pense aussitôt Andes, Bolivie, Pérou. Elle ne fait pas un mètre soixante. Ses cheveux peignés tombent de part et d’autre de son visage, épousant le galbe d’une poitrine abondante. Elle plante dans les miens des yeux interrogatifs. Je tends la main en disant : « Je suis un membre de la famille » et pense : « Le seul en vérité ». En la quittant, je lui demande si elle travaille toujours de nuit. « Pour quelques jours encore », répond-t-elle avec un fort accent. Elle a dit « iour », a mis un accent sur le « o » de « encore » et a écourté le « r » en le rendant râpeux.
Le chiffre 7, rouge et anguleux, s’affiche sur le noir du cadran. La fée des ascenseurs émet son « ding » frais et limpide. Il y a toujours un léger décalage entre l’arrivée de la cabine, le tintement et l’ouverture des portes. Ce soir, il me paraît très long. Elles s’écartent en un mouvement pas vraiment lisse. Une petite saccade gâche le début et la fin de la course. On devrait pouvoir améliorer le mécanisme pour rendre ce glissement vraiment élégant.
Seul dans l’ascenseur immense, j’entends le sang battre à mes oreilles. Je suis choqué. Ça sent le linoléum et le désinfectant. L’esprit vague, je fixe le défilement des chiffres rouges dans leur cadran noir et me souviens d’une photographie en noir et blanc : une petite fille portant un foulard conduit trois aveugles barbus qui se tiennent par la main. Le premier, vêtu d’une salopette, tient un bâton. Il est pieds nus. Le deuxième, chaussé, porte un pantalon noir, une chemise et un gilet jacquard. Il a été saisi jambes croisées comme au milieu d’un pas de sirtaki. Le troisième est couvert d’une veste militaire défraîchie, d’une chemise qui bâille à la hauteur du sexe et d’un short déchiré. Les deux premiers sont coiffés d’une casquette. Le troisième porte un béret d’où dépassent des boucles noires. Ils ont l’air de clochards égarés dans le désert. Heureusement, la petite voyante les guide. Derrière eux, on voit des baraquements, une ligne électrique et un ciel pommelé. L’image a été prise par Robert Capa, à Gedera, en 1950, dans un village pour immigrants aveugles. La douleur qui s’abat aujourd’hui sur moi, mes yeux sains ne l’ont pas vue venir et, comme ces clochards aveugles, j’avance à tâtons dans la nuit de mon destin. Seulement… Ma main est vide. Pas de fillette au foulard pour me guider dans le désert, pour éviter que mes pieds nus ne s’ouvrent sur le tranchant des pierres.
Dans le hall, personne. La cafétéria est plongée dans l’obscurité. L’accueil est désert. Je passe le tambour de la porte principale et suis cueilli sur le trottoir par un air humide et cru. Il pleut. L’asphalte mouillé est une plaque sensible où s’élargissent les auras floues des réverbères.
Marchant vers la maison, me revient une histoire lue en compagnie de Grand frère : un homme chenu est agenouillé dans une gare. Menotté, il est escorté par des soldats. C’est un évadé repris qu’on expose de cette façon au mépris de la foule. Des passants s’arrêtent, regardent, certains, émus, lui lancent qui du pain, qui du tabac, qui une cigarette. Le détenu affamé se courbe pour saisir le pain avec les dents, aussitôt un soldat de l’escorte, d’un coup de pied, lui fait sauter le pain de la bouche. Le vieil homme se traîne encore et se penche pour mordre à nouveau. Le soldat, d’une botte nonchalante, envoie promener le pain au loin.
Combien de livres Grand frère et moi nous étions lus à haute voix ? Difficile de le dire avec exactitude. Le cœur serré, je pense à lui, au septième étage, étendu dans son lit, seul, incapable de produire un son articulé.
Le malheur est simple : il suffit d’aimer un homme et qu’il arrive un accident.