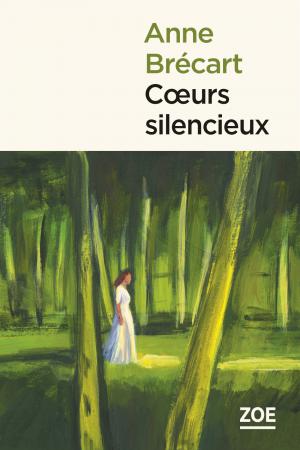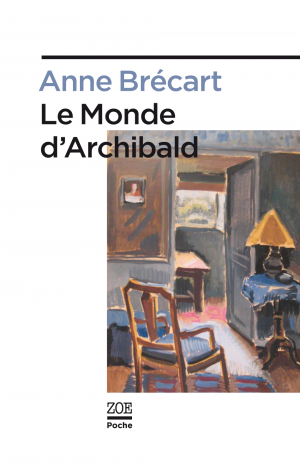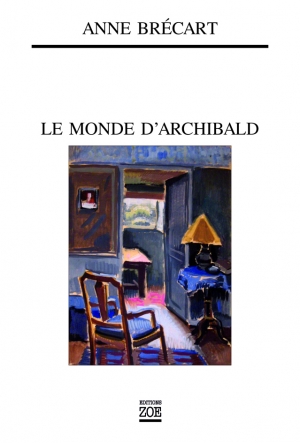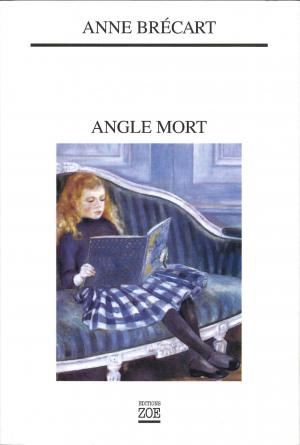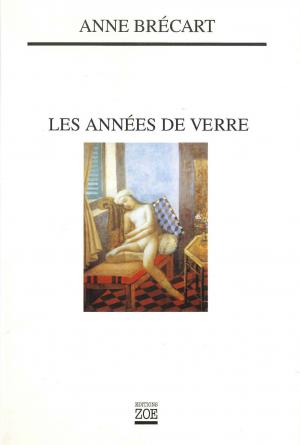parution avril 2012
ISBN 978-2-88182-859-1
nb de pages 208
format du livre 140 x 210 mm
prix 27.00 CHF
La Lenteur de l'aube
résumé
Dans quel monde vit Hanna ? Elle arrive des États-Unis pour la « ville du bord du lac » début juillet, à l’appel de sa mère qui n’est soudain plus très pressée de la voir. Au gré de ses marches dans la ville brûlante, elle retrouve plusieurs figures majeures de sa vie. Alma, l’amie perdue, Karim, l’amant d’un été, Marika, l’artiste aimée. Pourquoi fait-elle ces rencontres ? Et les retrouve-t-elle vraiment ? Hanna mène à son insu une enquête sur elle-même. Sa mère, qui va mourir, et la tendresse d’Hervé, qui saura lui parler, vont finir de tisser la toile du récit : celui de l’identification d’une femme, lente à venir comme l’aube d’une vie nouvelle.
Véritable construction musicale au charme envoûtant, La Lenteur de l’aube est aussi une réflexion sur le silence et l’absence qui accompagnent tout amour.
Bien qu'issue d'une famille francophone, Anne Brécart a suivi dans son enfance à Zurich l'enseignement d'écoles de langue allemande. Elle a ensuite fait des études de Germanistik en Suisse romande, où elle réside aujourd'hui. Traductrice littéraire de l'allemand (notamment de Gerhard Meier), elle anime des ateliers d'écriture et enseigne à Genève l’allemand et la philosophie. Tous ses romans ont été publiés chez Zoé.
Le Courrier (www.lecourrier.ch)
"C'est un mélange saisissant de douceur et de violence, de poésie et d'étrangeté, de lenteur et d'intensité, qui se déploie dans le dernier roman d'Anne Brécart. La Lenteur de l'aube joue en virtuose d'une musique tendue entre ces tonalités, qui fait aussi la part belle aux silences." (Anne Pitteloud)
Supplément Hebdo/Payot
« Onirique, organique, érotique, ce roman ne cesse de surprendre. On ne sait où il nous emmène mais on le suit aveuglément. Son écriture, troublante et sonore, se répercute par vagues dans les tréfonds de l’esprit du lecteur. Et le marque durablement. » (Julien Burri)
Le Temps
« C’est un roman délicat, traversé par des bouffées d’amour, réchauffé de chairs qui se touchent. Anne Brécart parvient à installer de vrais moments d’éblouissement dans ces pages » (Eléonore Sulser)
Zone Critique, RTS
"C'est un livre absolument magnifique. Une langue de la sensation. Anne Brécart a une place extrêmement importante dans la littérature romande." (Sylvie Tanette)
"La Lenteur de l'aube offre une palette de couleurs qui se décline avec beaucoup de grâce." (Eléonore Sulser)
"C'est un très très beau livre. Un livre sur le silence qui résonne du passé et de tout ce qui n'a pas eu lieu. Avec un érotisme organique. (Julien Burri)
"Un très beau roman" (Christine Gonzales)
Russe
Titre: La lenteur de l'aubeÉditeur: Textpublishers
Année: 2013
La Patience du serpent (2021)
Christelle et Greg ont choisi la vie nomade. Ils ont la trentaine et sillonnent le monde en minibus avec leurs deux petits garçons. Amateurs de surf, ils s’installent là où se trouvent les meilleurs spots, vivent de petits boulots et d’amitiés éphémères. Le vent les mène jusqu’à San Tiburcio, sur la côte mexicaine, Greg s’y sent vivant lorsqu’il danse sur la crête des vagues. Mais il faut s’habituer au soleil implacable, au grondement de l’océan, aux pluies diluviennes des tropiques. Un jour, Ana Maria, une jeune femme du village, fait irruption dans leur existence. Elle entraîne Christelle dans une relation vertigineuse qui va bouleverser la famille.
Dans une langue sensuelle et luxuriante, Anne Brécart décrit le quotidien de ces voyageurs à la recherche d’une autre vie.
Coeurs silencieux (2017)
Quarante ans après un premier amour clandestin, Hanna retourne dans la région de son adolescence, y retrouve le génie du lieu mais aussi ce même trouble auprès de l’homme qu’elle avait aimé très jeune fille. La présence du lac et de la forêt, l’humidité qui envahit tout, l’odeur de la terre, la force du vent traversent le roman avec une puissance qui s’apparente à celle du désir. Les souvenirs d’enfance d’Hanna, de ses premières années passées dans la grande maison, remontent avec naturel. Mais dans ce lieu encore imprégné du passé, les préjugés à l’égard des sentiments qu'elle éprouve pour Jacob rejaillissent avec la même dureté que jadis.
Cœurs silencieux raconte la renaissance d’une femme, une reconquête de l’amour et du désir.
La Femme provisoire (2015)
A Berlin, il y a 30 ans, dans le silence et le désarroi, une jeune femme qui vient de subir un avortement avec une nonchalance qui s’avèrera trompeuse, marche de longues heures solitaires dans la ville. Quelque chose se passe. Elle rencontre Javier, jeune homme étranger comme elle, dont elle apprivoise progressivement l’enfant de quelques mois. D’une petite chose scrutatrice et calme, il devient un enfant aimé et confiant.
Entre Javier, la femme et le petit, un étrange bonheur s’installe. Le génie des lieux n’y est pas pour rien. Dans un immense appartement décati mais aux hauteurs aristocratiques, au cœur de l’hiver magnifique, de grandes journées vides sont en fait un véritable temps enchanté qui durera presqu’une année. L’enfant devenu adulte retrouve sa mère provisoire, le passé remonte, c’est le temps du récit.
Le Monde d'Archibald (2011, Zoé poche)
Peut-on vivre sans la protection d’une maison familiale, qu’elle soit réelle ou fantasmée ?
Dans une vieille demeure de famille où tous se réunissent pour célébrer la ronde des étés éternels, la narratrice tombe sous le charme de son oncle Archibald, patriarche incontesté quoique fragile. Chaque année elle revient dans la maison qui garde les secrets des défunts et des vivants, mais le passé conserve aussi les turbulences : il y a sur les lieux des présences impalpables qui s’avèrent inquiétantes. La mort du cousin préféré, le mutisme d’Idriss le Kosovar, l’initiation sexuelle de l’adolescente, annoncent la fin d’un monde suspendu.
Un roman à l’écriture limpide sur un lieu préservé de l’enfance, à la fois source de menaces et objet de désir.
« Ici les réminiscences poussent comme des plantes tropicales ; je les sens physiquement s’agripper aux murs et grimper au plafond. »
Le Monde d'Archibald (2009)
Peut-on vivre sans la protection d’une maison familiale, qu’elle soit réelle ou fantasmée ?
Dans une vieille demeure de famille où tous se réunissent pour célébrer la ronde des étés éternels, la narratrice tombe sous le charme de son oncle Archibald, patriarche incontesté quoique fragile. Chaque année elle revient dans la maison qui garde les secrets des défunts et des vivants, mais le passé conserve aussi les turbulences : il y a sur les lieux des présences impalpables qui s’avèrent inquiétantes. La mort du cousin préféré, le mutisme d’Idriss le Kosovar, l’initiation sexuelle de l’adolescente, annoncent la fin d’un monde suspendu.
Un roman à l’écriture limpide sur un lieu préservé de l’enfance, à la fois source de menaces et objet de désir.
« Ici les réminiscences poussent comme des plantes tropicales ; je les sens physiquement s’agripper aux murs et grimper au plafond. »
Angle mort (2002)
Les Années de verre (1997)
Fantasque, fascinante et fragile, Nell a régné sur la jeunesse de celle qui parle ici. Elle raconte leur amitié passionnée, ce lien qui les unissait « contre tout bon sens ». De par son écriture nerveuse et précise, ce roman nous fait ressentir toute l’intensité de cet amour qui n’osait dire son nom. Sans avoir l’air d’y toucher, il dépeint aussi un milieu où l’on ne manque de rien mais où, entre la lourde hypocrisie des bons sentiments et le rembourrage des fauteuils, aucune âme ne saurait véritablement vivre.
La Lenteur de l'aube: extrait
Il devait être environ midi, lorsque je suis arrivée devant la pension de la Cloche. J’ai reconnu l’enseigne vissée sur la façade et j’ai levé les yeux vers ce qui était sa fenêtre à l’époque. Peut-être ma mère était-elle toujours là en train d’ouvrir le tiroir de la commode et de ranger ses habits, n’ayant pas vieilli et m’attendant encore, moi qui ne venais jamais au bon moment, moi qui venais soit trop tôt, soit trop tard, alors qu’elle patientait toute nimbée d’attente et de reproche.
J’ai poussé la porte en ce jour de juillet comme je l’avais poussée trente ans plus tôt pour la première fois. Tout de suite l’ombre fraîche et l’odeur de savon de la cage d’escalier m’a évoqué la concierge et son grand seau, le bruit de la brosse sur les dalles de pierre. J’ai monté l’escalier, me suis accrochée à la main courante incurvée et la peur qui m’habitait à l’époque m’a reprise.
- Ecoutez, m’a dit la tenancière de la Pension, écoutez, nous n’ouvrons qu’à quatre heures. Les chambres ne sont pas encore faites et de toute façon la pension est fermée jusqu’au soir.
- Je viens de faire un long vol, je suis fatiguée et il fait trop chaud pour rester dehors, mes bagages m’encombrent.
Cela a semblé adoucir la femme qui me regardait en entortillant ses cheveux noirs autour de son index. Elle me fixait de ses grands yeux maquillés et me scrutait comme pour vérifier l’effet qu’avaient sur moi ses cheveux noirs et son regard bleu. Était-elle la fille de Mme Turtache bien qu’elle ne lui ressemblât en rien ? Elle a ouvert grand la porte de sorte que, maintenant que j’étais habituée à la pénombre, je puisse voir le corridor qui n’avait pas beaucoup changé. Au milieu il y avait toujours l’horloge avec son balancier en laiton qui brillait à chacun de ses passages devant la vitre. J’ai reconnu la banquette recouverte de tissu noir et, sur le sol, une moquette élimée d’un rose passé.
- Ecoutez, vous pouvez déposer vos bagages ici et vous reviendrez dans deux heures mais pas avant hein, parce que maintenant la chambre n’est pas prête.
Elle m’a indiqué un coin derrière le rideau séparant la partie privée de la partie réservée aux locataires, avant de me pousser vers la sortie.
- Allez, vous reviendrez tout à l’heure, et elle m’a adressé un petit sourire en guise d’encouragement, sans doute.
En descendant les marches de pierre, larges et généreuses, j’ai entendu les bruits de la rue qui me parvenaient, assourdis, comme le lointain ressac d’une mer imaginaire.
Quelques semaines avant mon départ pour la ville du bord du lac, j’avais reçu une lettre de ma mère – elle communiquait surtout par lettre manuscrite, une vieille habitude prise au temps où le téléphone coûtait cher et où l’ordinateur n’existait pas – qui m’avait étonnée. Effrayée même. C’était d’ailleurs plutôt un appel à l’aide. Elle me parlait de visiteuses vêtues de noir passant devant la fenêtre de sa chambre entre cinq et sept heures du soir, elle mentionnait des courtiers qui venaient lui faire des offres pour lui racheter sa maison, offres qu’elle ressentait comme une menace d’expropriation comme si, une fois encore le destin voulait la déloger. Le monde autour d’elle était hostile et dans la maison il y avait des insectes malfaisants remontant de la cave et attaquant la cuisine. Les courtiers, les visiteuses étranges et les insectes représentaient tous un seul et même danger dont moi, sa fille unique, aurais dû la protéger. J’avais promis de venir la voir, de mettre de l’ordre dans ses papiers, de chasser les courtiers, d’acheter du Baygon et de discuter avec les visiteuses.
Mais une fois mon billet réservé pour le début des vacances d’été, je l’avais appelée et appris qu’elle ne pouvait pas me « recevoir » - c’était bien le terme qu’elle avait utilisé - avant le 8 juillet, alors que je m’étais libérée tout exprès pour venir la voir le plus tôt possible. Je la connaissais assez pour savoir qu’elle serait inflexible, car elle était tout simplement « débordée, ma chérie », ce qui voulait dire que toutes sortes d’activités étranges requéraient son temps. Elle avait un rendez-vous chez son ostéopathe, un autre avec un conseiller spirituel dont elle voulait me parler mais j’imaginais déjà qu’elle ne m’en dirait rien ou seulement de manière allusive. Elle était très occupée et presque agacée par ma venue. C’était comme lorsque j’étais enfant, d’innombrables occupations mystérieuses l’empêchaient de me consacrer du temps et elle le regrettait. Elle ne « saurait pas que faire de moi » et préférait que je vienne après ses « obligations ». Je ne cherchais pas à comprendre, c’était ainsi que nous « fonctionnions » - encore un de ces mots qu’elle utilisait pour parler d’elle et de moi, un mot explicitement distancé et dépassionné.
Qu’elle m’ait appelée à l’aide n’était pas en contradiction avec le fait que, maintenant que je m’étais libérée pour venir, je devenais une charge. Il semblait que nous devions toujours « fonctionner » ainsi, elle avoir le dessus et moi toujours être celle dont il fallait, d’une manière ou d’une autre, s’occuper.
J’ai pourtant décidé de ne pas changer mes plans, sans lui en parler pour ne pas la contrarier. Pourquoi finalement ne pas passer quelques jours dans cette ville, aller me baigner, dormir longuement, bref me reposer ?
En ce début d’après-midi de juillet, je m’avançais vers l’inconnu sans le savoir. Je croyais revenir chez moi, retrouver quelque chose de familier dans lequel je m’enfoncerais comme le renard dans sa tanière alors que c’était tout le contraire qui allait se produire.
J’ai deux heures à tuer en attendant que le lit et la chambre de la Pension soient faits. Délestée de mon bagage, j’ai cherché un endroit à l’ombre. Les rues que je parcourais étaient prises de somnolence, à certains endroits, l’asphalte avait fondu ; de derrière les rideaux blancs, bougeant doucement dans l’air chaud, il me semblait entendre des rires.
Finalement je me suis arrêtée sur une petite place abritée par l’ombre de trois tilleuls. Au milieu coulait une fontaine avec un bruit monocorde. Je me suis assise sur l’un des bancs, puis allongée, utilisant mon sac à main comme oreiller. Des pigeons, indifférents à la chaleur, roucoulaient à quelques pas de moi tout en se tournant autour dans une danse nuptiale un peu grotesque. Je me suis assoupie, bercée par le murmure de l’eau.
- Tu permets.
Le timbre de cette voix ne m’était pas inconnu. J’ai ouvert les yeux. Alma avait pris place à côté de moi. Alma qui avait été ma meilleure amie pendant la période du Secondaire.
- Alma ! Mais qu’est-ce que tu fais là ?
- Je pourrais te retourner la question.
Alma avait peu changé, elle avait toujours ce regard dur d’oiseau et cette manière abrupte de parler. En revanche elle ne portait plus le jeans et le t-shirt que, à l’époque, elle ne quittait pas. D’un ton assuré, elle m’a demandé si je ne voulais pas venir rendre visite à Valentine, la femme qui, il y a si longtemps, nous accueillait à la ferme. Elle avait près de quatre-vingt-cinq ans et Alma avait envie de la voir. Tout ça d’une traite comme si c’était la chose la plus banale du monde que nous nous retrouvions, vingt ans après notre dernière rencontre, sur un banc, devant une fontaine un jour caniculaire de juillet. J’étais tout à fait d’accord de faire cette visite avec elle, pourtant j’avais d’innombrables questions à lui poser, je croyais que…
Mais Alma a coupé court, de tout cela nous pourrions parler demain, nous aurions le temps, elle m’attendrait dans le grand hall de la gare à onze heures précises. C’était là que, il y a trente ans, au tout début des grandes vacances, nous nous retrouvions sac au dos pour partir en voyage.
Quand je me suis levée, il faisait étouffant et j’ai été prise de vertige, un voile gris a passé devant mes yeux et mes oreilles bourdonnaient. J’ai marché en direction du lac et, au détour d’une rue, j’ai enfin senti l’air humide et frais chargé d’une odeur d’algues. Au-delà de la route, un parc bordait la rive où des arbres anciens offraient leur ombre à qui voulait contempler la vue sur les Alpes à peines visibles dans le brouillard de chaleur.
Je me suis étendue sur la pelouse face au lac pour repenser à cette rencontre si inattendue.
J’avais connu Alma lorsque j’avais quinze ans. Nous fréquentions la même école bien qu’elle vive à la campagne et moi en ville. La première fois que je l’avais remarquée, elle mangeait seule à une table de la cantine. Alors que le local était bondé, il y avait beaucoup d’espace autour d’elle comme si personne n’osait l’approcher.
Parfois je la croisais dans les couloirs ou la voyais dans la cour de récréation, elle se tenait toujours à part. Son isolement lui était visiblement totalement indifférent. Jamais je ne l’avais vue chercher un contact en se mêlant à un groupe ou en apostrophant quelqu’un. Une fois, elle était en train de ranger cahiers et livres dans son casier et sa trousse était tombée. Je la lui avais ramassée et tendue, elle avait eu l’air profondément surpris. Comme si j’avais réussi à pénétrer dans une enceinte transparente de laquelle elle était prisonnière. Son regard brun et perçant s’était accroché à moi et elle m’avait remerciée d’un ton neutre.
Quelque temps après l’incident de la trousse, elle m’arrêta dans le couloir :
- C’est toi qui m’as rendu ma trousse l’autre jour ?
Comme si elle n’était pas sûre de me reconnaître. Elle me fixait avec son regard dur d’oiseau. Puis elle m’invita très formellement chez elle pour le prochain après-midi de congé. J’avais été tellement surprise que je n’avais même pas eu la présence d’esprit de refuser. Elle m’avait déjà tendu un petit papier sur lequel étaient indiquées les heures de départ du train que je devais prendre pour venir la voir dans le petit village qu’elle habitait. Elle viendrait me chercher à la gare.
C’est ainsi que j’avais été chez elle la première fois, puis que j’y étais retournée régulièrement. C’était bien de pouvoir être avec elle. Parce que nous n’allions pas en ville traîner dans les magasins, parce qu’elle n’avait jamais d’histoire de cœur à me raconter. Entre nous il y avait une familiarité qui se passait de toute parole.
Elle habitait une petite maison près d’une ancienne ferme avec ses parents et ses trois frères. Il y avait chez elle une ambiance étrange, bien différente de celle qui régnait chez nous. Son père était un physicien réputé attachant très peu d’importance aux choses matérielles. Il était passionné, totalement absorbé par son métier et sa femme n’avait pas eu envie d’aménager la maison, de sorte qu’il y avait des cartons qui traînaient encore ici et là et qu’il n’y avait de meubles que le strict nécessaire. Pourtant Alma m’avait bien dit qu’elle et ses trois frères vivaient là depuis des années.
Valentine habitait la ferme d’à côté et Alma y allait souvent comme si c’était un deuxième foyer. Valentine semblait être toujours là, aussi immuable que les arbres ou que la ferme, dans mon esprit, elle faisait un avec la maison et ses alentours.
Ma mère était contente que j’aie trouvée une amie qui était « comme il faut » contrairement à mes autres copines qu’elle trouvait vulgaires. Et puis elle préférait me savoir à la campagne qu’en ville. Cela lui paraissait plus sain, la nature et les gens qui y habitaient ne pouvaient, selon elle, être mauvais.
Et pourtant. Alma avait ses secrets qu’elle ne partageait avec personne, même pas avec moi. Elle lâchait parfois une allusion à ces choses très compliquées que je ne pouvais pas comprendre. Cela me suffisait, même si le mystère autour d’Alma avait été en s’épaississant.
Le temps avait passé, d’autres étaient venues prendre sa place dans mes affections personnelles. Nous nous étions perdues de vue. Elle avait fait des études de médecine, moi de lettres. Elle avait quitté la ville, avait été vivre au Japon, puis en Australie. Elle m’avait invitée une ou deux fois à venir la voir mais ce n’était jamais le bon moment pour moi. Finalement, nous nous étions éloignées de cette période de notre vie, où, à la sortie de l’adolescence, nous avions pensé pouvoir couper les ponts avec ce qui nous paraissait compliqué et triste : pour elle le divorce de ses parents, pour moi la solitude toujours plus épaisse qui était en train de se déposer autour de ma mère.
Il était l’heure de retourner à la pension où m’a accueillie une fraîcheur de savon. La tenancière m’a ouvert la porte et m’a montré ma chambre qui n’était pas celle que nous avions occupée maman et moi. Les persiennes étaient baissées, dans les rais de lumière dansait une fine poussière. Je n’ai pas tout de suite vu le papier peints aux grosses fleurs ni le lit couvert d’une courtepointe verte. Ce que j’ai vu tout d’abord étaient un petit lavabo blanc qui brillait comme un sourire dans la lumière incertaine, une commode massive en bois sombre et une grande armoire à glace. J’ai évité de me regarder dans le miroir et j’ai fait le tour de la chambre pendant que la propriétaire de la pension me regardait attentivement.
- Est-ce que vous croyez aux rêves prémonitoires, m’a-t-elle demandé abruptement.
- Oui, bien sûr, ai-je répondu sans réfléchir.
- Alors vous savez peut-être que lorsqu’on dort pour la première fois dans un endroit inconnu, le rêve que l’on fait cette nuit-là est un rêve prémonitoire permettant de connaître l’avenir.
- Non, je ne savais pas, mais je serai attentive. Merci de m’avoir avertie.
Je ne lui ai pas dit que ce n’était pas la première fois que je passais la nuit dans cette maison. Elle s’est éloignée sur la pointe des pieds comme si j’étais déjà en train de dormir et m’a fait un petit signe de la main.
Une fois la courtepointe retirée sont apparus les draps blancs qui sentaient le produit de lessive et qui étaient frais au toucher. Je me suis laissée glisser nue dans le lit avec soulagement comme si j’étais enfin arrivée à bon port. Du dehors me parvenaient des bruits de voix, le lointain murmure du trafic. Des hommes et des femmes rejoignaient sans doute le lac à la recherche d’un peu de fraîcheur en cette fin d’après-midi étouffante. Je me suis endormie avec encore dans les oreilles la voix d’Alma.
Le lendemain, je suis allée à la gare en me demandant si j’y trouverais bien Alma. Le bâtiment était inchangé à l’extérieur : l’horloge sur le fronton et le bas-relief d’une femme nue accrochée au cou d’un cheval l’emmenant à toute vitesse à travers des nuées.
Dans la gare, une lumière crépusculaire filtrait par la haute fenêtre centrale alors que des slogans vantant des taxes de téléphone portable à prix cassés et des films publicitaires illuminaient les murs, faisant oublier la lumière du jour. J’ai levé les yeux pour retrouver les cartes géographiques qui représentaient la Suisse et l’Europe dont la peinture avait tellement pâli que les noms des villes étaient à peine déchiffrables. Rares étaient les personne qui levaient la tête pour voir si les fresques étaient encore là. Tout autour de moi se pressait la foule de ceux qui s’en allaient ; des enfants qui criaient et couraient en tous sens, des groupes de touristes qui se faisaient et se défaisaient me donnaient le mal de mer.
Le vacarme s’est comme évanoui au moment où j’ai aperçu Alma. Aujourd’hui elle dégageait ce même silence que j’avais perçu la toute première fois où je l’avais vue à la cantine. En m’approchant d’elle, il m’a semblé traverser les années et revenir au point de départ. Arrivée à côté d’elle, j’ai eu l’impression de retrouver une partie de moi que j’avais perdue sans même m’en apercevoir. J’étais à nouveau entière, c’était comme une guérison, un miracle.
Nous nous sommes embrassées et je me suis demandé si elle aussi ressentait ces retrouvailles avec elle-même et avec notre passé.
Nous avons été au guichet où j’avais réservé les vélos. Elle me suivait, ce qui m’a surpris car d’habitude c’était elle qui prenait les initiatives et nous guidait. Mais cette fois-ci je suis partie en avant, ne connaissais-je pas mieux la ville qu’elle ?
- Il fait une chaleur, je ne m’attendais pas à ça, s’est-elle exclamée.
Nous avons roulé au milieu des champs de blé qui n’avaient pas encore été moissonnés. Ils faisaient des taches d’un jaune éteint au milieu des forêts et des prés. Nous pédalions en silence sous le soleil, de temps à autre une voiture pressée nous dépassait. L’espace était rempli d’un bourdonnement morose et il n’y avait plus aucune fraîcheur nulle part. Il devait être midi, l’heure la plus chaude de la journée.
- Il me semble, a dit Alma tout en pédalant, que nous ne sommes jamais sorties de ces trains. Tu te souviens quand nous sommes arrivés à Thurso et que tu as du t’acheter un pull tellement il faisait froid ?
C’était étrange de retrouver Alma. Elle était telle que je l’avais connue, portant avec elle le mystère de notre adolescence. Tout ce que nous n’avions jamais formulé était là et nous reliait malgré nos différences. J’avais retrouvé immédiatement notre ancienne entente comme si les années et l’expérience de vie ne pouvaient pas entamer cette complicité.
A dix-huit ans, nous avions commencé à voyager sac au dos. C’était une manière d’échapper à nos familles. Les parents d’Alma étaient en train de divorcer. Nous n’avions pas envie de nous commettre avec le monde des adultes, nous voulions faire table rase du passé alors nous partions, prenions le train pour traverser l’Europe, du sud de l’Italie au nord de l’Ecosse. Pendant les deux mois d’été que duraient nos voyages, les compartiments devenaient notre maison où nous jouions aux cartes, dormions, lisions.
C’est dans l’un de ces compartiments que nous nous étions juré fidélité. Pas de manière ostentatoire mais implicitement. Dans les gestes que nous faisions l’une pour l’autre. Passe-moi la brosse, tiens-moi le miroir, tu as une serviette hygiénique ? C’était une complicité que rien ne venait ternir même pas l’incursion d’une bande de quatre garçons qui s’étaient installés dans notre compartiment. Les garçons parlaient anglais et deux d’entre eux avaient jeté leur dévolu sur nous. A leurs yeux nous ne pouvions sans doute pas nous suffire à nous-mêmes, à mes yeux pourtant nous étions quelque chose comme un couple et n’avions pas besoin d’eux.
Mais j’ignorais encore que le corps était un champ d’expérimentation pour lequel Alma avait un intérêt quasiment clinique. Elle m’expliqua, lorsque nous nous étions retrouvées à nouveau en tête à tête, qu’il s’agissait de conquérir le plaisir et il ne lui serait pas venu à l’idée que ce plaisir, dont les journaux féminins et l’éducation sexuelle à l’école nous abreuvaient, pouvait être autre chose qu’un objet de conquête. Elle ne parlait jamais d’amour ou alors seulement quand elle disait « on a fait l’amour », d’un air un peu trop dégagé. L’amour était un objet qu’elle avait le pouvoir de façonner à sa guise, qu’elle cherchait à maîtriser ; ce n’était pas un mystère devant lequel elle tremblait. Là était peut-être la raison pour laquelle nous avions si peu à dire de ce qui se passait entre nous et les garçons. Nos corps étaient comme des instruments dont aucune note ne sortait et, parfois, nous nous demandions pourquoi ils restaient si silencieux.
Ce 4 juillet, alors que nous roulons sur la route de campagne, j’ai envie de dire à Alma combien je suis fatiguée de ma vie d’adulte. Mais je ne trouve pas les mots. Elle a toujours ce regard dur et indifférent d’oiseau. Je n’ose pas lui demander comment elle va, si elle est heureuse. Cela parait trop tôt pour avoir des conversations aussi intimes. Je trouve plus rassurant d’être près d’elle sans parler, comme autrefois.
En roulant, je me suis souvenue d’un village au bord de la mer et entouré de forêts. J’avais aimé entendre à la fois le chant des oiseaux et le ressac. Nous avions dormi dans un Bed and Breakfast, le propriétaire nous avait apporté une tasse de thé tôt le matin, sans doute avait-il eu peur que nous restions toute la matinée au lit.
Les rues en pente menaient au port et le silence qu’il y avait dans ce village était très ancien, on sentait qu’il n’avait jamais été rompu.
Alma a ri quand je lui ai dit cela.
- Parce que tu crois qu’il y a des silences différents les uns des autres. Le silence c’est toujours une absence de bruits, non?
Mais moi j’ai maintenu que c’est comme les forêts, il y a les forêts primaires qui existent depuis le début des temps et les autres. Le silence c’était pareil. Il existe des silences très particuliers qui n’ont jamais été déchirés par des bruits de moteurs. Ils sont plus épais, ils ont la consistance du velours bleu nuit un peu usé par le temps.
Alma a ri encore et nous avons traversé la campagne au rythme de nos souvenirs qui remontaient doucement comme des bulles du fond d’une eau peu profonde.
Et, bien que la campagne se soit couverte de petites villas, que les chemins de terre aient été transformés en routes, j’avais l’impression d’être revenue dans le passé.
La route descendait doucement, nous avons pédalé avec facilité. Au loin le lac scintillait dans la lumière trop dure de cet après-midi. Le miroir de l’eau était immobile, ce n’était pas un élément liquide qui s’étendait là mais une surface solidifiée. Des bouffées de chaleur montaient de la terre et dégageaient la même odeur que le corps d’un cheval. Quelque chose de sucré et de sec.