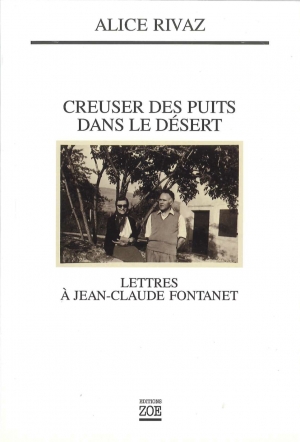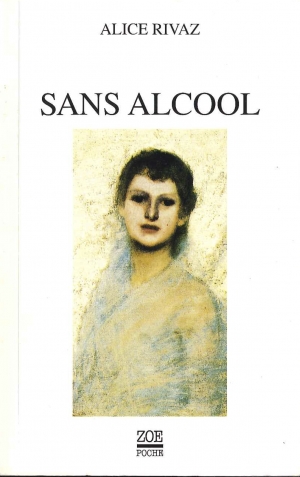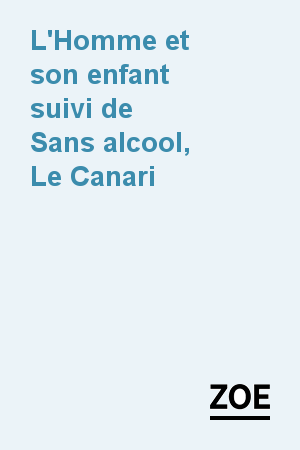parution août 2015
ISBN 978-2-88927-827-5
nb de pages 240
format du livre 105 x 165 mm
Sans alcool et autres nouvelles (nouvelle édition)
résumé
Dans une langue sobre et sans emphase, ces histoires de couples, d’hommes et de femmes déploient la fresque des relations humaines, régies par les inégalités : que ce soit dans les rapports de genre ou de classe, les mots ici sont puissants, capables de faire naître l’espoir comme de le briser.
Postface de Françoise Fornerod.
Alice Rivaz est née à Lausanne en 1901 et décédée à Genève en 1998. Après des études de musique, elle devient journaliste puis travaille comme fonctionnaire internationale. Refusant le mariage, elle voue sa carrière artistique à la dénonciation de la fragilité des classes sociales démunies et à l’engagement pour l’autonomie des femmes. Son activité littéraire, qu’elle mène d’abord pendant la Seconde Guerre mondiale, puis dès sa retraite anticipée en 1959, sera féconde en œuvres de tous types (nouvelles, romans, textes autobiographiques). En parallèle, elle s’adonnera aussi bien à la peinture qu’au piano. De cette auteure prolifique qui a parcouru le XXe siècle, on retiendra la modernité, la forte volonté d’émancipation féminine et la dénonciation des injustices sociales.
L'Echo Magazine
"Cette réédition du meilleur recueil de nouvelles d’Alice Rivaz (1901-1998) est bien plus qu’une œuvre phare d’une grande dame des lettres romandes qui a tant fait avec Catherine Colomb et Monique Saint- Hélier pour la création littéraire suisse dans les années 1930. Il est aussi l’un des recueils les plus cohérents jamais écrits en langue française. C’est dire son importance. Et sa qualité, pétrie de fine psychologie. (…)
Ce qui frappe à la relecture de Sans alcool, c’est la sobriété de sa modernité, son style sans affectation, sa voix douce qui ne hausse pas le ton, y compris face au drame, sa mélancolie qui demeure, même quand la tristesse l’accable, son empreinte sépia, très années 1940-1950, qui n’a pas pris une ride. Sans conteste, Alice Rivaz est une écrivaine remarquable." Thibaut Kaeser
Le Romand bleu
"La France a son Zola, la Suisse romande sa Rivaz. Le rapprochement est quelque peu hardi, j’en conviens. Mais à leur manière, à des époques différentes, ces deux-là décrivent les arrière-cours de leur société, les misères et la précarité d’un grand nombre de leurs contemporains." Daniel Barraud
Valeurs actuelles
"Réédition du meilleur recueil de nouvelles [d’Alice Rivaz] dont l’œuvre est marquée par la quête de l’amour comme idéal impossible. (…) Les 17 nouvelles de Sans alcool sont un précipité de sa manière, délicate, murmurée, inaccessible à l’effusion, et condensent la plupart des thèmes, universels et ordinaires, qui l’obsèdent." François Kasbi
La Tribune de Genève
"Lectrice des rares femmes écrivains de sa jeunesse, Marguerite Audoux ou Colette, Katherine Mansfield ou Virginia Woolf, Alice Rivaz s’est forgé un style littéraire très personnel, au service de l’émancipation féminine." Benjamin Chaix
ArcInfo
"Sans alcool explore la vie intérieure de ses personnages. Une vie intérieure qui entre en résonnance avec les paysages extérieurs. (…) Sans complaisance, les nouvelles d’Alice Rivaz ne manquent pas de souligner les injustices de la société, notamment envers les femmes."
Un article de Laurence de Coulon à lire en entier ici
RTS - Espace 2
« Femmes de papier, femmes de caractère » :
"Versus-Lire consacre une série à cinq personnages féminins de romans qui ont marqué cinq lecteurs d’aujourd’hui. Damien Berthod, directeur de l’information à l’Office de la formation professionnelle et continue à Genève présente Marthe, l’héroïne de la nouvelle "Une Marthe", tirée du recueil "Sans alcool" d’Alice Rivaz."
Réécouter l’émission ici
dans la Tribune de Genève - blog
« Zoé a la bonne idée de republier en poche un recueil d'Alice Rivaz, qui a paru d'abord à la Baconnière, en 1961, Sans alcool. C'est une excellente introduction à l’œuvre de cette écrivaine importante, qui a notamment donné son nom à un collège genevois, à un prix littéraire et à une rame de l'Intercity pendulaire des Chemins de fer fédéraux. (…) La nouvelle Sans alcool est composée comme un journal intime. Il y a d'autres techniques narratives dans le recueil, qui montrent la variété du travail de l'auteur : discours indirects libres, récits à la première personne, narrateur inconnu... Des outils grâce auxquels la talentueuse Alice Rivaz parvient à établir le portrait intérieur de ses personnages, à camper leur environnement aliénant, dans une langue élégante parfois mâtinée d'un brin de Ramuz. »
Alain Bagnoud
dans Esprit
« (…) Les nouvelles, denses, intimes, murmurées, de Sans alcool – occasion et alibi, ici, de son évocation – sont un précipité de sa manière délicate, et condensent la plupart des thèmes, universels et ordinaires, qui l’obsèdent : la passion, la quête de l’amour comme idéal impossible, la solitude, l’échec, le malentendu entre les êtres, le vieillissement, la musique (elle fut une pianiste émérite), la vie quotidienne très quotidienne, le monde des humbles et des êtres marginalisés, l’injustice sociale – soit l’envers du décor bourgeois de la plupart de ses nouvelles. Son prisme : la vie intérieure qui confère à chacune de ses nouvelles une intensité stupéfiante et une allure de tableau dépourvu de pittoresque. Rivaz suggère : en quelques pages, elle installe une ambiance, crée une atmosphère, “ raconte des êtres (sic) ” : (…) Nous la trouvons radieuse, extralucide, illuminée par une lumière intérieure qui est l’autre nom de la clairvoyance – verticale. Alice Rivaz Suisse romande ? Naturalisée humaine, plutôt – comme Nimier dans ses rêves de hussard. »
François Kasbi
24 heures
« Orfèvre dans l'art de la nouvelle
Voilà des textes qu’Alice Rivaz a réunis en 1961 pour les Editions La Baconnière, à Boudry. Des histoires tortueuses de couples suisses romands à l’ancienne. De femmes et d’hommes qui tentaient vainement de s’aimer dans le cadre rigoriste et empesé de structures moralistes relevant d’une période que l’ont dit désormais éculée. Mais l’est-elle vraiment? Le style soyeux qui les dévide est à la fois élégant, «proustien», mais il peut être frais et instantané, «ramuzien», notamment dans les dialogues. Et d’une modernité étonnante. Ces nouvelles avaient paru dans divers journaux et hebdomadaires romands au cours de la Seconde Guerre mondiale. Dans la première, Sans alcool – qui donne son titre au recueil – on est plongé dans les notes d’une diariste qui explore la vie des restaurants. Dans d’autres on entend le piano triste d’une Mademoiselle Lina, on apprend l’anglais dans un contexte drolatique. On s’immerge dans le conte de Noël d’une nécessiteuse. On y retrouve la fameuse Marthe, dont le destin a servi de fil rouge à Valérie Cossy dans son essai. » Gilbert Salem
"Alice Rivaz maîtrise parfaitement l’art de la nouvelle. Dès les première phrases le ton est donné, on est projeté-e dans le quotidien des protagonistes. Il n’y a rien de superflu, l’écriture est sobre, directe mais non dénuée de poésie et on avance inexorablement vers une fin que l’on devine rarement joyeuse. (...) Au-delà de la beauté de l’écriture, il est intéressant de constater que si une évolution a eu lieu malheureusement, certains thèmes sont toujours d’actualité." Yasmina Cordonier
La Paix des ruches (2022, domaine français)
"Je crois que je n'aime plus mon mari." Ainsi s'ouvre le journal dans lequel Jeanne raconte les désillusions de sa vie avec Philippe. Au fil des pages, elle observe ses congénères masculins, époux en tête; note les conversations qu'elle tient avec collègues et amies au sujet de l'amour; et livre une réflexion sans dogmatisme ni discours idéologique sur la condition des femmes et leurs relations aux hommes, "dans un mélange d'acuité impitoyable et d'espoir obstiné" (Mona Chollet).
Préface de Mona Chollet
Pourquoi serions-nous heureux? Correspondance 1945-1982 (2008, domaine français)
Point n’est besoin d’une grande distance géographique pour que naisse une correspondance : un poète et une romancière habitent le même quartier, une même sensibilité et une admiration réciproque les rapprochent, et voici l’échange d’une longue amitié.
ALICE RIVAZ et JEAN-GEORGES LOSSIER ont entamé leur carrière littéraire à côté de leur activité professionnelle lorsque s’amorce, vers la fin de la guerre, leur dialogue épistolaire. Sur fond d’allusions aux difficultés matérielles liées à l’époque, ils s’approchent l’un de l’autre par le truchement de tel personnage romanesque ou la musique d’un vers. Genève et ses alentours dessinent une carte du Tendre où les sentiments sont évoqués avec pudeur et discrétion ; l’OEUVRE, mission sacrée, réunit avant de séparer. Deux caractères se révèlent et se découvrent, vibrent au diapason quelques mois durant puis reprennent leur liberté. Deux oeuvres fortes se construiront dans la durée d’une estime et d’une entente fidèles et nourricières.
Les Enveloppes bleues. Correspondance 1944-1951 (2005, domaine français)
Frappé par une nouvelle signée d’un nom de femme, un auteur célèbre lui écrit pour la féliciter. Elle lui répond. Leur correspondance, à la fois personnelle et littéraire, durera plusieurs années, rythmant la fin de la guerre, accompagnant leurs publications respectives. Comme s’ils étaient soucieux de préserver une part de mystère, jamais ils ne prendront l’initiative de se rencontrer « en vrai », alors qu’ils habitent à quelques minutes l’un de l’autre…
Sur le mode romanesque qui ne lui est pas étranger, c’est ainsi que l’on pourrait rendre compte de l’échange épistolaire entre Pierre Girard et Alice Rivaz. A l’arrière-plan, Genève, ses parcs, ses cafés et ses rues, que tous les deux aiment passionnément ; sur le devant de la scène, les livres en travail, les œuvres à découvrir ou à relire, le monde des éditeurs, des revues et des journaux de Suisse romande. Mais ces lettres sont aussi révélatrices des facettes multiples et parfois surprenantes de la personnalité de deux êtres d’exception. Deux écrivains majeurs que bien des choses séparent, mais qui décèlent instinctivement, par-delà les façades, l’inquiétude souterraine qui les apparente : d’où le sentiment – partagé – que leur correspondance est le lieu d’une vraie rencontre.
Creuser des puits dans le désert. Lettres à Jean-Claude Fontanet (2001, domaine français)
Paru pour la première fois en 1961, ce recueil confirme le talent hors pair d’Alice Rivaz nouvelliste. Il est ici enrichi de quatre textes que l’auteur désirait y adjoindre en cas de réédition.
Histoires de couples, comme « le chemin des amoureux » et « Film muet », ou de personnages solitaires tels « Sans alcool » et « Le petit compagnon », les destins racontés dans ces pages sont marqués par la privation, le renoncement involontaire, les espoirs déçus. Un ton lisse, dépourvu d’emphase, donne une intensité particulière à ces récits où la voix narrative se montre toujours solidaire des personnages.
Née en 1901 à Rovray (VD), Alice Rivaz a vécu à Genève où elle a composé toute son œuvre et où elle est décédée en 1998.
Préface de Françoise Fornerod.
Nouvelle édition poche disponible ici : http://editionszoe.ch/livre/sans-alcool-et-autres-nouvelles-nouvelle-edition
L'Homme et son enfant suivi de Sans alcool, Le Canari (1996, Minizoé)
Sans alcool et autres nouvelles (nouvelle édition): extrait
LE CHEMIN DES AMOUREUX
Elle était sortie par la porte ouvrant sur la cour, derrière la maison, parce qu'il avait été convenu que, ce soir, Denis l'attendrait un peu plus bas, à l'angle de la petite rue, devant le magasin de comestibles. Et, en effet, il était là, nu-tête – nu-tête ! mais qu'est-ce que ça prouve ?
Il se tenait au bord du trottoir où chaque matin de lourds camions déchargeaient leur cargaison de volailles déplumées, leurs caisses d'oranges, d'olives et de pâtes italiennes. Il tournait le dos à la vitrine et regardait de son côté, mais sans la voir encore, car elle restait cachée derrière le massif de lilas aux grappes fleuries sous les averses de l'après-midi. Elle pouvait, ainsi, sans être vue, l'observer à distance, savourer le plaisir sans prix d'être guettée, attendue par Denis, à l'heure dite, au lieu convenu.
Toute la journée elle avait vécu ce moment à l’avance. Il lui semblait que jamais l'heure ne viendrait de couvrir sa machine à écrire et de quitter enfin le bureau, que jamais la nuit ne descendrait sur la ville, les petites places, les coins de rue où des garçons, avec ou sans motocyclettes, attendent des filles, leur main gauche impatiente qui essaie de se contenir au fond de leur poche, et l'autre main qui serre le guidon ou tiraille anxieusement une cravate neuve, ou la pochette choisie exprès, bien lavée et repassée par des mères zélées et aveugles – elles le sont toutes. Et cette crainte qu'elle avait éprouvée tout le jour qu'il ne soit pas là, qu'il ait oublié, changé d'idée, ou pire, qu'il n'ait plus eu du tout envie de sortir avec elle ce soir, car on peut s'attendre à tout avec eux. Sans compter qu'une obligation professionnelle inattendue aurait pu le retenir dans l'internat où il enseignait le latin et le grec. Et comment aurait-il pu l'avertir dans ce cas, puisqu'elle n'avait pas encore le téléphone ? Certes, depuis quinze jours, elle régnait sur une chambre et une cuisine, un divan, un secrétaire Empire, un fauteuil Voltaire, trois chaises cannées, un réchaud à gaz et deux géraniums en pots, mais elle n'avait pas encore de téléphone, ni de rideaux. Pas question de nouvelles dépenses avant sa prochaine « augmentation ». Elle était suffisamment ruinée comme cela, même sans téléphone. Et même sans rideaux.
Mais ces craintes étaient vaines puisque Denis était là, arrivé bon premier au rendez-vous, tête nue comme les autres fois – tête nue, encore une fois, qu'est-ce que ça prouvait ? Qu'il détestait vraiment tous les genres de couvre-chefs et n'en portait jamais aucun, ainsi qu'il le lui avait dit? Elle se serait donc trompée lorsqu'elle avait cru l'apercevoir de loin, avant-hier, coiffé d'un béret basque bleu marine, accompagné d'une femme très élégante, un peu plus petite que lui et vers laquelle il se penchait en marchant, se rapprochant parfois si, si près d'elle qu'il semblait en être amoureux, vouloir oui, vouloir la toucher, s'arrêtant parfois en même temps qu'elle, tandis que se détachait de lui son bras gauche qu'il étendait largement devant lui comme s'il voulait arracher pour elle de l’espace quelque chose ayant une direction ou une dimension mesurable, et même une forme que ce bras était chargé d'amener au jour et à la plénitude. C'était là un geste de Denis, c'est-à-dire d'un homme qui avait l'habitude en classe de donner des conseils et des ordres, de faire appel à ses bras, à ses mains pour prêter vie à un mot, à un passage de Bello Gallico. Certes, il y a tant d'hommes qui portent des bérets basques, et tant d'hommes qui, sans être professeur dans un internat, étendent ainsi largement le bras en parlant, jettent leurs mots à droite, à gauche, comme le semeur sa semence, ou bien en l'air où ils les suivent des yeux, puis les ramènent à eux, les serrant contre leur poitrine, croyant que les mots ne sont qu'à eux et qu'ils n'ont qu'à les faire briller pendant quelques instants, pour les cacher ensuite, et c'est alors comme s'ils les enfouissaient dans leur cœur, ou dans leur poche. Ainsi Denis. Mais était-ce lui ou n'était-ce pas lui ? Sans ce béret, évidemment, ça aurait pu être lui ! Et même si c'était lui, qu'est-ce que ça prouverait en somme ? Ah ! Comment savoir ?…
Mais qu'importe, puisqu'il est là, comme il l'a promis… puisqu'il est là et qu'ils vont faire ensemble une promenade dans la nuit. Et s'il pleut – car la pluie pourrait bien se remettre à tomber – elle espère montrer à Denis son appartement. Et une fois Denis là, chez elle, entre le secrétaire et le fauteuil Voltaire, il lui semble qu'elle saura, qu'elle verra, qu'elle sera sûre... Car, jusqu'ici, impossible de rien savoir avec lui. Impossible d'être sûre... Ainsi, la dernière fois, le dernier dimanche de mars, ils s'étaient promenés ensemble dans la campagne. Eh bien, pas une seule fois il n'avait essayé de l'embrasser ! N'était-ce pas curieux ? Alors, comment savoir ? Il marchait sagement à ses côtés en ne cessant de parler, se penchant seulement un peu vers elle de temps à autre, l'effleurant un peu de son bras, mais à peine et sans avoir l'air de le faire exprès. Pourtant, une fois, elle avait cru qu'il allait lui prendre la main. Mais non, après s'être penché, rapproché un tout petit peu plus d'elle – et voilà qu'elle croyait... qu'elle croyait déjà... eh bien non – il s'était écarté de nouveau comme si de rien n'était, puis redressé, tandis qu'elle s'appliquait à faire de même, se penchait un peu vers lui – comme si une main invisible la poussait, comme si elle avait été une longue herbe balancée par le vent, pliée toujours du même côté – puis se redressait, s'écartait de lui, pour ne pas avoir l'air, bien sûr !... Et pendant une seconde, elle prenait conscience de l'endroit où ils se trouvaient. C'était une route bordée d'un talus et d'une haie faite de charmes et de noisetiers couverts de petits bourgeons verts clairs, tout plissés. Derrière, on apercevait une vieille façade et des volets déteints. Et justement Denis s'arrêtait ; son bras esquissait le large geste dont elle gardait l'image devant les yeux depuis avant-hier, comme si, à elle aussi, il avait voulu non seulement montrer, mais faire don, de la maison, du sentier qui y conduisait, de l’horizon montagneux qui apparaissait, puis disparaissait derrière un rideau de saules. Puis il se reprenait à parler en faisant de nouveau appel à son bras pour tracer au vol – afin qu'elle le vît, afin qu'elle y crût – ce qui ne se trouvait pas dans l'espace autour d'eux, mais en lui. Des souvenirs, des projets, des réflexions sur ses élèves, sur le latin et la décadence et le latin médiéval, sur Juvénal et sur Horace. Cela la ramenait au temps où elle préparait ses examens, pensant devenir, elle aussi, professeur. Mais c’est à peine si elle écoutait, attentive à d'autres mots, à ceux qu'elle espérait et que peut-être il taisait. Elle aurait préféré connaître ceux qu'il taisait à ceux qu'il disait. Car comment savoir avec eux ? Au début, ils sont tous pareils à vos côtés. Ils vous regardent d'un air songeur, ils se penchent légèrement vers vous en parlant, et lorsqu'on marche à côté d'eux sur un trottoir, ils vous poussent peu à peu, sans en avoir l'air, jusqu’à ce que vous soyez coincée contre le mur. Mais Denis, contrairement à d'autres garçons, ne l'avait jamais poussée jusqu'au mur. Il s'était simplement rapproché, puis éloigné d'elle, dans un lent mouvement de pendule, et, lorsqu'ils avaient monté dans le tram pour rentrer en ville, il lui avait saisi le coude très doucement, pour l'aider. Mais est-ce une preuve, cette main qui lui avait pris le coude, sans le serrer, comme si son coude avait été un oiseau à ne pas effrayer, à ne pas blesser ? Et puis ce lent mouvement de pendule ? N'était-ce pas des signes cependant ? Et, bien sûr, Denis s'éloignait d'elle autant de fois qu'il se rapprochait. Mais n'est-ce pas toujours ainsi avec eux, avec nous ? Entre eux et nous? Un éternel balancement qui nous rapproche et nous éloigne tour à tour. Cela commence sur une route, par ces lents mouvements d'épaules. Puis c'est tout le corps qui s'approche, puis s'éloigne. C'est d'abord pendant quelque temps la lente oscillation de deux êtres l'un vers l'autre, puis c'est au long des années, de vastes mouvements d'approche et de recul. Et pendant ce temps, invisible, se poursuit cet autre balancement, tout intérieur celui-là, d'un cœur qui s'évade et revient, puis s'évade. Comme les épaules, la première fois qu'on sort ensemble, qu'on marche côte à côte sur une route Ah! Savoir ! Savoir ! Mais qu'a-t-elle besoin de savoir puisqu'il est là devant le magasin de comestibles et qu'il vient de l'apercevoir et s'élance à sa rencontre.
– Bonsoir Elisabeth...
– Bonsoir Denis.
Il dit qu'il s'est beaucoup réjoui de la voir :
– Et votre appartement, Elisabeth ? Êtes-vous contente ?
La question même qu'elle espérait ! Elle lui raconte l'épisode du chauffe-bain et de l'installation du compteur à gaz.
– Et maintenant, où allons-nous ?
Elle le regarde et ne peut s'empêcher d'épier son geste. Et justement le voilà qui étend le bras dans la direction de la banlieue :
– De ce côté-ci, voulez-vous ?
Son bras reste ainsi étendu quelques secondes.
… C'était peut-être lui après tout... c'était peut-être lui... non... ce n'est pas possible puisqu'il va toujours tête nue, pense-t-elle en emboîtant le pas à ses côtés. Et les voilà qui marchent le long d'un interminable trottoir, et le même balancement qui recommence. Il fait nuit, de plus en plus nuit. Les lumières, peu à peu, s'espacent, l'ombre s'empare de portions de rues, de moitiés de places, de façades entières. Ils sont bientôt hors de la ville. Dès lors, pourquoi ne lui prend-il pas le bras, puisqu'il se tait, comme s'il n’avait plus rien à dire. Peut-être a-t-il compris que le temps n'est plus aux mots, mais au silence, et à tout ce qui s'y nourrit, s'y prépare secrètement, lentement, irrésistiblement. Mais au lieu de lui prendre le bras, le voilà qui s'éloigne. C'est qu'il faut traverser une rue, puis une place pour atteindre une petite gare où sombrent dans la nuit de vieux wagons-citernes et quelques falots rouges posés sur les rails. Mais à ces heures ne passent plus de trains. Même les fenêtres de la maisonnette du garde-barrière, près du passage à niveau, sont éteintes.
– Ah! J'adore les gares, dit-elle. Surtout les petites gares comme celle-ci... Une fois, en prenant le train là, je suis allée à Annecy, une autre fois à Aix-les-Bains...
– Vraiment ?
Il a dit ce petit mot d'une curieuse façon et en se rapprochant brusquement d'elle. « Vraiment » ? Il répète le mot une deuxième fois d'une voix anxieuse, nouvelle, encore plus proche. Si proche qu'elle la sent dans son cou. « Seul, Elisabeth? Vous êtes allée seule ? »
– Vous ne me répondez pas, reprend-il en s'écartant d'elle.
Maintenant sa voix ploie un peu, mais il la redresse en disant : « Moi, j'ai été à Paris »…
À Paris ! Elle respire mal. Il y a des femmes si attirantes à Paris. Et tant de tentations pour un jeune professeur suisse en voyage.
– Ah! continue-t-il d'une voix de plus en plus redressée, comme un fouet avant qu'il ne claque, je voudrais retourner à Paris... Là, on se sent vivre avec plénitude, avec une intense plénitude... Oui, je voudrais retourner là-bas...
Cruel! C'est à son tour de s'écarter, de descendre du trottoir, de gagner le milieu de la chaussée, comme si elle fuyait et voulait marcher seule désormais. Mais il la rejoint d'un bond, et, penché vers elle de nouveau, lui touchant même l'épaule :
– Retourner à Paris, oui, mais avec vous, Elisabeth... Avec vous!
Ah ! Il lui semble qu'elle respire mieux. L'air de la nuit est plein d'odeurs. Du goudron, de la fumée, des bouffées de lilas, l'écorce mouillée de grands platanes. Mais elle presse toujours le pas, comme si elle n'entendait rien.
– Mais voudriez-vous ? ajoute-t-il de cette voix nouvelle, anxieuse, qu'elle ne lui connaissait pas jusqu’à ce soir et qui résonne contre son cou, comme si c’était à son cou qu'il parlait, non à son oreille.
Mais elle ne répondra rien. Elle tient trop bien sa vengeance, la serre entre les dents, la protège afin qu’elle serve, tandis qu'elle presse le pas, s'élance en avant de plus en plus vite.
– Ah ! Je vois bien, dit-il, vous ne voudriez pas.
Il semble déçu. Il la rattrape de nouveau. Sa main pèse sur son épaule, mais elle se dégage :
– Laissez-moi maintenant, s'écrie-t-elle d'une voix furieuse, d'une voix menteuse, car une terrible joie est entrée en elle à cause de cette main sur son épaule. Pourtant, elle le repousse encore, s'éloigne en serrant les dents, les lèvres, mais ce n'est plus sur sa vengeance, mais sur sa joie, car au cœur de cette joie elle pressent autre chose, et qu'elle va savoir enfin, elle va enfin être sûre... Être sûre...
– Elisabeth ! crie-t-il dans la nuit, et d'un bond il lui saisit le bras au-dessus du coude, comme l'autre dimanche, mais cette fois-ci sans aucune douceur.
Son cœur lui saute dans la gorge, comme si son cœur était fou, voulait traverser sa peau, s'échapper d'elle. Ses jambes, c'est le contraire. Elle les sent molles, sans force, incapables de faire un pas de plus.
– Laissez-moi, crie-t-elle, vous me faites mal...
Mais il se rapproche davantage et d'une voix passionnée, colère, terriblement belle :
– Je voudrais vous faire plus mal encore !
Et en disant ces mots, il lui broie le bras. Elle serre les dents, cette fois-ci c'est pour ne pas crier de douleur, mais en même temps elle savoure, comme si elle savait. Ou plutôt comme si elle allait enfin savoir. Il n'y a plus qu'à attendre quelques secondes. Et déjà l'apaisement de savoir bientôt, d'être bientôt sûre, la pénètre. De nouveau elle se sent douce, tranquille. Et tant pis s'il ne dit plus rien. Elle est presque sûre d'avoir compris.
C'est maintenant un sentier frayé entre deux propriétés bordées chacune d'un vieux mur, d'où jaillissent de hautes frondaisons, des grands sapins, des chênes centenaires. Il y fait noir comme dans un four et le passage est si étroit qu'ils ne peuvent marcher sans se toucher. Elle sent d'abord le contact de sa hanche contre la sienne, puis son bras qui la saisit au-dessus du coude, mais de nouveau avec beaucoup de douceur, comme s'il ne voulait plus lui faire de mal, mais au contraire tout le bien possible. Et justement voici un endroit encore plus sombre, comme une toute petite nuit à leur mesure, taillée dans la grande nuit de tout le monde. Elle s'arrête. Il fait de même, lâche son coude. « Qu'y a-t-il, Elisabeth ? »
Elle ne répond rien. Elle soupire. Ah ! comment osera-t-elle ? Mais elle ne peut plus s'en empêcher. Lentement elle lève la main, hésite, la pose sur le revers de la veste entrouverte. Puis, comme si son autre main était jalouse, avait son idée elle aussi, la voici qui s'avance à son tour dans la nuit, se pose en tâtonnant sur l'autre revers.
Lui, il ne dit rien, ne bouge pas, ne respire presque pas, comme s'il avait peur de faire fuir quelque chose, ces deux mains de jeune fille qui se posent, qui cherchent... mais qui cherchent quoi ? Il ne sait pas. Elle non plus ne sait pas très bien ce que cherchent ses mains. Elle sait seulement ce qu'elles trouvent, les boutons d'une veste, puis, plus haut, entre les revers du col qui s'écartent, comme au cœur d’un monde immense et mystérieux, la douce popeline d'une chemise d'homme et les deux bouts flottants d'une cravate. C'est si beau, si bouleversant, que ses mains ont peur, qu'elles se retirent comme si quelque chose les avait brûlées, mais ce n'est pas pour longtemps, non, les voici de nouveau qui rampent, qui avancent peu à peu avec beaucoup de précaution, glissent sur l'étoffe, à la recherche d'endroits plus rassurants, sur la petite poche d'où sort le bout du stylo et l'ourlet d'une pochette de fil. Puis elles reviennent sur les revers, découvrant une boutonnière, un pli ; se promènent comme si elles voulaient brosser les revers, très légèrement, de crainte de faire mal à cet habit, à ce tissu épais comme le sont ceux des hommes, si épais, mais dessous est la toile de la chemise souple qui recouvre la peau vivante, le torse plat, dur et chaud. Doucement se posent toujours ses mains, doucement et en tremblant de peur, mais ce n'est pas seulement de peur... Puis ses mains montent de plus en plus haut le long des revers. Maintenant elle lève les bras aussi haut que le veulent les mains. Est-ce là qu'enfin elle saura ? Oui, peut-être. Car tandis que ses bras se lèvent, Denis se penche brusquement, l'attire à lui avec violence. Maintenant les deux bras qu'elle a passés autour de son cou se referment. Et les deux bras que Denis a passés autour de sa taille se referment eux aussi. Elle se dresse sur la pointe des pieds jusqu'à ce que son visage touche le sien, jusqu'à ce que la fraîcheur de la nuit posée sur ses lèvres se mêle à la fraîcheur de la nuit posée sur les lèvres de Denis. Maintenant sa bouche n'est plus seule mais pressée et broyée. Sa taille est ployée dans la nuit. Aucune place de son corps n'est plus seule, chacune est entourée de tous les côtés, enveloppée, serrée, tenue. Maintenant ses seins sont tenus à leur tour. Puis ce sont ses hanches. C'est comme si elle était entourée de colliers, comme si un nouveau vêtement était cousu sur sa robe. Et même ses oreilles reçoivent quelque chose de doux, de pressé, de murmurant ! Ah ! est-ce qu'elle sait maintenant ? Qu'importe ! N'est-ce pas cela qu'elle voulait savoir, et qu'a-t-elle encore besoin de savoir autre chose? Elle est presque sûre, en somme… presque sûre...
Mais que dit Denis tout à coup en étendant la main, en l'air, dans la nuit. Tiens ! Il s'est mis à pleuvoir. Mais n'avait-elle pas souhaité la pluie ?
– De toute façon, dit-il alors, nous ferions mieux rentrer en ville. Nous pourrions aussi prendre un grog dans un petit café de banlieue, à moins que...
– À moins que, Denis? Son cœur s'est remis à battre. Elle se serre contre lui.
– J'avais un peu espéré, Elisabeth...
– Espéré quoi, Denis ?
Ah ! si seulement.., si seulement...
– Que vous me montreriez ce soir votre appartement... Et puisqu'il pleut...
– Bonne idée… répond-elle d'un ton détaché. Pourquoi pas? Il fait froid, ne trouvez-vous pas ?
Il lui tâte les cheveux dans la nuit.
– Mettez au moins votre foulard sur la tête, mon amour…
Mon amour! Oh! Comme elle sait maintenant, comme elle est sûre. Presque trop. Elle pourrait desserrer un peu son étreinte, mon amour...
– Et vous ? dit-elle, et vous, Denis ?
– Oh! moi, répond-il en dégageant son autre main et en la plongeant dans sa poche pour en retirer quelque chose. J'ai un béret.
Un béret !
– Je croyais que vous alliez toujours tête nue, balbutie-t-elle en se dégageant à son tour pour essayer de voir le béret. Mais dans l'obscurité elle voit mal. Et puis, tous les bérets basques ne se ressemblent-ils pas? Je croyais que vous alliez toujours tête nue? bafouille-t-elle encore.
– Presque toujours, mon amour, presque toujours... répond-il.
Il ajuste le béret sur sa tête, lui prend le bras gentiment, un peu comme un mari cette fois-ci. Mais est-ce une preuve ?
Ah! Comment savoir maintenant? Comment savoir avec eux, avec lui, afin d'être tout à fait sûre, tranquille, heureuse. N'y a-t-il pas d'autres moyens que celui-là ? Non, non, il n'y en a peut-être plus d'autres. Sous la pluie elle s'enhardit :
– Eh bien, allons chez moi...
Il lui prend alors les deux mains et pose longuement ses lèvres sur l'une, puis encore plus longuement sur l'autre.
Il n'y a plus qu'à refaire le même chemin en sens inverse, mais si serrés cette fois-ci, l'un contre l'autre, si enlacés, que dans la nuit pluvieuse d'avril ils ne semblent qu'un.
Puis il n'y aura plus qu'à monter un escalier au fond d'une cour, à mettre une clé dans une serrure, à ouvrir et à refermer une porte. Mais sera-ce vraiment là, à ce moment-là qu'elle saura, qu'elle pourra vraiment être sûre... ?
Comme si on était jamais sûre de quoi que ce soit dès qu'il s'agit d'un garçon. Et qu'on l'aime.