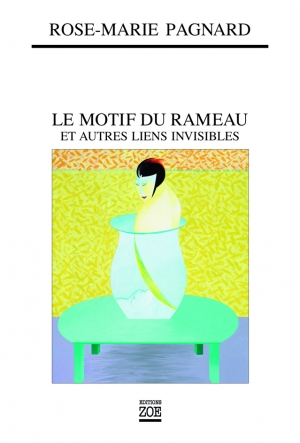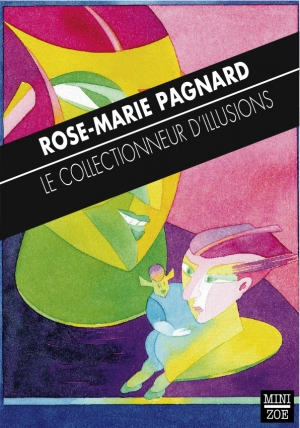parution octobre 2016
ISBN 978-2-88927-362-1
nb de pages 208
format du livre 140x210 mm
Jours merveilleux au bord de l'ombre
résumé
Dans une petite ville des années 60, Brun, génial garçon de treize ans et sa petite soeur Dobbie ne supportent plus la réputation de voleur qui menace la vie de leur père. Une terrible injustice, d’autant plus que le voleur, le magistral escroc n’est autre que leur oncle Räuben Jakob, directeur d’une fabrique de feux d’artifice et astucieux bienfaiteur... Passant de leur misérable logis à la villa de leur oncle, Brun et Dobbie pourchassent une vérité qui ne cesse de s’esquiver; d’ailleurs, n’y a-t-il pas de multiples vérités?
Inventifs et solaires, ils charment tout une bande de partisans de la justice. Dobbie s’amourache de chacun, Brun tient des propos désabusés d’adulte plein d’expérience, tandis que le comte Mato Graf, le professeur de violon, le marchand de cristal, les frères Jakob et d’autres se laissent aller à des comportements puérils qui provoquent, chez le lecteur, un indéniable sentiment de danger.
Rose-Marie Pagnard a notamment publié La Période Fernandez (1988, Actes Sud, prix Dentan), Dans la forêt la mort s’amuse (1999, Actes Sud, prix Schiller), Janice Winter (2003, éditions du Rocher, Points Seuil), J’aime ce qui vacille, 2013, Zoé, Prix suisse de littérature).
Le Temps
"Tout est déjà dans le titre: Jours merveilleux au bord de l'ombre. La lumière, l'émerveillement devant l'existence, les zones obscures de l'âme où se perdent les personnages de Rose-Marie Pagnard, la promesse d'un conte fantastique nimbé d'inquiétude.
Depuis presque trente ans, une dizaine de romans, des récits et des nouvelles dessinent les contours d'une œuvre toujours surprenante, parfois sur le fil d'un fantastique à la poésie convenue, mais qui sait s'en détacher pour renouer le fil d'une histoire souvent cruelle sous ses habits de fête. (...)" Isabelle Rüf
Le Courrier
"... Rose-Marie Pagnard peint ses personnages dans leur complexité, leur conférant sans cesse de nouvelles couleurs, surprenantes et chatoyantes; elle joue avec les contraires, toujours au bord de l'ombre – du mystère –, comme le suggère le titre du roman. Dans son monde étonnant, le bien se change en mal, l'invraisemblable devient banal, l'imaginaire se retrouve sur le même plan que le réel – à moins que ce ne soit l'inverse.
Elle laisse aussi la place à l'irruption du hasard, à des interruptions quasi féériques, sa prose évoluant avec une grande liberté de ton comme de logique narrative. Ce roman solaire n'enferme rien, sinue et déroute, désarçonne le lecteur. Ceux qui savent faire appel à leur esprit d'enfant adoreront." Anne Pitteloud
Le Quotidien jurassien
"... lire Rose-Marie Pagnarg, c'est accepter fe se mettre à nu (...). Dénuder son âme pour accepter cette espèce de frivolité de ton et d'écriture, qui dissimule avec élégance les douleurs de la vie quoditienne. Car Pagnard n'épargne à ses lecteurs aucun des chemins buissonniers de la lecture. (...) Sentiers détournés, clins d'œil à toutes ces petites choses qui, sous sa plume, se muent en instants de poésie. Mais qu'on ne s'y trompe pas: les virevoltes des personnages cachent toujours un combat, celui de la vie et de l'amour dans un sens noble (...) Pagnard s'y entend pour ne jamais aller là où pourrait l'attendre le lecteur (...), le précipitant dans un labyrinthe dont il ne détient aucun fil. Plonger sans filet raisonnable, et l'histoire se transforme en conte pour adultes pas sages." Bernadette Richard
L'Hebdo
"... La langue de Rose-Marie Pagnard, sensuelle, imagée, candide mais sage, bien charpentée mais d'une finesse inouïe, s'apprivoise comme un grand vent enveloppant, une couverture chaude qu'à chaque phrase on tire un peu plus à soi. (...)" Isabelle Falconnier
Le Nouvelliste/L'Express/La Côte
"...Le talent de la romancière jurassienne Rose-Marie Pagnard tient à sa capacité à traiter de nouveaux sujets dans un style propre. (...) A travers sa constante recherche du mot, de la figure, des images fulgurantes se présentent à elle, façonnant son théâtre intérieur, des images portées par sa fascination pour la clarté des songes, et qu'elle restitue au lecteur avec exigence et sans ménagement, le poussant allégrement dans une spirale dangereuse, sans fond. (...)" Vincent Bélet
Livres Hebdo
"... Dans le monde de Rose-Marie Pagnard, le merveilleux éclaire le tragique et le rêve est une des dimensions de la réalité. Elle emprunte (...) au conte et à la parabole quelques-unes de leurs formes pour évoquer l'innocence et la culpabilité, la jalousie fraternelle, mais aussi les solidarités, les liens que nulle richesse ne peut acheter. (...) la communauté qui rapproche des individus en marge, l'art et ici en particulier la musique constituent un salut, un mode de résistance, un chemin sur le fil d'une justice incertaine qui, comme l'imagination des enfants, fait des tours et des détours." Véronique Rossignol
"Ne jamais manquer un nouveau livre de Rose-Marie Pagnard!!"
Véronique
Gloria Vynil (2021)
Porter en soi une amnésie comme une petite bombe meurtrière, avoir cinq frères dont un disparu, vivre chez une tante folle de romans : telle est la situation de Gloria, jeune photographe, quand elle tombe amoureuse d’Arthur, peintre hyperréaliste, et d’un Museum d’histoire naturelle abandonné. Dans une course contre le temps, Gloria et Arthur cherchent alors, chacun au moyen de son art, à capter ce qui peut l’être encore de ce monument avant sa démolition. Un défi à l’oubli, que partagent des personnages lumineux, tel le vieux taxidermiste qui confond les cheveux de Gloria et les queues de ses petits singes. Avec le sens du merveilleux et le vertige du premier amour, Gloria traverse comme en marchant sur l’eau cet été particulier.
Rose-Marie Pagnard jongle avec une profonde intelligence entre tragique et drôlerie pour nous parler de notre besoin d’amour.
Le Conservatoire d'amour (2014, Zoé poche)
Deux sœurs adolescentes, bien que soumises à leur père, lui faussent compagnie et fuguent vers leur amour de la musique. Elles prennent alors leur flûte et disparaissent. Le chemin du Conservatoire est pavé d’épreuves singulières, mais rien n’arrête Gretel et Gretchen qui veulent être admises au paradis de la Musique.
Un roman, un conte, une histoire de passion pour la musique, une enquête-opéra qui revisite la Flûte enchantée. Rose-Marie Pagnard est l’auteur d’une œuvre aux pouvoirs subtils, dix romans et recueils de nouvelles dont Janice Winter et J’aime ce qui vacille.
J'aime ce qui vacille (2013)
Comment les parents de la jeune Sofia retrouveront-ils la force de vivre après sa mort ? Illmar, le père, lance alors le projet d’un bal qui réunira tous les habitants de la tour où il vient d’emménager avec sa femme – comme si les vies apparemment ordinaires de leurs voisins allaient les aider à comprendre le drame de Sofia et peut-être les sauver des eaux noires du chagrin. Mais tel un reflet du monde, la tour se révèle être un empilement de vies vacillantes, de destins tous farouchement tendus vers la douceur et la joie intérieure.
J'aime ce qui vacille a reçu le Prix suisse de littérature 2014
Laudatio de Marion Graf
J’aime ce qui vacille, le onzième roman de Rose-Marie Pagnard, mêle les genres et les tonalités avec une évidence toute musicale. C’est un roman et c’est un conte, ou même une comédie ; une fiction primesautière et ironique, et un poignant livre de deuil personnel; une plongée dans les eaux noires du chagrin et de la culpabilité, et une explosion de couleurs, de matières et de mots chatoyants.
Deux ans après la mort de leur fille, toxicomane, ses parents, Sigui et Ilmar, semblent s’éloigner l’un de l’autre, chacun se retranche dans son deuil, face au vide : elle dans ses errances, en quête d’une vérité impossible, lui dans ses rêves et son travail de costumier de théâtre. Alors s’engage ce roman grave et dansant, sur le tranchant de la solitude et de l’amour, de la douleur et de la fête, entre la vie et la mort, la lucidité et la folie qui guette. Peu à peu, dans les sept étages de la tour vacillante où vivent Sigui et Ilmar, les portes s’ouvrent sur d’autres personnages assez excentriques, naissent des solidarités, autour d’un projet saugrenu et peut-être salvateur.
La perspective est surtout celle de Sigui, le livre est rythmé par ses retours en arrière, somnambuliques ou réalistes, et par les sollicitations et les interactions du présent, par tout ce qui la dérange comme une violence faite à son deuil, et l’arrache à son jardin noir. Exclamations et questions sans réponse, bribes de dialogues, rencontres et tohu-bohu métamorphosent peu à peu son monde intérieur.
A l’heure où domine l’autofiction, Rose-Marie Pagnard recourt avec bonheur aux détours de l’art et de l’imaginaire pour affronter la réalité.
Marion Graf
Ce qu'en dit l'auteur (texte paru dans la revue des belles-lettres, 2012, I):
"Entre elle et lui un contrat moral est signé. Il oublie sa signature. Elle oublie cette histoire. Elle et lui ne se reconnaissent pas dans l'ascenseur. Dans un fatras d'intentions le contrat se perd. Un contrat aux conditions particulièrement rudes pour elle comme pour lui qui préfèrent l'oublier, se sentir libres, libres, libres, et en bonne santé. C'est dans l'air du temps. Cependant. Cependant ici et là des contrats tout aussi rudes sont à la lettre respectés, dans toutes sortes de domaines, entre deux personnes, voire entre une personne et elle-même, mettons, entre un écrivain et lui-même.
Plus je veillis, plus je suis consciente de cette étrange anticipation. Longtemps avant de tracer le premier mot d'un roman, ce symbolique contrat occupe mon esprit (c'est à la fois grave et excitant). D'une part je sais que je m'y mettrai, à ce roman, oui, la chose est entendue au plus profond; d'autre part je ne sais plus rien, je me sens dans mes petits souliers, un peu, comme avant un mariage secret, radical (divorce interdit), aventureux, plein de responsabilités envers moi seule quoi qu'il arrive (ce dernier point surtout me trouble).
Sur cette confidence absolument inutile au lecteur, je me permets une remarque utile à la vérité. J'ai quelquefois l'impression que l'art est considéré comme le sujet unique de mes romans. Or, c'est un sujet parmi les autres, un sujet que j'aime, mais qui ne saurait réduire, dans ces romans, la vie des personnages, la vie prosaïque, ou poétique, l'intrigue, le romanesque..." Rose-Marie Pagnard
Maman Reinhold, ex-cascadeuse convertie en protectrice de l’innocent et dangereux Leonard ; Ben Ambauen, écrivain et chasseur de lièvres ; la fille d’un marchand de vaisselle transformée en héroïne de conte ; Ennry Pinkas, juriste dont la petite taille cache une imprévisible folie ; un extravagant éditeur qui se croit « sans imagination » ; la ville de Bergue et Tokyo la mégalopole : le lien entre ces personnages et ces lieux s’appelle Ania.
Ania, fille adoptée, élève forcée du Foyer des enfants spéciaux, est devenue l’épouse d’Ennry. Elle incarne ici l’amour absolu, mais aussi l’incroyable aptitude qu’ont certains êtres à supporter les vicissitudes de leur destin.
Ce roman à l’écriture musicale et ardente est un éloge à la force de l’imagination. « J’essaie de me relever, mais je suis fatiguée d’entendre la réalité et le rêve penchés sur moi à plaider chacun pour son compte, en japonais ! » Mais voici que le hasard saute dans l’histoire…
Le Collectionneur d'illusions (2006, Minizoé)
Les trois récits de ce livre se répondent par le thème de l’art et grâce à leur personnage principal, Cornelius. Dans «Le collectionneur d’illusions», il raconte comment son père, après sa ruine, suit à la trace, en parfait illusionniste, sa collection d’œuvres d’art perdue dans des hôtels et des restaurants de luxe. «Figures surexposées» est une véritable allégorie surréaliste de l’inspiration et de la création artistiques. «Le violon de ma mère» fait la part belle au pouvoir imprévisible de l’imagination grâce à la mère de Cornelius, une vieille aveugle qui invente un monde invisible.
Postface de Doris Jakubec
Jours merveilleux au bord de l'ombre: extrait
Mon père un jour annonça qu'il attendait le retour de son frère Räuben parti depuis des années dans les régions désertiques et glaciales du Sud.
Il répandit nos ultimes provisions sur la table recouverte d'une nappe blanche, usée et cependant d'un effet riche et solennel. Oui, il se réjouissait sincèrement de ce retour qui allait enfin rétablir un monde juste et par conséquent simple.
— Ton frère n'a jamais vécu ailleurs que dans cette ville, dit ma mère affolée devant cette invention proprement démente de mon père.
— Oh si ! dit-il, il s’est perdu mais il revient, il revient !
Cette nuit-là, oncle Räuben arriva de très loin à une heure extraordinairement tardive, son chapeau à la main, les cheveux d'un rouge clownesque, pour nous emmener, mon frère et moi, dans sa voiture couverte de neige. Son fusil de chasse pesait sur mes genoux, des coups de feu furent tirés d'une fenêtre tandis que la voiture enfilait à toute allure la ruelle. Je me tordis de rire, puis le caractère caché et vraiment déloyal de cet enlèvement faillit m'étouffer dans mon rêve et dans mon sommeil, jusqu'à ce que ma mère se penche sur moi, me caressant le visage et maudissant les hallucinations de mon père.
Sa réputation de voleur entraînait mon père dans des extravagances que ma mère, mon frère et moi partagions entièrement, serrés en petite troupe de nains débrouillards.
Mais ce prétendu retour de Räuben, cette prétendue heureuse attente du géant Räuben ! cette pure, naïve illusion ! Non, nous ne pouvions l'avaler.
— Tu es stupidement bon, dit ma mère.
— Il revient ! Il ne peut pas s’en empêcher ! se défendit mon père, avec tant de foi que pendant des jours je m'imaginai qu'oncle Räuben avait réellement voyagé dans un endroit du monde où l'on était obligé de tricher, de mettre le mensonge à la place de la vérité, de jeter son propre frère sous une guillotine pareille à celle de notre cuisine. Ainsi mon oncle allait et revenait, allait jusqu'à l'injustice et retour.
Va-t’en ! disais-je alors secrètement, mais je courais ouvrir la porte de l'appartement, je scrutais l'espace sournois du corridor, je sentais le parfum de Räuben Jakob, je priais pour que mes relations avec lui restent inchangées, mi-froides, mi-tendres, j'allais voir l'état des toilettes communes placées à l'étage supérieur et dont la porte en bois battait avec une horrible désinvolture, puis je retournais dans la chambre et tout rentrait dans l'ordre, il y avait nous, il y avait l'injustice, il n'y avait pas de changement.
Pourtant si. Mon père était toujours plus efflanqué, plus pâle, il tenait sa tête encombrée d’allégories simplistes, prête à chuter dans un de ces tonneaux de poudre noire qu'il manipulait à la fabrique de feux d'artifices, ma mère émiettait du pain à une des fenêtres de la ruelle, mon frère avait douze ans, mon frère étudiait le latin et les mathématiques et croyait parvenir un jour à comprendre le langage des lois et à mesurer la tension entre l'argent et le sentiment de liberté, au-dessus des toits en dents de scie des mouchetures sombres dessinaient un chien dalmatien les pattes allongées au milieu d'un nuage blanc, pas une couleur, pas un son, jusqu'à ce que Monsieur Schwarz, notre voisin et professeur, fasse quelques pas dehors en chaussures queue-de-renard, son violon et son archet continuant un air sans qu'on sache comment cet air avait commencé ni comment il allait finir.
Pour sa part ma mère cherchait des moyens concrets de renverser le sort. Ses doigts délicats de fille autrefois privilégiée pianotaient sur le front de mon père à la recherche du ressort qui déclencherait en lui l'énergie de régler ses comptes moraux et financiers avec son frère Räuben. Les comptes, justement : l'argent manquait, en trouver prenait beaucoup de temps à ma mère. Elle tapait sur sa machine à écrire, dans notre deux pièces cuisine, le courrier de quelques commerçants en froid avec l'écriture et mauvais payeurs, elle amassait des sommes dérisoires que nous dépensions de manière affectée, les fenêtres ouvertes dans un tintamarre de fourchettes et de cuillères en argent – tout l'héritage de maman. Mon frère s'activait lui aussi, il organisait des spectacles en plein air à la saison des pluies (billets non remboursables), des collectes en faveur d'un futur Club des jeunes cyclistes (mon père président d'honneur), l'argent passait de ses mains dans celles d'un gnome, qui était un comte, qui était notre trésorier, qui était un cas spécial parmi les cas spéciaux, nous. L'injustice dans les yeux de mon père était âgée d’une fraction de seconde, dans le capharnaüm de la petite ville elle datait de plusieurs années.
Il arrivait qu’il achète des cigarettes américaines
Longtemps j'étais restée petite et sans questions, puis à onze ans me voilà à courir sans toucher terre dans notre ruelle, les sons précautionneux d'un violon d'étude s'échappent d'une fenêtre de Monsieur Schwarz et se mêlent aux tintements d'une cloche de cristal, la cloche pourtant depuis des âges immobile dans la tourette de l'hôtel du Corsaire. Je ne la vois pas mais je suis sûre que c'est elle qui se réveille, mise en branle par un doigt mystérieux, ou par l’histoire elle-même, puis détachée de son abri et chantant d'une voix claire de garçon au-dessus de notre ruelle. La cloche et le violon, tout s'engouffre avec moi dans la maison, dans l'escalier en spirale, puis d'un coup m'abandonne, silence, et je ne peux pas faire un pas de plus. Elle est maintenant là aussi, me dis-je, submergée de peur. Et c'est comme si elle se tenait devant moi, réelle et invisible : l'injustice, fixée dans un angle du tourbillon de pierre, prête à bondir sur mon père si celui-ci en rentrant venait à l'oublier et à se comporter normalement.
En levant les yeux vers les lumières qui annoncent le corridor de notre étage, je vis deux grandes ailes pendues dans le vide, merveilleusement découpées, d'un brun mordoré avec des taches bleu mésange. Jamais encore j’avais ne serait-ce qu'entraperçu un ange, je ne croyais pas aux anges, mais ces ailes flottaient, denses et transparentes à la fois, m'obligeant à croire en l'existence d'une de ces créatures. Maman. Maman aux cheveux dénoués.
Elle se pencha :
— Qu'est-ce que tu attends pour monter, Dobbie ?
Ma mère là-haut semblait léviter, les pieds nus comme à son habitude.
— Viens me chercher, dis-je, en espérant mordicus qu'elle allait rabattre d'un coup ses ailes et me prouver de cette façon qu'elle gardait en secret des ailes véritables.
— Dobbie ?
— J'ai vu une saleté dans ce coin, ça me paralyse, qu'est-ce que c'est ? Dis vite une lettre ! ou dis que tu as eu de la visite !
J’espérais la lettre R, je la redoutais, le parfum de mon oncle m'enveloppa, je me mis à penser aux vacances d'automne, aux séjours obligés rue du Succès, avec mon frère, dans les excès de nourriture et de confort et l'excitation me fit presque lever un pied. Non, me dis-je, et je restai sur place, pensant à la faiblesse de mon père qui s’aggravait à chaque fois que nous, ses enfants, étions hors de sa vue, dans les pattes du manipulateur et enchanteur.
— Quoi faire, maman, je ne sais plus quoi faire !
— Voyons, Dobbie, saute une marche, simplement !
Ma mère me serra contre elle, discrètement je tâtais son dos sous l'étoffe de sa robe, à la recherche d'une petite bosse, d'un renflement de plumes, mais je ne trouvai rien. J'inspectais des yeux le corridor, une piste étroite et basse où les ailes merveilleuses n'auraient pas eu la place de se déployer.
— Cette chose que tu crois avoir vue, Dobbie, oublie-la, ce n'est rien de grave, plus tu grandiras, plus tu en découvriras, en général ce sont des pensées tristes.
— Mais j'ai vu… j'ai vu des ailes aussi ! risquai-je en gonflant comiquement les joues pour la faire rire et l'inciter à me confier son secret.
— Oh, vraiment ? fit-elle en m'examinant de la tête aux pieds comme si elle craignait que je sois devenue plus folle que mon père, mon frère et oncle Räuben réunis. Garde-le pour toi, Dobbie, ça passera, ne me complique pas la vie, tu entends ?
Au même instant les voix du violon et de la cloche de cristal sont de nouveau entrées dans la maison et je me suis retournée vers l'escalier : si l'injustice y était, elle pouvait aussi bien être partout ailleurs dans la petite ville, à se montrer à n'importe qui, à débiter sur notre famille n'importe quels contes. L'escalier en hélice n'était qu'un des points d'où l'injustice était jour après jour propulsée, ramenée, relancée, jetée jusque dans nos assiettes et dans notre sommeil, dans le vaste et incontrôlable mouvement du mensonge. Ce mensonge sur mon père étant mystérieusement rattaché à un autre qui faisait de notre grand-père Jakob un invisible génie enfermé à l'hôtel du Corsaire, un bon ou un mauvais génie, je voulais que ma mère me le dise, et puis non, je ne le voulais pas.
Nous avons échangé un sourire dans l'angoisse tendre et précautionneuse et sans paroles.
— Tu as raison, maman, ça passera. Mais toi… est-ce que tu ne travailles pas trop ?
J'avais pris un ton protecteur, je prétendis n'avoir ni faim ni soif, je me sentais bien plus âgée qu'elle, bien plus robuste et ronde. Elle bougea les bras : comme ils avaient maigri ! Ses longs cheveux bougèrent aussi : je les coupe, je les répands sur tout le trajet de notre maison à celle d'oncle Räuben… et puis non, ils lui appartiennent, tout comme ils nous appartiennent aussi un peu, ai-je pensé en m'amusant à les étendre sur ses épaules.
À cette même époque il arrivait que mon père achète un paquet de cigarettes américaines et qu'il aille le rapporter au magasin une heure plus tard, pris d'un tremblement fiévreux puis obligé de se mettre au lit. Le visage blanc comme celui des moutons dans le champ derrière la ruelle, la gorge si contractée qu'il lui était impossible de nous dire pour quelle raison la vague d'impuissance d'un coup l'avait saisi et l'emportait vers la mort.
Au bord des larmes ma mère aussitôt s'en prenait à sa machine à écrire coincée sur la tablette d'une fenêtre de la chambre familiale : elle tapait rageusement, peut-être une lettre à ses parents morts, peut-être un XIe appel au secours adressé au gouverneur en fonction à l'extrême sud du pays et que personne ici n'avait encore jamais rencontré, qui cependant avait permis qu'un jeune secrétaire, diplômé de l'Institut général, ait été un jour, dans cette petite ville, plongé sciemment dans les embrouilles, dépossédé de toute chance, accusé de vol puis jugé à toute allure par les fortes têtes du conseil communal – au sein duquel Räuben disposait inexplicablement de plusieurs voix.
Mon frère et moi restions pelotonnés dans les plis du canapé tandis que la machine lançait tous azimuts les reflets vert pâle de ses messages kafkaïens. Au bout d'un temps mystérieusement calculé, ma mère se levait et se précipitait dans la chambre à coucher.
La porte claque, nous sautons sur nos pieds et nous sommes dans le corridor. Mon frère envoie sa balle contre les murs jaunes et luisants comme du beurre, jusqu'à ce qu'un locataire de l'étage se manifeste. Le maçon étranger est notre préféré, en maillot et caleçon long dès six heures du soir, petit et rond à l'image de ses fiasques de vin, il vient timidement nous regarder, les bambini, il rêve à d'autres enfants et fait quelques passes de balle avec mon frère.