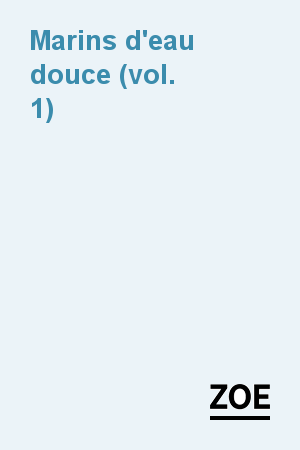parution juin 2016
ISBN 978-2-88927-335-5
nb de pages 192
format du livre 105x165 mm
Marins d'eau douce
résumé
« J’étais petit. J’avais douze ans. Qu’il me semblait large, alors, le lac… plus vaste que la mer et plus profond. »
Ainsi commence ce récit d’une enfance bienheureuse au bord du lac Léman.
Coup de foudre pour la musique, voile, premier sentiment amoureux ou départ loin des siens sont autant d’aventures qui se déploient autour de l’élément central de ce brillant petit roman : le lac, véritable port d’attache pour l’enfant qui parcourra plus tard le monde.
Issu d'une famille de huguenots français réfugiée à Neuchâtel, Guy de Pourtalès, né le 4 août 1881 à Berlin, passe son enfance et sa jeunesse au bord du lac Léman, à Genève et à Vevey, avant de mener des études scientifiques supérieures au Gymnase de Neuchâtel et à la Realschule de Carlsruhe. Il délaisse rapidement le milieu scientifique pour entreprendre des études de lettres à Bonn et Berlin, où il développe sa culture musicale. Ce cosmopolitisme européen détermine la pensée et l'œuvre de l'écrivain marquée par son amour pour la musique. En 1905, il se fixe à Paris, tout en gardant avec la Suisse des liens de famille et d'amitié.
On connaît cet auteur pour ses biographies de musiciens et pour ses romans, dont en particulier La Pêche miraculeuse (1936), vaste fresque historique qui compte parmi les romans de formation les plus marquants de l’entre-deux-guerres. La correspondance de l’écrivain permet de constater les innombrables relations entretenues, à l’échelle du continent, par ce grand Européen, qui fait figure de trait d’union entre les différentes cultures qui lui sont familières.
Mais Guy de Pourtalès a aussi été une personnalité dont l’action ne s’est pas limitée au seul domaine artistique et littéraire. Réintégré sur sa demande dans ses droits de citoyen français, Pourtalès a été mobilisé en 1914, et a été à la fois un acteur et un témoin important de la Première Guerre mondiale. Le point de vue de Pourtalès, par sa précision, sa qualité et son originalité, compte tant sur le plan de l’historiographie que sur celui du témoignage littéraire.
La publication de "La Cendre et la Flamme" (1910) et de "Solitudes" (1913), ses collaborations à la "Nouvelle revue française", à la "Revue hebdomadaire" et la fondation de la Société littéraire de France l'engagent dans la carrière littéraire, interrompue par la Première Guerre mondiale, à l'issue de laquelle il est décoré de la croix de guerre. Revenu à la vie civile, Guy de Pourtalès traduit Mesure pour Mesure, Hamlet et La Tempête de Shakespeare, puis il se consacre à son œuvre de biographe et de romancier, publiée pour l'essentiel aux éditions Gallimard.
Gravement atteint dans sa santé, c'est en Suisse qu'il assiste aux débuts de la Deuxième Guerre mondiale. La défaite de la France et la mort de son fils, Raymond, tombé sur le front de Flandre, le touchent énormément. Il décède le 12 juin 1941 à Lausanne.
Les rives du Léman sont le cadre de ses trois romans: Marins d'eau douce (1919), Montclar (1926), La Pêche miraculeuse, Grand Prix du Roman de l'Académie française (1937). Par contre, l'Europe est celui de ses vies de musiciens qui ont été très populaires en France: La Vie de Franz Liszt (1925), Chopin ou le Poète (1927), Wagner, histoire d'un artiste (1932), Berlioz et l'Europe romantique (1939). Enfin, de l'Indochine où il effectue un reportage pour un quotidien français, il rapporte un récit de voyage: Nous, à qui rien n'appartient (1931). Ses biographies romancées donnent à Guy de Pourtalès une notoriété qui dépasse les frontières de la France et de la Suisse.
Le Temps
"... Tendre évocation d'un monde en train de disparaître, avec le personnage du grand-père et de ses deux matelots, le livre questionne aussi la façon dont se construit le rapport à un lieu. Fluide, le lac n'est jamais figé, toujours changeant. Tout comme les souvenirs, traces éphémères, qui se lèvent parfois, à la surface de l'eau." Lisbeth Koutchoumoff
Journal de la Guerre (2014, domaine français)
La guerre ? « Un paysage qui vous tire dessus. » Guy de Pourtalès (1881-1941) rapporte ces propos, qui l’ont frappé, de son ami Valdo Barbey. L’écrivain genevois, devenu français, mobilisé en 1914, n’a pas connu la tranchée, mais il a passé quatre ans et demi sous les drapeaux comme interprète militaire, propagandiste au Quai d’Orsay, officier informateur. Il a vécu de près les événements de la Grande Guerre, particulièrement ceux qui ont affecté les relations entre sa patrie d’adoption et son pays d’origine.
Tiraillé entre des appartenances et des loyautés qu’il entend faire tenir ensemble, Pourtalès donne l’impression d’être toujours en porte-à-faux avec le rôle qu’il se choisit, ou qu’on lui attribue. C’est précisément cette position d’intermédiaire — symbolisée par le statut d’interprète — qui crée l’intérêt du Journal de la Guerre, parce qu’elle décale le regard, l’enrichit, et donne lieu à un récit à la fois original, informé et communicatif.
Edition établie, annotée et présentée par Stéphane Pétermann
Marins d'eau douce (vol. 2) (1995, Minizoé)
Ouvrage disponible en poche : http://editionszoe.ch/livre/marins-d-eau-douce-1
Marins d'eau douce (vol. 1) (1995, Minizoé)
Ouvrage disponible en poche : http://editionszoe.ch/livre/marins-d-eau-douce-1
Marins d'eau douce: extrait
I
J’étais petit. J’avais douze ans. Qu’il me semblait large, alors, le lac… plus vaste que la mer et plus profond.
Sur les géographies, nous le savions, on l’appelle le Léman. Mais pour nous il était le lac de Genève, parce que Léman ne signifie rien, tandis que Genève est la ville que nous connaissions et dont nous apercevions, là-bas, les toits brillants. Le lac était notre grand ami des jeudis et des dimanches. Nous n’aimions guère la montagne, ni les promenades, ni l’hiver, ni les jours de pluie, parce que toutes ces choses nous privaient de lui. Il était le camarade de nos journées heureuses.
Je savais bien toutes ses couleurs.
Quand souffle le « séchard », il est bleu ; il est vert par le vent du sud, noir par le « joran », mauve par les soirs de calme et rose quelquefois, très tôt le matin.
C’est une toute petite brise du nord que le séchard. Il apporte les journées légères de beau temps. Tout de suite le lac se couvre de voiles. On voit des pêcheurs dans leurs canots, immobiles pendant des heures. On voit, sur l’autre rive, le vieux Mont-Blanc derrière les Voirons. Des barques remontent vers le Haut-Lac. Les fumées s’en vont presque droites dans le ciel et seules les feuilles des peupliers et des saules remuent un peu. Le séchard vous jette au nez toutes les odeurs qui traînent sur le rivage, des odeurs de poisson, d’herbes mouillées, de foins coupés, des odeurs de lac et de village.
Ces journées bleues, grand-père les appelait « la belle saison des amours », lorsqu’il chantait un vieux refrain que grand-mère n’aimait pas. Et moi aussi, comme lui, j’aimais tout le monde ces jours-là, même Jules, le jardinier, qui nous donnait la chasse à travers le potager.
Le vent du sud est un mauvais vent. Il attire les nuages du fond de l’inconnu, les amoncelle derrière le fort de l’Écluse, puis les étend sur notre ciel comme de vieilles nippes sordides qui, par endroits, se défont en longues bandes de pluie. Et le « joran » est un coup d’air qui tombe du Jura, un « grain » brusque, saccadé, colère, inquiétant, soulevé sans qu’on sache pourquoi, s’abattant sur le lac en plaques méchantes, et disparu tout à coup, sans plus de rime ni de raison.
En automne, par exemple, le soir, on entendait subitement le vent dans la cheminée. Un volet tapait contre le mur, on fermait vite les fenêtres partout et, dehors, les feuilles sèches s’envolaient ; on en trouvait tout le long du couloir, au premier étage, et jusque dans les chambres.
« Voilà, disait grand-père, le temps qui se gâte. »
Et toute la nuit le vent sifflait sous les portes et faisait grincer les girouettes. Le lendemain matin je courais au bord du lac. Il fallait le voir alors se ruer contre les murs, contre l’enrochement du port, contre la grève. Il crachait ses vagues par-dessus l’Ibis, la chaloupe de grand-père, qui roulait d’un côté de son ventre à l’autre, en montrant sa quille rouge. Et les deux matelots, Honoré et Filion, venaient aussi, se tenaient immobiles au bout du pont, les mains dans leurs poches, à regarder vers le large. Quelqu’un, parfois, disait que notre lac ressemble à la mer. Mais je n’en croyais rien parce qu’elle est dangereuse, rancunière et terrible. Elle engloutit des navires et noie des pêcheurs qui s’éloignent du bon port hospitalier, tandis que le lac offre partout l’abri de ses golfes, et chacun peut mouiller son ancre où bon lui semble, chez grand-père ou chez ses voisins qui prêtent volontiers leurs bouées et leurs amarres.
« Le lac est notre bien commun, et nous tous, les riverains, nous partageons ses plaisirs et ses dangers. »
Mon aïeul disait encore qu’entre marins tous sont égaux. C’est pourquoi il serrait parfois la grosse main carrée de Filion ou la main dure d’Honoré et celles de tant d’autres hommes qui tirent sur les cordes, et il leur donnait des pièces d’argent pour aller boire un coup au cabaret du village. J’aurais bien voulu les suivre au Café du Raisin, siroter du vin blanc comme eux et les entendre raconter des histoires. Mais souvent je ne comprenais pas les mots qu’ils disaient, ni pourquoi ils riaient, ni pourquoi ils tenaient tant à débarquer, moi qui eusse vécu sur les barques.
Je regardais passer leurs voiles pointues et leurs coques noires. Le soir venait.
Il était là encore, le gamin, sur la rive, mêlé aux choses, aux couleurs, au silence. Les pêcheurs, un à un, s’en allaient. Il écoutait sonner la cloche du dîner. Alors il remontait par les pelouses, regagnait la maison dont le toit, parmi les arbres, faisait une tache grise. Il se retournait. Une vitre brillait à Genève. L’eau était plate, calme, le vent enfui vers le Haut-Lac d’où il ne reviendrait que demain. Et le cœur de l’enfant s’envolait à la rencontre de la nuit, de l’obscure et proche nuit où crieraient les chouettes, où glisserait la lune, où il goûterait, sous les draps, des terreurs délicieuses.
II
La maison était vaste et claire parmi l’ombrage : deux étages, une terrasse avec un escalier à double évolution et des fleurs sur toutes les marches, à droite et à gauche, qui la soulignaient d’un large galon rouge, à cause des géraniums éclatants. Par-devant, dans les champs, des groupes d’arbres espacés, aérés, travaillés par le soleil, se développaient librement et s’arrondissaient comme des bouquets ; plus loin le lac, et, sur l’autre côté, bleuissaient les montagnes de Savoie. Par-derrière, la cour plantée de marronniers, les bâtiments de la ferme, le domaine rural avec ses blés, ses avoines, ses bois et l’horizon qui barre la ligne uniforme du Jura. De tout ce bien grand-père était le maître, ensuite grand-mère, M. Florent, enfin nous deux, Edmond et moi.
Comme les souvenirs d’enfance sont précis ! J’observe que l’image de mon grand-père habite la plupart. Sa bonne figure se promène dans ma mémoire. Elle est vieille, douce, et ne change point. Je ne l’ai jamais vue triste ou méchante. Les punitions que nous infligeait grand-père étaient petites, vite oubliées et suivies de récompenses, car il craignait d’être sévère. « Il vous gâte », avait-on coutume de nous dire ; mais je n’en crois rien ; il ne nous gâtait pas, il nous aimait.
Grand-père s’était marié jeune. Comme il caracolait à cheval, un beau matin, il vit venir sur la route une berline. Deux dames l’occupaient, une vieille et une jeune. La jeune n’était pas jolie, mais mignonne, paraît-il, et ses cheveux lourds, partagés par une raie blanche, ses yeux tendres et toute sa fraîche personne plurent extrêmement à grand-père. Il galopa auprès de la portière et salua les deux dames. Un an plus tard il se mariait et cette jeune demoiselle devint ma grand-mère. C’est elle qui m’a conté la chose ainsi et je n’en sais pas plus long.
Mais grand-mère, telle que je me la rappelle, ne ressemblait plus à cette aimable fille aux cheveux lourds qui s’en venait dans une berline. C’était une vieille dame bien fatiguée. Elle avait le souffle court et quittait rarement le salon. Cependant elle gardait pour son mari une admiration toujours vive et un dévouement quotidien. J’aimais à les voir ensemble et je suppose que mon propre bonheur était comme une miette du leur.
Oh ! qu’elle me plaisait, notre ancienne demeure ! Je nichais sous les toits, dans une chambre mansardée. Ma fenêtre s’ouvrait au beau milieu des tuiles chaudes que je pouvais toucher en allongeant le bras, et les gouttières étaient remplies de feuilles sèches. Je voyais le lac aussi, jusqu’à la pointe d’Hermance, et je savais quel vent soufflait d’après les voiles des barques. La nuit, j’entendais courir les rats dans le grenier proche et, le jour, j’y montais pour regarder les chauves-souris suspendues aux poutres, la tête en bas.
À côté de ma chambre était une pièce mystérieuse. Seule grand-mère y entrait quelquefois et c’est elle qui en gardait la clef. Il y avait deux ou trois caisses là-dedans, couvertes de poussière et remplies de vieilles lettres étranges. Elle n’avaient pas d’enveloppes ; on les avait pliées d’une certaine manière et scellées avec un cachet de cire. Grand-mère en prenait une au hasard, se mettait à la lire, et cette lecture l’absorbait si bien qu’elle n’entendait même pas mes questions. Moi aussi j’en lisais quelquefois une, au hasard, mais avec peine à cause de l’écriture difficile et presque effacée. Lorsqu’elle s’en apercevait, grand-mère s’écriait : « Veux-tu laisser cela… » puis : « Il faudrait absolument mettre en ordre ces paperasses. » Nous repartions en tournant deux fois la clef dans la serrure et l’on n’y revenait que l’année suivante. Mais les caisses n’avaient pas bougé de place et personne n’avait mis d’ordre dans les paperasses.
Tout au bout du couloir se trouvait le laboratoire. C’était le sanctuaire de grand-père et il s’y enfermait des après-midi entiers avec M. Landrizon, son secrétaire, pour faire des expériences. Je n’y fus jamais admis. Mais il y est resté des cahiers couverts de formules fiévreusement consignées et révélatrices encore du trouble, des surprises, des espoirs qu’elles apportaient. Il y a vingt ans ! Le moindre cuistre, aujourd’hui, rirait de ces pauvres cahiers !
À la fin de ses journées de miracle, le vieillard descendait à la bibliothèque avec des feuilles couvertes de chiffres. Sa table en était encombrée.
J’avais aussi ma table dans la bibliothèque. J’y faisais mes devoirs. Mais j’y venais surtout pour lire, car les livres étaient mes amis. Grand-père en possédait des milliers, rangés le long des murs, du plancher au plafond. Rien ne me semblait plus plaisant que leurs dos bariolés. Il y en avait des bruns, des bleus et des rouges. Les plus gros se trouvaient tout en bas. Ils étaient imprimés en caractères anciens que je ne lisais pas bien. Au-dessus se trouvaient les auteurs latins, cuirassés de veau brun ou de vélin. On peut dire que c’étaient de vieux livres, mais grand-père les préférait à de plus riches ouvrages et il les maniait avec un soin pieux et tendre. Parfois il en ouvrait un au hasard. S’il tombait sur un passage favori, il se tournait vers moi, le déclamait d’une voix bien rythmée, en agitant le volume au bout de son bras et il me fallait traduire. Quand je n’y parvenais pas assez vite, il se fâchait et me traitait d’âne bâté. Alors il me l’expliquait lui-même en me faisant observer les images et goûter les métaphores.
En umquam patrios longo post tempore finis,
pauperis et tuguri congestum caespite culmen,
post aliquot, mea regna uidens, mirabor aristas ?…
Les bibliothèques ont une âme douce et secrète. Elles sont comme des cités à la fois mortes et vivantes ; on les visite ; on regarde passer des peuples de fantômes ; on sent fuir entre ses doigts les siècles. J’ouvrais un livre ; je le fermais. L’odeur des livres flottait comme un encens subtil. Souvent je m’installais dans l’ombre, sur un fauteuil, et je n’étais pas sans inquiétude en ouvrant les volumes : ne s’en échapperait-il pas quelque esprit, tout indigné de ma jeunesse téméraire ?
C’est aussi dans la bibliothèque que nous faisions de la photographie. Un jour grand-père était revenu de la ville avec une sorte de boîte noire, carrée, se tirant par-devant comme l’harmonica d’Honoré et portant un gros œil de verre. Grand-mère hocha la tête et grand-père, dès le lendemain, se mit à tout photographier : la maison, le parc, la ferme, le jardin potager, l’Ibis, les poules dans leur poulailler et les vaches à l’abreuvoir. Il m’a dit maintes fois qu’un arbre n’était réellement admirable qu’en photographie. Il avait plus de plaisir à feuilleter son album qu’à regarder ses bêtes lorsqu’on les menait boire, ou sa maison éclatante entre les marronniers. Le plus humble objet prenait de l’importance, avait son relief. Il découvrait à l’instant ses lumineux contours, son ombre favorable, et il s’étonnait d’y avoir pu demeurer si longtemps insensible. Nous développions le soir, après le dîner. Je préparais les trois cuvettes, l’une pour le révélateur, la seconde pour l’eau, la troisième pour l’hyposulfite. Grand-père se hâtait. Il saisissait la première plaque, d’un blanc laiteux, anonyme et sans vie ; j’agitais la cuvette. Brusquement, à la surface polie apparaissait une tache, puis une autre, et nous nous penchions, anxieux, essayant de reconnaître l’image.
« C’était le sentier au bord du lac… Non, c’est Filion… Eh ! l’oncle Paul ; regarde sa barbe et son chapeau à larges bords ! »
Alors un plaisir aigu nous pénétrait à voir le portrait, de seconde en seconde plus détaillé, naître à son inverse ressemblance : les lèvres blanches dans un visage noir, les yeux blancs aussi, les narines comme deux blanches virgules, la barbe neigeuse et soignée de mon oncle transformée en sombre broussaille. Triomphalement nous allions montrer la plaque à grand-mère. Elle nous recevait mal.
« Voyons, Charles, c’est ridicule ! Vous faites d’affreuses taches partout ; ce garçon en couvre ses vêtements et vous abîmez les parquets ! »
Mais grand-père se moquait bien de cela.
« Tiens, regarde… »
La vieille dame finissait par mettre ses lunettes et déclarer que jamais l’oncle Paul n’avait ressemblé à un nègre, que depuis belle lurette ses cheveux étaient blancs.
« Ma bonne, je te l’ai expliqué vingt fois, les plaques sont des négatifs et les négatifs montrent le contraire de ce qui est. »
« Alors comment veux-tu que j’y comprenne quelque chose ! » Et grand-mère reprenait sa broderie.