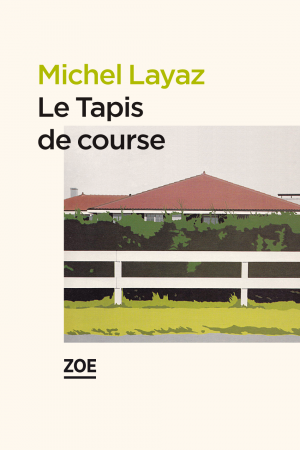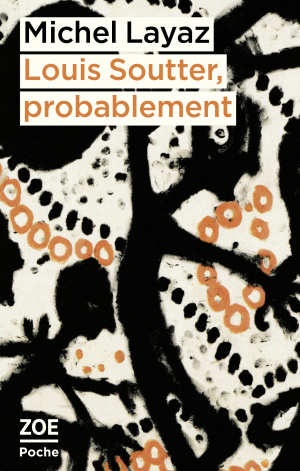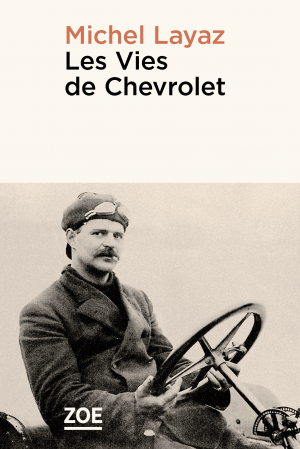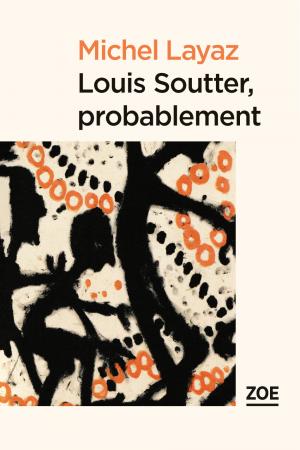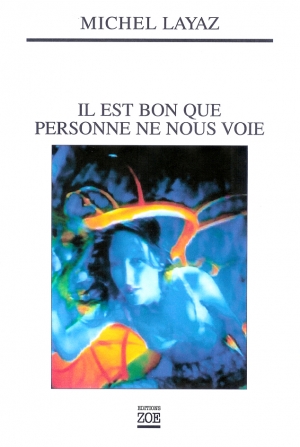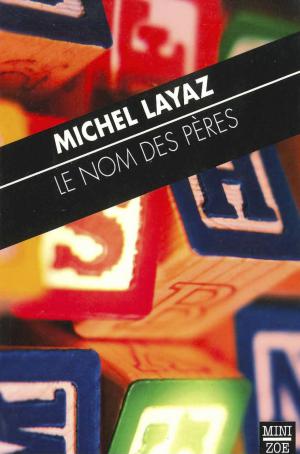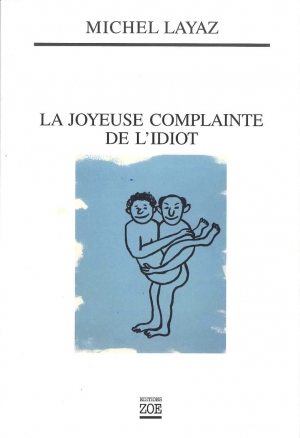parution août 2013
ISBN 978-2-88182-899-7
nb de pages 160
format du livre 140 x 210 mm
prix 26.00 CHF
Le Tapis de course
résumé
« Pauvre type ! » Prononcée avec calme par un adolescent dans une file de supermarché, cette interjection bouleverse son destinataire, le héros de ce livre. Sans le savoir, l’adolescent vient de fissurer la vie intérieure d’un homme qui se protège par une routine sans faille, sûr qu’il est qu’aucun événement extraordinaire ne doit venir briser la logique implacable de l’existence qu’il s’est construite.
Pour éviter que son monde ne vacille, l’homme se résout à s’enregistrer sur son téléphone portable. Il raconte son quotidien : le travail, la bibliothèque, les collègues, le tapis de course, les quelques amis, la famille, la multitude de livres lus pour trouver quelques rares phrases à ajouter à son petit panthéon privé. Rien n’y fait. Le «Pauvre type» le hante.
Michel Layaz vit et travaille à Lausanne. Avec Le Tapis de course, il poursuit une écriture qui révèle, sans en avoir l’air, les traits de notre société contemporaine.
Né à Fribourg en 1963, Michel Layaz fait partie des principaux auteurs romands contemporains. Commencée en 1993 avec Quartier Terre (L’Âge d’Homme), son œuvre littéraire compte aujourd’hui une quinzaine de romans, dont plusieurs primés. Parmi ceux-ci Ci-gisent (Zoé, 1998), écrit à la suite d’un séjour à l’Institut suisse de Rome, Les Larmes de ma mère (Zoé, 2003 ; Prix Dentan et prix des auditeurs de la Radio Suisse romande), ou encore la Joyeuse complainte de l’idiot (Zoé, 2004). Plus récemment, son texte Louis Soutter, probablement (2016) remporte un prix de littérature suisse, le prix Bibliomedia et le prix Régis de Courten; Sans Silke (2019), quant à lui, obtient le prix Rambert. En 2021 paraît Les Vies de Chevrolet.
Viceversa Littérature
"Une insulte résonne sans cesse dans la tête du protagoniste du dernier roman de Michel Layaz: "pauvre type". Prononcée sans agressivité par un jeune homme dans un supermarché, comme un constat longuement mûri, elle laisse le personnage bouche-bée, sans réplique, lui qui a l'habitude d'avoir toujours le dernier mot. Le quadragénaire sent une brèche s'ouvrir qui menace de l'engouffrer, (...) il décide alors de se mettre à parler à haute voix dans sa voiture et de s'enregistrer avec la fonction dictaphone de son téléphone portable. Ce journal vocal compose le texte du Tapis de course.
(...)
[Le texte] fait écho, autour des possibilités et des rigidités du langage, au précédent roman de Michel Layaz, Deux soeurs (Zoé, 2011). Alors que ces dernières vivaient dans l'imaginaire et gagnaient leur liberté dans un monde fantasque, intouchable par la coercition de l'assistante sociale, goûtaient au plaisir des sonorités langagières, dressaient des listes sans queue ni tête, alors que la langue affûtait leur sensibilité, l'homme tient les autres à distance par les mots. Ceux-ci lui donnent un sentiment de maîtrise, permettent de garder toutes choses et toutes sensations dans la zone du clair et du distinct. Sa langue rigidifie les structures tandis que celle des deux jumelles était émancipatrice, anarchisante même. Lui ne supporte pas l'enthousiame, tous ces "alléluias dans les yeux", elles en jouaient.
Mais voilà que l'homme s'est fait traiter de "pauvre type". (...) Le langage se fend et perd son assise impériale. Quelque chose se met en mouvement. (...) Qui sait, recevoir un "pauvre type" en pleine figure peut s'avérer salvateur." Marion Rosselet
RTS, Entre les lignes
"Pauvre type!" Comment deux petits mots de rien, deux mots dits presque à la légère et sur un ton parfaitement neutre, peuvent-ils ébranler toute une vie de certitudes?...
Démonstration brillante et implacable dans "Le Tapis de course", le onzième et dernier opus de Michel Layaz. Un temps
Le narrateur dit "je". Il s'épanche et se répand, mais il n'a pas de nom. Anonyme il est, anonyme il restera - à moins peut-être que celui qui le lit s'y reconnaisse?! -.
Tout commence un sinistre 22 août. Précisément dans la file d'une caisse de supermarché. C'est là que ce pauvre type est lâché avec désinvolture. Je en reste bouche bée. Il bouillonne. Va répliquer, veut frapper "lui bouffer la langue". Trop tard, le jeune homme a déjà disparu. Mais le poison est dans la pomme. Un comble! Notre homme, bibliothécaire de profession, chef du Secteur Littérature et Philosophie de la grande bibliothèque et roi de la pique assassine, en perd ses mots. Faut-il les dire, les écrire? Existe-t-il seulement des mots assez forts pour colmater pareil séisme?
Tantôt truculent, tantôt joyeux, tantôt frondeur ou introspectif, Michel Layaz a déjà amplement démontré son plaisir et son talent à pétrir la langue française. Et bien celui qui avoue entretenir un rapport charnel avec l'écriture, celui qui entend en faire une véritable offrande à la langue, se révèle aujourd'hui tout aussi habile, efficace et impitoyable pour sonder les lâchetés et la noirceur de l'âme humaine.
Marlène Métrailler
Allez savoir
« (…) Le tapis de course, ouvrage troublant et touchant, psychanalyse un personnage détestable mais ébranlé par cette insulte qui ne cesse de le tourmenter. (…) Un récit bien mené, crispant de par l’incarnation très maîtrisée d’un personnage principal agaçant, mais qui rend aussi l’abnégation et la générosité des autres protagonistes encore plus prégnantes. (…) « Oui, je l’ai nuancé, il était encore pire avant », s’amuse le romancier. (…) » Sophie Badoux
La Liberté
« (…) Un Tapis de course au déroulé fluide et souple, sans lourdeur aucune, où Michel Layaz relève avec brio un défi majeur : d’un bout à l’autre d’un roman où le lecteur aperçoit parfois son propre reflet, l’intéresser à la vie de son (anti-) héros, de celui qui va rester, jusqu’à la fin, un pauvre type. » Anne Mooser
La Gruyère
Cruauté ordinaire
« La vie d’un homme banalement médiocre se voit bouleversée par une insulte qu’un adolescent lâche au supermarché : « Pauvre type. » Et alors ? Pas grand-chose. Si ce n’est que le type en question ne s’en remet pas. Que son existence parfaitement réglée vacille.
Observateur pertinent de notre société, le Vaudois Michel Layaz signe avec Le tapis de course un roman réjouissant. Sans effet inutile, il dresse un portrait impitoyable des petitesses ordinaires. Son narrateur, un intellectuel qui travaille sur les écrivains voyageurs, reste un homme lisse et mesquin : « Dans mes recherches, il n’y a aucun élan, aucune passion, mais de la méthode, de la constance, une rigueur rationnelle. » Un père de famille aussi, qui n’oublie pas ses devoirs : « Chaque dernier vendredi du mois, avant de m’engager sur l’autoroute, je m’arrête dans un tunnel de lavage. Que la voiture soit propre, ma femme y tient. » Et tout est de cet ordre, grinçant, cruel et imparable de justesse. » Eric Bulliard
Le matricule des anges
« (…) Michel Layaz a le don de gratter là où ça fait mal. C’est-à-dire là où tout paraît aller pour le mieux. (…) Du tapis roulant de la caisse au supermarché au tapis de course sur lequel le personnage donne corps à la monotonie, Layaz semble vouloir débusquer ce qui, précisément, est tapi au fond de cet homme-là. Ce ne serait pas d’une grande originalité s’il n’y avait ce style à la fois grinçant et cassant, et si l’auteur n’avait cet art de suggérer plutôt que dire. On tient là un genre de satire ou de farce dramatique, en tout cas une tranche saignante de la comédie humaine. » Anthony Dufraisse
Gauchebdo
Des fissures dans le beau décor
"Le Lausannois Michel Layaz fait le portrait grinçant d’un petit bourgeois et brave père de famille suisse dans toute sa banalité et faiblesse.
C’est l’histoire d’un homme. Un homme pas plus cynique, pas plus calculateur, pas plus convenu qu’un autre. Le narrateur, responsable du prestigieux « Secteur littérature et philosophie » d’une grande bibliothèque, voit ses certitudes vaciller lorsqu’il se fait traiter de « pauvre type » dans une fille d’attente d’un supermarché. Cet incident traumatisant va-t-il lui permettre de s’ouvrir ?
Avec le Tapis de course, Michel Layaz dessine avec beaucoup de finesse les contours d’une possible transformation. Ecrit sous la forme du journal intime, son roman plonge le lecteur dans la grisaille d’une psychologie du parfait « mec normal », aussi mauvais mari qu’il est mauvais père et mauvais collègue. Layaz réussit, et c’est là la grande force du livre, à mettre en scène un personnage assez odieux sans jamais en faire trop, sans verser dans la caricature grossière. Ce « je », dont on suit avec intérêt les confessions, ce « je » qui lave sa voiture une fois par mois et couche avec sa femme tous les trente jours, on a l’impression de le côtoyer, de le connaître avec sa lâcheté, ses bassesses, mais aussi avec ses doutes et ses faiblesses.
C’est aussi le parfum de l’époque qu’évoque l’auteur, ou peut-être le parfum un peu écœurant d’un bonheur à l’helvétique, comme semble le suggérer la couverture : la réussite professionnelle, les deux enfants, la maison avec jardin… y aurait-il quelques fissures dans le beau décor ? On a encore beaucoup apprécié le regard grinçant et un brin désabusé porté par l’auteur sur le monde du travail et des collègues, où il est question de minuscules trahisons, de si petits coups de poignards dans le dos.
Ecrit dans un style léger et agréable, le Tapis de course est un excellent roman introspectif, précis et juste, souvent très drôle. S’il fallait un portrait du brave père de famille, le voici peint avec maestria."
Julien Sansonnens
Le Courrier
"On adore ses personnages fantasques et rebelles, les filles qui grimpent aux arbres et inventent des histoires de Deux Sœurs (2011), le rêveur paresseux de Cher Boniface (2009), tous amoureux des livres et de la liberté, antidotes aux technocrates, au quotidien gris et aux convenances. Mais dans Le Tapis de course, c’est justement cet autre point de vue qu’a choisi Michel Layaz : son narrateur est le responsable en chef du « Secteur littérature et Philosophie de la grande bibliothèque » (le plus prestigieux). Froid et dédaigneux, il affiche sa culture pour mieux humilier son monde, vit sans amour avec son épouse laide et leurs deux fils, bardé dans une routine implacable qui le protège contre tout imprévu. Ce rabat-joie terne et mesquin va pourtant voir une faille se dessiner dans sa vie : un jour, au supermarché, un jeune homme le traite calmement de « pauvre type ». Un constat sans appel face auquel il reste muet. Mais la phrase la hantera durablement, au point qu’il commence à parler à son dictaphone lors des trajets qui le mènent à son travail. Une fenêtre va-t-elle s’ouvrir en lui ? La muraille est épaisse…
C’est avec délice qu’on plonge dans l’intimité rigide de cet homme peu aimable, qui se livre sans fard dans la coquille de sa voiture. Il ne cache ni son mépris des autres (ses collègues ou sa famille, où surgissent des sœurs bien connues…), ni sa prétention, se délectant au contraire de ses piques assassines. Chaque soir, il court en intérieur ses 15 kilomètres, douleur exquise qui forge un homme : « Une longue fréquentation du tapis de course est indispensable pour saisir comment la résistance morale amène dans le corps cette souffrance saine, la chair cinglée dans toutes sortes de sensations qui font zigzaguer entre extase et désespoir. » La course est une ascèse, la durée mène à une forme de pureté, et la régularité de son existence est sa force, reconnaît l’odieux personnage. Au fil de son monologue, la brèche ouverte par le « pauvre type » va pourtant s’agrandir. Derrière le vernis glacial, on devine ses peurs et sa lâcheté, sa jalousie, ses capitulations. La carapace finira par se fissurer.
Michel Layaz évite l’écueil de la caricature par une langue riche et chatoyante, qui n’enferme son personnage ni dans la posture du méchant ni dans celle de la victime. On n’est pas non plus ici dans le registre de la rédemption, et la transformation du narrateur n’a rien de spectaculaire. Il reste jusqu’au bout ambigu, contradictoire, imprévisible. Et l’insulte première, de pathétique blessure d’orgueil, creuse simplement son sillon comme l’eau d’un ruisseau fait son lit, de manière imperceptible et patiente, jusqu’à mettre au jour quelques trésors insoupçonnés. Jouissif." Anne Pitteloud
Le Temps
"(...) Du 22 août au 1er juin de l'année suivante, voici donc le journal d'un pauvre type. Michel Layaz s'emploie avec art à remplir ce programme de départ. (...) puis sabote avec délicatesse la belle mécanique mise en place. (...) Malgré la belle mécanique ainsi mise en place, le tapis de course, on s'en doute, va finir par se gripper. Michel Layaz le sabote avec délicatesse, avant d'en éjecter brutalement son héros lors d'une délirante course de nuit. (...) Loin de la veine primesautière de Deux soeurs, son précédent roman, Michel Layaz peint ce portrait singulier avec maîtrise et rigueur. Et son écriture, précise, entraîne avec l'efficacité d'un tapis de course." Eléonore Sulser
L'Hebdo
"Pas facile de captiver le lecteur en le plongeant dans la psyché d'un "pauvre type". Un imbuvable qu'on aurait envie de fuir à toutes jambes. Michel Layaz y excelle. Hypocrite, le narrateur de son Tapis de course rabaisse ses proches et les manipule de manière éhontée. La seule chose qui compte, pour lui, c'est son poste de responsable au département littérature et philosophie d'une grande bibliothèque. Et son tapis de course, qu'il pratique tous les soirs. Ses enfants, sa femme, ses amis, l'espèce humaine en général, ne trouvent pas grâce à ses yeux. Les livres, qu'il prétend adorer, il ne fait que les parcourir en marathonien procédurier, les "piétinant" sans se laisser toucher par eux. Le suspens monte au fil des pages, le lecteur redoute autant qu'il appelle une punition. Mais ce n'est pas le genre de Michel layaz. Pas d'apothéose chez lui, pas d'effets de manches. Il préfère recueillir la petite musique intérieure d'un personnage qui continuera de "mâchonner sa rogne du monde" jusqu'à la fin de ses jours. Le pire, c'est que cet affreux qui nous débecte tant, nous ressemble un peu. Qui n'a eu l'outrecuidance de se considérer supérieur aux autres, pour masquer sa propre médiocrité? Michel Layaz réussit le parfait roman miroir d'un monde cynique." Julien Burri
Vigousse
L'histoire très réussie d'un raté.
"Merveilleusement écrite, sournoisement perspicace, cette nouvelle oeuvre du Lausannois Michel Layaz trace sans détour des aspects peu reluisants de notre société. Et que l'on soit ou non un quadragénaire rance, le récit incite à se demander si l'on a pas soi-même quelques caractéristiques d'un "pauvre con"..." Alinda Dufey
Allemand
Titre: Auf dem LaufbandÉditeur: Verlag die Brotsuppe
Année: 2014
Deux filles (2024)
Après un long voyage en Asie, Olga, vingt-deux ans, rentre à Paris, accompagnée de Sélène, rencontrée dans un cimetière chinois. Quand les deux filles ne récoltent pas des légumes dans des fermes alternatives, elles remettent de la joie chez le père d’Olga, très seul depuis que sa femme l’a quitté. En surface, l’harmonie est totale. Mais plus le père observe Sélène, moins il peut taire le malaise qui monte en lui. Les dessins miraculeux d’un homme sans domicile, un bouquetin sur un étroit chemin de montagne, une femme pâle dans un tea-room: dans ce roman aussi troublant qu’habile, on se met à voir des signes partout.
En déjouant nos attentes, Michel Layaz interroge notre conception des liens familiaux et ce que veut dire donner la vie.
Les Larmes de ma mère (2022, Zoé poche)
Pourquoi cette mère, avec son troisième fils, marque-t-elle autant de différences ? Pourquoi des larmes le jour de l’accouchement ? Devenu adulte, le narrateur reconstitue son enfance au contact d’objets qui ont peuplé son quotidien et qui détiendraient la clé de la relation avec sa mère, cette femme insaisissable mêlant fierté et tourmente, sensualité et mépris.
Louis Soutter, probablement (2021, Zoé poche)
Aujourd’hui mondialement reconnus, les dessins et les peintures de Louis Soutter (1871-1942) n’ont été remarqués de son vivant que par un cercle restreint de connaisseurs. Parmi eux, Le Corbusier et Jean Giono ont été subjugués par le trait libre de l’artiste, vrai sismographe de l’âme. Formé à la peinture académique, violoniste talentueux, marié à une riche Américaine, puis directeur de l’École des beaux-arts de Colorado Springs, Soutter mène pourtant, dès 1902, une vie d’errance jusqu’à son internement forcé à l’âge de 52 ans dans un asile pour vieillards du Jura suisse. C’est là qu’il parvient à donner forme à l’une des œuvres les plus inclassables de l’histoire de l’art.
Il fallait l'écriture souple et subtile de Michel Layaz pour faire ressentir l’étrangeté de cet homme et nous entraîner le long d’une vie marquée par la solitude, ponctuée aussi par quelques éclats de lumière et transportée surtout par la puissance de la création.
Préface de Michel Thévoz
Louis Soutter, probablement a reçu le Prix suisse de littérature, le prix Bibliomedia et le prix Régis de Courten.
Les Vies de Chevrolet (2021)
« Che-vro-let ! Che-vro-let ! » : début XXe siècle, l’Amérique est ébahie devant les prouesses de Louis Chevrolet. Né en Suisse en 1878, le jeune homme a grandi en Bourgogne où il est devenu mécanicien sur vélo avant de rejoindre, près de Paris, de florissants ateliers automobiles. En 1900, il quitte la France pour le continent américain. Très vite, au volant des bolides du moment, Fiat ou Buick, il s’impose comme l’un des meilleurs pilotes de course. En parallèle, il dessine, conçoit et construit des moteurs. Ce n’est pas tout, avec Billy Durant, le fondateur de la General Motors, Louis crée la marque Chevrolet. Billy Durant la lui rachète pour une bouchée de pain et obtient le droit d’utiliser le nom de Chevrolet en exclusivité. Des millions de Chevrolet seront vendues sans que Louis ne touche un sou. Peu lui importe. L’essentiel est ailleurs.
Pied au plancher, Michel Layaz raconte la vie romanesque de ce personnage flamboyant qui mêle loyauté et coups de colère, bonté et amour de la vitesse. À l’heure des voitures électriques, voici les débuts de l’histoire de l’automobile, avec ses ratés, ses dangers et ses conquêtes.
Sans Silke (2019)
Silke se souvient du temps passé à La Favorite alors qu’elle avait dix-neuf ans et s’occupait chaque fin d’après-midi de la petite Ludivine. Embrasser les arbres, apprendre à voler comme les oiseaux, dormir à la belle étoile, neuf mois durant, toutes deux auront vécu côte à côte dans un monde onirique, en marge des parents de la fillette absorbés par leur relation exclusive.
Avec ce nouveau roman, Michel Layaz poursuit son exploration des failles familiales. Il attrape avec précision les gestes d’une enfant qui s’arcboute de joie après un coup réussi au billard, qui se caresse les épaules de satisfaction lors d’un moment d’intense concentration et dont les mots peuvent rappeler ceux des meilleurs poètes : « J’ai envie de larmes ».
Louis Soutter, probablement (2016)
Aujourd’hui mondialement reconnus, les dessins et les peintures de Louis Soutter (1871- 1942) n’ont été remarqués de son vivant que par un cercle restreint de connaisseurs. Parmi eux, Le Corbusier et Jean Giono ont été subjugués par le trait libre de l’artiste, vrai sismographe de l’âme. Formé à la peinture académique, violoniste talentueux, marié à une riche Américaine, puis directeur de l’Ecole des beaux-arts de Colorado Springs, Soutter mène pourtant, dès 1902, une vie d’errance jusqu’à son internement forcé à l’âge de 52 ans dans un asile pour vieillards du Jura suisse. C’est là qu’il parvient à donner forme à l'une des œuvres les plus inclassables de l’histoire de l’art.
Il fallait une langue souple et subtile pour faire ressentir l’étrangeté de cet homme et nous entraîner le long d’une vie marquée par la solitude, ponctuée aussi par quelques éclats de lumière et transportée surtout par la puissance de la création.
Louis Soutter, probablement, a été récompensé du Prix suisse de littérature 2017.
Deux soeurs (2011)
Les deux sœurs. Des agitatrices dont la grâce sauvage se pare de magie ? Des justicières rebelles ? Des adolescentes souveraines entre enfance et âge adulte ? Les deux sœurs ont le droit de vivre seules dans leur maison, c’est le juge qui a tranché. Leur père est reclus dans un hôpital psychiatrique, leur mère vit à New York, c’est ainsi, les deux sœurs l’acceptent, elles aiment père et mère comme ça. Elles vivent sur un rythme rapide, léger, malicieux, parfois endiablé, dans une forme d’allégresse musicale à deux temps. Près d’elles, il y a un grand arbre, des coquilles d’escargot, des fils de fer qu’elles ont délicatement suspendus dans la chambre vide de leur père, il y a aussi un amoureux qu’elles autorisent à venir jouer avec elles et une assistante sociale qui oublie joyeusement sa fonction à leur contact.
Cher Boniface (2009)
Marie-Rose, généreuse, idéaliste et orgueilleuse, aimerait que Boniface écrive. Boniface préfère rester « inoccupé et anonyme, et de loin ». Houspillé par sa belle, Boniface peine à cultiver son indolence désabusée et se voit devenir le héros don quichottesque d’aventures finalement très joyeuses. D’érudit paresseux, il apprend sous nos yeux à devenir gourmand de la vie. Et même passionné. Boniface a l’amour de la différence, Marie-Rose est une enthousiaste critique. Alors tout le monde est égratigné : les riches et les pas riches, les célèbres et les pas célèbres, la pensée unique, les snobs, les travailleurs, les adolescents, les écrivains, les journalistes, les inspirés et les sportifs.
Brillante et acerbe, l’histoire de Boniface Bé et de Marie-Rose Fassa est une diatribe impitoyable mais aussi délirante et farcesque contre la société d’aujourd’hui. Les éblouissantes énumérations opèrent chaque fois un subtil pincement chez le lecteur parce que l’ironie est mordante et qu’une joie vraie s’impose.
Michel Layaz signe ici son huitième roman.
Le narrateur, un garçon de quinze ans, travaille après l’école dans une boucherie. Il y rencontre Walter, un maître en sagesse. Dans le quartier populaire où il vit, le jeune homme est l’ami de Raton, maître de rien, et il se lie d’amour avec Charlotte qui va l’initier à d’étranges rituels et l’aider à grandir.
A la fin du livre, on comprend que ce texte troublant sur l’adolescence est dicté par le garçon devenu très âgé. Tandis que la mort approche, le vieillard vit un dernier amour pour Lucie qu’il surnomme Lucie-Lucifer. Cette infirmière sans égal a découvert un procédé pour que ses pensionnaires préférés puissent choisir en toute quiétude l’instant de leur disparition.
Le Nom des pères (2004, Minizoé)
La Joyeuse Complainte de l’idiot est le récit d’un internat peu ordinaire où vivent des adolescents encore moins ordinaires. En effet, La Demeure accueille de jeunes garçons dont l’intelligence décalée n’a pu s’accommoder du monde environnant. Racontée par l’un de ses membres, cette communauté tire force et originalité de son impérieuse présidente-directrice générale, Madame Vivianne.
«Il ne faut pas croire que les gens qui vivent à La Demeure sont des demeurés, ou des prisonniers, ou des délinquants, ou des fous, ou des brigands, ou de la mauvaise graine, ils sont seulement un peu de tout cela, et il serait vain de les réduire à quelques tours de passe-formules.
Il y a en nous des splendeurs qu’il faut peut-être aller chercher, des splendeurs enfouies sous des couches de désarroi, de tourments, de méchancetés, de désespoir, d’obstination, d’errances, de mauvaises routes, de mauvais choix, autant de dérives qui ne sauraient effacer la bonne pâte qui existe derrière tout cela et qui ne demande qu’à être pétrie.»
Michel Layaz vit à Lausanne et à Paris. Aujourd’hui, il est considéré en Suisse comme un des romanciers les plus importants de sa génération. Après le succès des Larmes de ma mère, ce nouveau roman est une preuve de la singularité et de la clarté de sa voix.
Les Larmes de ma mère (2003)
Pourquoi cette mère, avec le cadet de ses fils, marque-t-elle autant de différences ? Et pourquoi des larmes le jour de l’accouchement ? Ce troisième fils, elle le vante et elle le persécute, elle le distingue et elle le tourmente. Devenu adulte, le dernier fils reconstitue son enfance grâce aux objets qu’il voit ou découvre dans l’appartement parental. Et si les objets se mettaient à parler ? Et si les objets détenaient la clé de l’énigme ? Grâce à une écriture précise, tendue, ce livre où se succèdent des épisodes cocasses et dramatiques, révèle l’intime en évitant l’écueil du sentimentalisme. Les mots sont à leur place sans jamais forcer et le lecteur voit son imagination croître au fil de ces récits d’enfance qui ne manqueront pas de résonner dans sa propre histoire.
Les Légataires (2001)
Le Tapis de course: extrait
22 août
J’ai hésité à lui envoyer un coup de poing. Mon bras s’est raidi, dur comme une barre à mine. Le garçon en face de moi avait un visage blanc et des cheveux noirs qui partaient par mèches dans tous les sens. Jamais personne ne m’a traité de pauvre type. J’ai imaginé mon poing comme un éperon aller s’enfoncer dans la chair de cette tête indolente et parfumée tout en sachant que je ne frapperais pas. L’insulter, le menacer, oui, cela j’aurais pu le faire, cela je sais, je trouve sans peine des sobriquets pour offenser mes semblables, pour réduire une personne à un surnom qui lui collera aux tempes et aux fesses.
Face au jeune homme, je suis demeuré bouche en berne.
Ce qui m’a démuni, c’est que dans l’insulte il n’y avait aucune malveillance, aucune agressivité. Le jeune homme m’a traité de pauvre type avec une voix lisse, neutre, une voix que nulle hargne n’agite. Ce que le jeune homme disait s’apparentait à un constat, dit sur le même ton que s’il avait voulu par exemple informer un client que le magasin fermait à vingt heures ou qu’une pièce était tombée de mon portemonnaie. La phrase avait la clarté d’une certification, quelque chose que l’on accepte comme on accepte qu’une rose ait des épines ou que l’herbe ne soit pas bleue. Ce pauvre type avait la brutalité d’une évidence.
Moi, si je vais au supermarché, ce n’est pas pour faire de la figuration, c’est pour remplir le garde-manger, de la réserve pour deux ou trois semaines, du lourd plein le charriot. A la caisse du magasin, j’avais deux clients devant et deux derrière. Le caddy débordait de marchandises. Je n’ai pas prêté attention à ce que le jeune homme disait en remontant la file, à peine si je l’ai remarqué. Il s’est glissé jusqu’à ma hauteur, il a montré le litre de jus d’orange qu’il tenait et il a dit : Vous permettez ? Il avait déjà gagné deux places, voulait en gagner deux autres. Je l’ai observé avec attention, et j’ai bouché l’espace. De tout mon corps. J’aurais pu ne pas le faire. Combien de fois j’ai laissé ma place à une personne âgée ou à une jeune maman qui n’avait au fond de son panier que deux ou trois babioles ? Cette fois-ci, j’ai fermé le passage, par instinct, et c’est à ce moment précis que le pauvre type a résonné. S’il y avait eu dans la voix du jeune homme, non pas de la haine, mais ne serait-ce que la moindre colère, un filament de rage ou un goût de vengeance, personne ne lui aurait accordé la moindre attention. Mais là, avec ce ton paisible, avec cette aisance aimable, le jeune homme se situait dans un autre espace, une sphère qui désarme et jette à terre. La caissière, les clients, tous ceux qui comme moi avaient entendu, donnaient raison au jeune homme. Inutile de vouloir répondre ou argumenter, inutile de songer à une parade. Le jeune homme avait prononcé un verdict sans appel : j’étais un pauvre type.
Quand mon tour est arrivé, j’ai déposé mes achats sur le tapis, j’ai rempli comme je le pouvais les trois sacs à provisions et j’ai payé. J’ai réussi à donner le change, c’est-à-dire à ne pas laisser transparaître mes sentiments. J’ai marché jusqu’au parking en poussant mon caddy comme un homme libre qui se fout de la terre entière. Mais dès que j’ai fait démarrer la voiture en regardant, qui se balance à chaque virage au bout d’une chaînette métallique, la photographie de toute la famille en train de se livrer à un concours de grimaces, j’ai compris qu’il était trop tard et que j’aurais dû lui bouffer la langue.