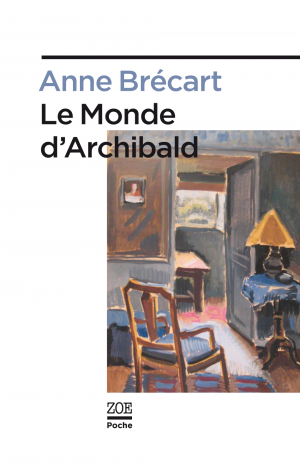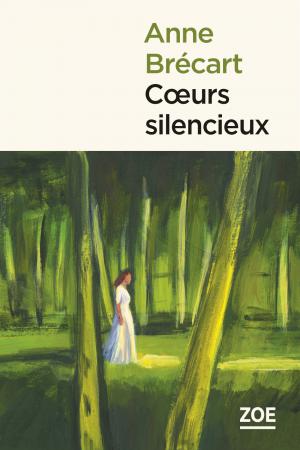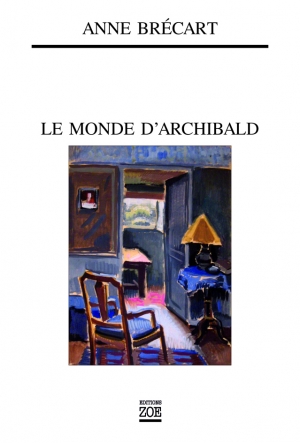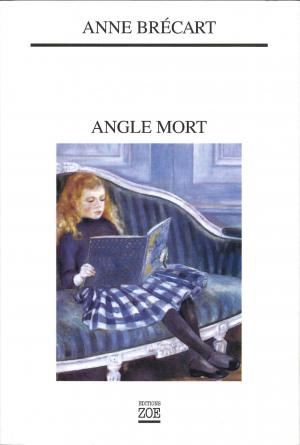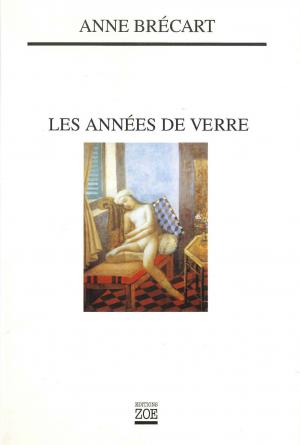parution juin 2011
ISBN 978-2-88182-702-0
nb de pages 208
format du livre 105 x 165 mm
prix 12.00 CHF
Le Monde d'Archibald
résumé
Peut-on vivre sans la protection d’une maison familiale, qu’elle soit réelle ou fantasmée ?
Dans une vieille demeure de famille où tous se réunissent pour célébrer la ronde des étés éternels, la narratrice tombe sous le charme de son oncle Archibald, patriarche incontesté quoique fragile. Chaque année elle revient dans la maison qui garde les secrets des défunts et des vivants, mais le passé conserve aussi les turbulences : il y a sur les lieux des présences impalpables qui s’avèrent inquiétantes. La mort du cousin préféré, le mutisme d’Idriss le Kosovar, l’initiation sexuelle de l’adolescente, annoncent la fin d’un monde suspendu.
Un roman à l’écriture limpide sur un lieu préservé de l’enfance, à la fois source de menaces et objet de désir.
« Ici les réminiscences poussent comme des plantes tropicales ; je les sens physiquement s’agripper aux murs et grimper au plafond. »
Bien qu'issue d'une famille francophone, Anne Brécart a suivi dans son enfance à Zurich l'enseignement d'écoles de langue allemande. Elle a ensuite fait des études de Germanistik en Suisse romande, où elle réside aujourd'hui. Traductrice littéraire de l'allemand (notamment de Gerhard Meier), elle anime des ateliers d'écriture et enseigne à Genève l’allemand et la philosophie. Tous ses romans ont été publiés chez Zoé.
La Patience du serpent (2021, domaine français)
Christelle et Greg ont choisi la vie nomade. Ils ont la trentaine et sillonnent le monde en minibus avec leurs deux petits garçons. Amateurs de surf, ils s’installent là où se trouvent les meilleurs spots, vivent de petits boulots et d’amitiés éphémères. Le vent les mène jusqu’à San Tiburcio, sur la côte mexicaine, Greg s’y sent vivant lorsqu’il danse sur la crête des vagues. Mais il faut s’habituer au soleil implacable, au grondement de l’océan, aux pluies diluviennes des tropiques. Un jour, Ana Maria, une jeune femme du village, fait irruption dans leur existence. Elle entraîne Christelle dans une relation vertigineuse qui va bouleverser la famille.
Dans une langue sensuelle et luxuriante, Anne Brécart décrit le quotidien de ces voyageurs à la recherche d’une autre vie.
Coeurs silencieux (2017, domaine français)
Quarante ans après un premier amour clandestin, Hanna retourne dans la région de son adolescence, y retrouve le génie du lieu mais aussi ce même trouble auprès de l’homme qu’elle avait aimé très jeune fille. La présence du lac et de la forêt, l’humidité qui envahit tout, l’odeur de la terre, la force du vent traversent le roman avec une puissance qui s’apparente à celle du désir. Les souvenirs d’enfance d’Hanna, de ses premières années passées dans la grande maison, remontent avec naturel. Mais dans ce lieu encore imprégné du passé, les préjugés à l’égard des sentiments qu'elle éprouve pour Jacob rejaillissent avec la même dureté que jadis.
Cœurs silencieux raconte la renaissance d’une femme, une reconquête de l’amour et du désir.
La Femme provisoire (2015, domaine français)
A Berlin, il y a 30 ans, dans le silence et le désarroi, une jeune femme qui vient de subir un avortement avec une nonchalance qui s’avèrera trompeuse, marche de longues heures solitaires dans la ville. Quelque chose se passe. Elle rencontre Javier, jeune homme étranger comme elle, dont elle apprivoise progressivement l’enfant de quelques mois. D’une petite chose scrutatrice et calme, il devient un enfant aimé et confiant.
Entre Javier, la femme et le petit, un étrange bonheur s’installe. Le génie des lieux n’y est pas pour rien. Dans un immense appartement décati mais aux hauteurs aristocratiques, au cœur de l’hiver magnifique, de grandes journées vides sont en fait un véritable temps enchanté qui durera presqu’une année. L’enfant devenu adulte retrouve sa mère provisoire, le passé remonte, c’est le temps du récit.
La Lenteur de l'aube (2012, domaine français)
Dans quel monde vit Hanna ? Elle arrive des États-Unis pour la « ville du bord du lac » début juillet, à l’appel de sa mère qui n’est soudain plus très pressée de la voir. Au gré de ses marches dans la ville brûlante, elle retrouve plusieurs figures majeures de sa vie. Alma, l’amie perdue, Karim, l’amant d’un été, Marika, l’artiste aimée. Pourquoi fait-elle ces rencontres ? Et les retrouve-t-elle vraiment ? Hanna mène à son insu une enquête sur elle-même. Sa mère, qui va mourir, et la tendresse d’Hervé, qui saura lui parler, vont finir de tisser la toile du récit : celui de l’identification d’une femme, lente à venir comme l’aube d’une vie nouvelle.
Véritable construction musicale au charme envoûtant, La Lenteur de l’aube est aussi une réflexion sur le silence et l’absence qui accompagnent tout amour.
Le Monde d'Archibald (2009, domaine français)
Peut-on vivre sans la protection d’une maison familiale, qu’elle soit réelle ou fantasmée ?
Dans une vieille demeure de famille où tous se réunissent pour célébrer la ronde des étés éternels, la narratrice tombe sous le charme de son oncle Archibald, patriarche incontesté quoique fragile. Chaque année elle revient dans la maison qui garde les secrets des défunts et des vivants, mais le passé conserve aussi les turbulences : il y a sur les lieux des présences impalpables qui s’avèrent inquiétantes. La mort du cousin préféré, le mutisme d’Idriss le Kosovar, l’initiation sexuelle de l’adolescente, annoncent la fin d’un monde suspendu.
Un roman à l’écriture limpide sur un lieu préservé de l’enfance, à la fois source de menaces et objet de désir.
« Ici les réminiscences poussent comme des plantes tropicales ; je les sens physiquement s’agripper aux murs et grimper au plafond. »
Angle mort (2002, domaine français)
Les Années de verre (1997, domaine français)
Fantasque, fascinante et fragile, Nell a régné sur la jeunesse de celle qui parle ici. Elle raconte leur amitié passionnée, ce lien qui les unissait « contre tout bon sens ». De par son écriture nerveuse et précise, ce roman nous fait ressentir toute l’intensité de cet amour qui n’osait dire son nom. Sans avoir l’air d’y toucher, il dépeint aussi un milieu où l’on ne manque de rien mais où, entre la lourde hypocrisie des bons sentiments et le rembourrage des fauteuils, aucune âme ne saurait véritablement vivre.
Le Monde d'Archibald: extrait
Chapitre 1
Toutes choses sont tuées deux fois : une fois dans la fonction et une fois dans le signe, une fois dans ce à quoi elles servent et une fois dans ce qu’elles continuent à désirer à travers nous.
Julien Gracq : Le Rivage des Syrtes
Quand, enfant, je viens rejoindre la maison du lac pendant les vacances d’été pour faire connaissance avec la famille de mère, je suis déroutée. Maman appelle cela « garder le contact ». Pour moi il s’agit d’une expédition dans un pays exotique.
La première fois que ma mère va rendre visite à Oncle Archibald, « pour me présenter » comme elle dit, elle s’installe avec mon oncle et ma tante dans le salon puis, après quelques mots échangés, elle me permet d’aller jouer. Ce qui veut dire que j’ai le droit d’errer dans les couloirs maigrement éclairés de cette grande maison paysanne. Je suis surprise par le silence qui est doux comme un pelage d’animal. Je fais quelques pas. Sur une table, deux épées croisées. Un livre à la reliure en cuir. Plus loin un miroir, un vieux téléphone mural. Le sol est noir et froid. Les vitres fendues par endroits. Les murs sont du même gris clair que le ciel dehors et l’arbre devant les fenêtres du corridor mange la dernière lumière du jour. J’ai l’impression de m’enfoncer dans une substance inconnue. Dans toujours plus de silence, toujours plus d’obscurité. Ici c’est donc chez moi, la maison de ma famille. Je n’en reviens pas. Jamais aucun lieu ne m’a paru aussi peu familier.
Je me perds, monte des escaliers, en descends d’autres, n’ose pas pénétrer dans les chambres.
Finalement je pousse une porte qui semble vivante, contrairement aux autres qui défendent le vide. Ici la lumière est verte à cause de la vigne qui tombe devant les fenêtres. Au-dessus de la grande table recouverte d’une nappe aux carreaux rouges et blancs une lampe à suspension. Tout près du plafond brillent des bassines, des casseroles en cuivre et en laiton comme un rappel de la lumière du jour.
Madame Liliane s’occupe du repas. Elle est petite et ronde et paraît grosse d’un enfant avec son ventre rebondi serré dans un tablier. Au moment où j’entre à la cuisine, elle lève la tête, me toise d’un rapide coup d’œil, dit : « Ah te voilà ! » comme si elle n’attendait que moi. Elle me désigne une chaise sur laquelle j’ai le droit de m’asseoir. Il ne faut plus que j’en bouge car je risque de me faire ébouillanter, de me brûler, de me couper ou de renverser quelque chose.
Une fois assise, je peux lui raconter le voyage qui a été long, la ville où j’habite. Elle me parle du chien Barry qui tire la charrette. Ses petits-enfants « portent » le lait tous les soirs à la laiterie. Il y a les vaches, les poules que l’on vient de tuer. Elle me donne des haricots à équeuter pour que je me rende utile.
Ici règne une chaleur utérine. C’est aussi la pièce qui m’apparaît la plus claire de la maison. Mais c’est avant tout à cause du mouvement, des odeurs de nourriture qui s’y répandent, car la clarté qui filtre à travers la vigne devant la fenêtre est celle d’un sous-bois.
J’allais revenir chaque fois que mes parents partaient en voyage pour des pays dont le climat m’aurait été néfaste. Il était clair que mes séjours à la maison du lac étaient pour mon bien.
Ce tout premier été que je passe seule à la maison du lac, Archibald et Olympe mettent beaucoup d’énergie à se débarrasser de moi. Il faut m’occuper, toute vacance est dangereuse, le vide doit être comblé, disent-ils. Je ne peux m’empêcher de penser qu’ils cherchent à écarter l’intruse. Ils m’envoient faire des promenades dans les forêts au-delà du village, là où aujourd’hui passe une autoroute. Madame Liliane est priée d’accompagner l’enfant à travers la campagne ; quant à l’heure de retour, rien n’a été fixé, elles marcheront aussi loin qu’elles pourront et reviendront avant la tombée de la nuit.
Au creux des combes, les villages réunissent plusieurs grandes maisons paysannes semblables à celle d’où nous venons ; les potagers sont des damiers plantés de salades, de laitues, de ciboulette. Sur la poutre principale, la date de construction, le nom du maître d’ouvrage. Et sur les maisons plus riches des sentences : Cette maison ne m’appartient pas ; elle ne sera pas à celui qui viendra après moi ; à qui est-elle ? Dans la forêt, les tas de bois parfaitement rangés, marqués du nom du propriétaire. Il suffit de subtiliser une seule bûche pour que cela se voie, me fait remarquer Madame Liliane. Aucune faute ne doit passer inaperçue, aucun mensonge rester impuni, telle est la loi qui habite ce pays protestant.
Une imprécation sur le paysage depuis longtemps. Personne ne peut se soustraire à l’œil scrutateur de Dieu qui nous poursuit et nous force à nous interroger sur ce mal en nous.
Plus tard je comprendrai qu’Archibald ne croit pas en Dieu. Ce qui reste de la foi des ancêtres est la crainte de mal faire, de se tromper, de commettre ce qu’il appelle « une gaffe ». C’est pour cela, sans doute, qu’il a préféré ne rien changer aux meubles, ni à la décoration, qu’il s’est installé dans l’ancienne demeure familiale comme s’il vivait chez autrui, n’utilisant pour lui que l’armoire de la salle de bains, ayant poussé un peu les piles des anciens draps pour pouvoir poser ses linges de bain. Il n’avait même pas jeté les provisions de guerre accumulées dans la chambre derrière la cuisine, de peur que Ferdinand ou Jacques, les deux vieux garçons – comme on disait pudiquement dans la région – viennent lui reprocher d’avoir liquidé leurs réserves.
Parfois, l’après-midi quand la maisonnée fait la sieste, je rejoins Madame Liliane penchée au-dessus d’un objet terne qui n’a guère été utilisé. Une théière ventrue en forme de citrouille qu’elle frotte avec application avant de faire briller les candélabres, les soupières, les louches et autres ustensiles qu’elle range ensuite soigneusement dans la grande armoire où l’argenterie dormira jusqu’à l’été prochain quand à nouveau elle sera sortie, nettoyée et frottée avant d’aller briller inutilement au fond de l’armoire. Ce sont des objets de culte. Des objets sacrés que l’on ne peut toucher car, derrière les vitres de l’ancienne vitrine, ils sont là pour être regardé et adorés comme preuve de la grandeur familiale passée.
C’est peut-être déjà pendant ce premier été que me vient l’idée qu’ils se vengeront, ces objets qui, tels des tyrans domestiques, exigent de Madame Liliane qu’elle les nettoie une fois par an. L’héritage suspendu au-dessus de moi comme une menace.
Oncle Archibald avait eu une vie mouvementée, comme dit mon père d’un ton moqueur en secouant son manteau encore plein de poussière de ses lointains voyages. Archibald avait commencé des études de géologie, puis il avait entrepris des études de droit avant d’entrer à l’armée où il avait presque fait la guerre, et mon père insiste sur le « presque », ce qui lui vaut un regard courroucé de ma mère. A passé trente ans, et père insiste sur le « passé », Archibald avait repris de son cousin, de quinze ans son aîné, le négoce de vin. Vingt ans plus tard, la maison « Urnacht et Co. » n’existait plus. Faillite due à une mauvaise gestion, disait mon père. Marché difficile et destin, disait mère.
Après ce premier été où ma mère m’avait laissé à la bonne garde de son frère, nous avons pris le train encore d’innombrables fois. Archibald vient nous chercher à la gare. Oncle Archibald a vingt ans de plus que ma mère ; il est pour moi comme un grand-père.
Avant même de quitter le wagon, je le distingue à travers la fenêtre parmi la foule. Il est petit et mince, il se tient droit comme un i ; même habillé « sport », comme il dit, il a plus de classe que n’importe lequel des voyageurs autour de nous avec sa canne au pommeau d’agate et son Panama. Il promène son regard bleu sur la foule d’un air distant et je sens que l’on se retourne sur nous au moment où il m’embrasse cérémonieusement en disant d’un ton raide : « Bonjour, ma chérie ».
Nous quittons le parking dans la voiture d’Archibald. Il conduit à sa manière inimitable en appuyant alternativement sur la pédale des gaz et sur celle des freins, dans un mouvement vif et rythmé, de sorte que la voiture avance par cahots.
Je me demande, en m’accrochant à la poignée de la portière, si Archibald fait ça pour retrouver la sensation créée par les chemins de campagne pleins de nids de poules et d’irrégularités sur lesquels il a appris à conduire juste avant la guerre.
Secoués dans la Peugeot, nous quittons le centre ville de Lausanne en empruntant des ruelles, puis des rues bordées de villas qui semblent plantées dans des champs où, le lendemain, viendront brouter des vaches. Ici et là, l’herbe a été fauchée et sèche en tas ébouriffés au bord de la route. Une ville hantée par la nostalgie d’un monde paysan. Aujourd’hui encore quand je viens à Lausanne en juin, je retrouve le parfum du foin qui sèche au pied de petits immeubles entretenus par des concierges inconsolables d’avoir quitté la vie rurale.
Nous traversons des forêts, passons devant des chapelles perdues au milieu de clairières, apercevons des biches qui fuient à travers un pré.
Sur la route d’Archibald, il y a des châteaux qui ressemblent à de grosses fermes auxquelles on aurait ajouté une tour ou deux, des tilleuls deux fois centenaires plantés le long de la route que Napoléon aurait empruntée pour se rendre à Berne. Nous croisons beaucoup de vaches et de chevaux qui lèvent la tête pour nous regarder passer d’un air méditatif. Archibald évite les banlieues, les « zones artisanales » avec leurs grandes bâtisses en tôle ondulée grise ou vert épinard à la crème, il contourne les quartiers d’immeubles et cherche le pays où tout est encore « comme avant ».
J’ai deux mois pour m’adapter aux mœurs de la maison du lac. Dans le salon rose, je déploie de grands et vaillants efforts pour m’intégrer. J’ai plus de peine que ces inconnus, cousins et cousines qui passent l’été chez leur grand père et qui, paraît-il, sont ma famille. Je ne suis pas légitime. Ne serait-ce qu’à cause de la langue. Je parle français avec un accent suspect au point qu’un ami d’Archibald, cherchant sans doute à être aimable, me demande si je suis polonaise. Archibald le renseigne sèchement, il s’agit de sa nièce, la fille de sa sœur qui vit à Zurich.
Mon intégration sur cette terre étrangère est difficile. Je transgresse des lois non écrites. Il y a l’incident du beurre que j’entame par le mauvais bout, celui de la cuillère à confiture que je tourne par mégarde dans ma tasse de thé avant de la replonger dans le pot. Et tous ces rituels étranges que je suis avec intérêt et, parfois, bonheur.
Ainsi oncle Archibald et tante Olympe tiennent à fermer les volets de la maison. La maison aussi doit dormir et clore ses paupières. Olympe va d’une chambre à l’autre et ramène, avec un geste ample et protecteur, les panneaux de bois vers elle ; debout derrière elle j’attends qu’elle me fasse signe pour ajuster le crochet en fer. Ainsi rien ne pourra nous arriver, le monde extérieur ne pénétrera plus dans les pièces éclairées par une douce lumière qui filtre derrière les abats jours roses. Une fois que la maison a retrouvé son état de tombeau, nous restons sous le regard peint des ancêtres. Je les suspecte de savoir à l’avance ce qu’il va advenir de nous. Leur présence aux murs a quelque chose d’impératif. Je me redresse. Les regards peints, les rideaux en soie rose, la délicatesse des dossiers des chaises imposent leur loi.
J’ai beaucoup de progrès à faire, me signifie la mine sévère d’Archibald ; alors je cherche à bien me tenir même si les mœurs du pays d’enfance de ma mère me paraissent étranges et que l’attention donnée aux détails me semble exagérée.
Pour moi, la maison a commencé à exister dans les mots. Les mots de la langue que nous parlons entre nous, mère et moi, pas la langue que je parle à l’extérieur. Car dès que nous franchissons la porte de l’appartement zurichois nous sommes en terre étrangère. Comme si nous traversions une douane sans papiers, et sans douaniers. Pourtant nous changeons de pays chaque fois que nous quittons notre logement.
Au-dehors, c’est le pays froid du charcutier qui me donne une rondelle de « Wurst », le pays du boulanger chez lequel j’achète un « Wegge » et du supermarché. Le pays du Banania, boisson cacaotée, et des animaux gonflables que l’on trouve sur le paquet. C’est le pays des grands parcs dont les arbres sont gris et du lac dont l’eau verdâtre est si froide. Dans ce pays, devant la porte de notre appartement, il y a souvent de la neige, parfois les enfants des voisins dans la rue qui m’interpellent dans une langue gutturale que je ne comprends pas. Les maisons, les arbres, les rues et la petite place ont eu, pendant longtemps, des noms pour moi incompréhensibles.
Il faut s’armer de patience et d’un dictionnaire mental pour affronter la cage d’escalier où je risque de croiser la concierge que je dois saluer correctement. Tout manquement sera sanctionné. C’est l’autre pays, étranger et hostile, impossible à conquérir et difficile à amadouer.
L’appartement que nous habitons est une île au milieu de la terre froide et cette île est contenue dans la langue maternelle et prolongée par elle. Les objets sont accompagnés d’un nom, ils sont familiers parce qu’ils peuvent être dits, alors que dans la rue cela est impossible.
Je m’installe dans le fauteuil crapaud du salon pour entendre raconter le pays chaud : à la maison du lac il n’y a pas de concierge, ni de propriétaire qui comptent les abricots lorsqu’ils sont mûrs pour s’assurer que les locataires - c’est-à-dire nous - n’en ont pas volés. Les enfants qui jouent dans la rue parlent la même langue que nous. D’ailleurs le village entier parle notre langue et autour du village s’étend un pays où toutes les voix ont les mêmes intonations que celles, familières, de maman. Penser que le charcutier, le boulanger puissent parler ma langue maternelle que je crois être une langue secrète, réservée à quelques initiés, me paraît impossible.
Mais dès notre arrivée à la gare, déjà au pied des voies, je constate qu’en effet, ici, tout le monde parle la langue de mère et, au-dessus de ma tête, les voix de tous les adultes, connus et inconnus, se réunissent pour la première fois de ma vie en un dais unique et familier.
Chapitre 2
(…)le sage n’est jamais pauvre.
Sénèque
Après la faillite de la maison de commerce « Urnacht et Co. /Vins », Archibald était revenu au bord du lac, le domaine étant tout ce qui lui restait. Il avait vu l’état dans lequel étaient la ferme et la maison, il avait été horrifié parce que la maison ne ressemblait plus exactement à celle qu’il avait connue enfant.
Ce jour où Madame Liliane l’avait vu revenir, laissant la Peugeot 404 au bas des petits escaliers, il avait fait un tour de jardin, s’était arrêté brièvement sous le marronnier rose pour prendre sa décision. Puis il avait appelé Madame Liliane qui, en l’absence des propriétaires, était chargée de s’occuper de la vieille maison et de tout ce qu’il y avait à l’intérieur, vieux meubles, argenterie et livres poussiéreux. Il lui avait déclaré, un peu pompeusement, qu’il entendait consacrer le reste de sa vie à faire de ce lieu un endroit qui ressemble à celui qu’il avait connu enfant. Identique en tous points. Et lorsqu’il disait identique, il n’imaginait pas seulement les pots de lauriers roses, les vieux bancs verts retrouvant leur place d’antan mais également tout le reste : les grandes tablées, les fêtes pour les amis et la famille, les retrouvailles. Il tenait à ressusciter les étés de son enfance passés ici entre sa grand-mère et son grand-père.
En l’écoutant, Mme Liliane revoyait Mme Urnacht mère, son maigre chignon blanc collé à la nuque comme un nid d’hirondelle accroché à une poutre, ses longues jupes noires et ses chaussures solides qui lui permettaient d’affronter la boue des petits chemins entre les buis du jardin potager. Madame Urnacht mère avait des convictions religieuses, était entrée dans une secte protestante - mais ne me demandez pas laquelle, dit Madame Liliane que je ne quitte pas des yeux tandis qu’elle va et vient dans la cuisine - secte qui lui interdisait de faire appel au médecin et de se soigner. La pauvre était morte à soixante ans d’une simple grippe, si Madame Liliane se souvient bien.
Ce fameux jour où Archibald avait pris la décision de remettre tout en l’état, il avait légèrement serré les lèvres comme s’il voulait s’empêcher de dire encore quelque chose et Madame Liliane y avait reconnu la marque des gens du pays. Ne pas trop en dire, agir plutôt que parler, rester discret dans l’adversité comme dans le bonheur.
« Car voyez-vous, ma petite, me dit Madame Liliane, votre oncle est un homme qui, à sa manière, est un homme à l’aise dans le concret et il n’aime pas les grands discours qui viendraient prendre la place d’une action. »
Archibald et Madame Liliane m’apparurent au début comme un couple. Même s’ils n’étaient pas le couple officiel. Il y avait entre la sophistication d’Archibald et la rusticité de Madame Liliane une communauté. Comme si, à force de vivre ensemble, ils avaient déteints l’un sur l’autre. Madame Liliane aimait écrire des vers. Des villages alentours on venait la voir pour lui demander un poème à l’occasion d’un mariage ou d’un enterrement. Archibald de son côté prenait goût aux choses de la terre. Il gérait le domaine, rencontrait le fermier, discutait avec les bûcherons, s’inquiétait des noyers à replanter et des haies à tailler. Lui qui n’avait jamais touché une bêche de sa vie plantait des lavandes pour que leur parfum entre dans la petite bibliothèque, il taillait les rosiers grimpants pour que les fleurs laissent tomber leurs pétales sur le seuil, formant un tapis épais que mes cousins et moi foulions pieds nus.
A la suite de ce premier jour où il avait repris les rênes du domaine après un rapide tour d’inspection, Archibald s’était glissé dans son nouveau rôle avec la sensation que cette fois-ci il avait trouvé ce qui lui avait fait défaut pendant toute sa vie : un emploi à sa mesure. Voilà ce que me dit Madame Liliane de l’air satisfait de l’épouse comblée.
A la maison du lac, je dors dans un lit trop grand pour moi, il y a une commode, une table où je peux, si l’envie m’en prend, écrire mon journal ou une carte postale que j’adresse à Monsieur et Madame mes Parents, résidant à l’Hotel Carrera, Santiago de Chile. Il y a un fauteuil profond à côté d’une étagère remplie de livres dont la tranche est étrangement dentelée. Sur la première page, une écriture large et mélancolique indique le nom de l’ancien propriétaire, la date et l’occasion à laquelle le livre a été offert.
Dans cette pièce solennelle et théâtrale avec son papier peint orné de torsades bleues, je prends soin de pousser une commode devant la porte avant d’aller me coucher car les histoires qu’Archibald aime raconter, la nuit tombée, assis sous le grand marronnier, me terrorisent. Il y a l’histoire d’une femme mystérieuse chaussée d’escarpins qui, de temps à autre, monte les escaliers de la maison. Archibald prétend que l’on entend distinctement ses talons claquer sur la pierre, raison pour laquelle il a fait poser une moquette. Mais même maintenant, et malgré la protection, les escarpins de la dame résonnent encore au coeur de la nuit.
Archibald aime également raconter cette autre histoire : quelques jours avant de se marier un de ses jeunes cousins était venu rendre visite à son Oncle Théobald pour lui présenter sa fiancée. On l’avait logé dans la dernière chambre encore libre sous les combles dont les fenêtres ouvraient directement sur la frondaison du grand marronnier. Au milieu de la nuit, le pauvre malheureux, pris d’un accès de somnambulisme, se leva, monta sur le rebord de la fenêtre ouverte et se précipita dans la cour.
« Et qui sait s’il ne revient pas de temps à autre pour chercher sa promise. »
Archibald raconte cette histoire avec un plaisir visible avant de nous congédier d’un léger geste de la main en nous souhaitant bonne nuit.
Avant d’aller me coucher, je surprends dans le miroir le visage d’un jeune garçon aux cheveux très lisses. Je me scrute avec inquiétude et ne découvre aucun trait de ressemblance avec les autres membres de la famille.
Sur les quelques photos qu’il avait prises de moi et que j’avais retrouvées après sa mort, Archibald avait noté mon prénom et mon nom de famille qui était celui de mon père. Porter un autre nom que celui d’Urnacht me mettait un peu à l’écart sans pourtant m’exclure. Je faisais partie du clan, ici je pouvais dire « nous » car j’avais droit aux secrets de la maison et cette appartenance me donnait accès à ce bon goût inné que nous étions censés partager. Pour nous l’histoire de la famille et les gènes étaient un lieu.
Quand j’écris que j’avais droit aux secrets, ce n’est pas tout à fait juste. Car précisément c’étaient des non-dits. Archibald prétendait que nous étions une famille « sans histoire », et dans sa bouche cette expression avait bien le double sens qu’elle peut prendre, il n’y avait rien à raconter sur nous et rien ne nous était arrivé. Nous avions miraculeusement vécu à l’abri de tout problème, épargnés par les grands drames de l’Histoire. Cette immunité nous imposait une certaine retenue, estimait Archibald.
Rien n’aurait pu me mettre au ban de ce cercle familial, même si je l’avais désiré. Il y avait pourtant des personnes plus légitimes que d’autres et celles-là, oncle Archibald les désignait lui-même lors d’un rituel qui me mettait mal à l’aise.
Cela avait lieu, en général, lors d’une journée de pluie, après le déjeuner, quand, exceptionnellement, nous prenions le café au salon. Tantes et cousines s’affairaient à la cuisine d’où l’on entendait le bruit de vaisselle. Le reste de la famille s’installait dans les fauteuils. Quelqu’un immanquablement faisait remarquer que la couleur rose des rideaux s’accordait merveilleusement avec la lumière grise dehors. Les rideaux encadraient de leur soie bouillonnante le petit lac criblé de gouttes comme si c’était un charmant tableau. Alors oncle Archibald passait en revue les traits des visages des uns et des autres en les comparant avec les portraits suspendus aux murs.
- Elle a tout à fait le nez de Charles. Et toi, mon chéri, le regard de Berthe. Mêmes yeux, mêmes sourcils.
A entendre Archibald, on aurait dit que, dans le petit salon rose, on se passait les traits des visages d’une génération à l’autre, de la même manière que l’on se léguait de l’argenterie ou des meubles de famille.
J’étais la seule pour laquelle oncle Archibald avait renoncé à chercher un modèle peint. Longtemps j’ai eu peur que les joies de ce jeu des ressemblances me restent interdites. J’avais beaucoup pris du côté de mon père, disait quelqu’un en soupirant.
Un jour, très longtemps après ces premiers étés, j’avais pourtant quand même eu ma revanche. Les lauriers en pots ponctuaient la cour grise de leurs boules roses. Archibald et moi contemplions en silence ce décor du passé, lui avec émotion, moi avec l’obéissance aveugle d’une jeune nièce. Brusquement il me prit la main et la posa sur la table
Il se leva et revint un instant plus tard avec un avant-bras coulé dans du plâtre, un moulage de la main gauche de cette tante dont j’entendais parler pour la première fois. Je regardai cet objet ; la main était belle, posée avec légèreté sur le socle en plâtre, le petit doigt levé, les autres doigts touchant le support de la pointe seulement, il n’y avait que le pouce qui adhérait, bien à plat, au socle de plâtre gris. Ma main, automatiquement, adopta la pose. Le jour suivant, Archibald m’offrit une bague, un anneau en argent surmonté d’une perle.
Cette bague, je l’ai gardée et retrouvée, lors de mon dernier déménagement, dans sa petite boîte recouverte de cuir rouge défraîchi et je me suis souvenue de son émotion, ce jour-là, parce que j’avais les mêmes mains qu’une morte.
Au fil des étés, je m’étais habituée à la présence des portraits et à la pénombre dans laquelle ils flottaient, et j’avais même établi une complicité avec eux.
Après la séance du café, je revenais seule dans le petit salon avec la ferme intention de soutenir leur regard peint. Etaient-ils jaloux de moi, de ma liberté de mouvement ? Désiraient-ils me suivre dans la forêt ou sur le lac? Enviaient-ils ma jeunesse ? J’allais d’un portrait à l’autre, j’observais leur visage austère et leur gestuelle précieuse.
Quelque chose en moi allait grandir sous leurs yeux, quelque chose de particulier allait se nourrir des regards lointains de ces femmes qui posaient, leurs mains blanches et délicates se détachant sur le velours vert de leur robe. Je n’échapperais pas à la fascination de leur décolleté et de leur collier de perles blanches, au regard sévère du fondateur de la maison de commerce.
En caressant les tapisseries brodées d’un point compliqué et oublié, je me demandais ce que les ancêtres nous avaient laissés en héritage à part la faillite de la maison de commerce et cette ancienne ferme.
Il m’arrivait de m’adresser directement à eux :
« Quel avenir m’avez-vous préparé et cela vous arrivait-il de penser à moi ? » Ils semblaient tellement inconscients de ma future existence que je leur en voulais.
La maison du lac était enracinée dans le temps. Un lieu de permanence. La promesse séculière d’une éternité. Là tout avait été patiné par les ans, de sorte que je pensais que son futur serait aussi long que son passé l’avait été. Aujourd’hui encore j’ai peine à croire que ce lieu qui paraissait si stable, quasi éternel, ait disparu sans laisser de trace.