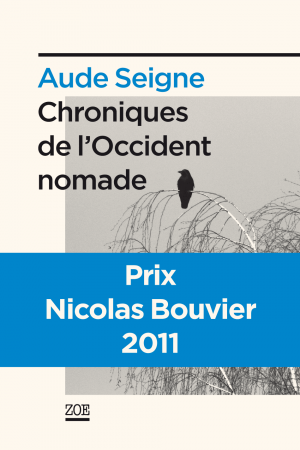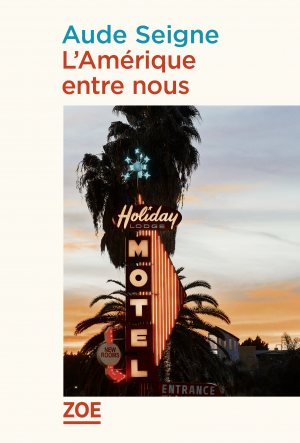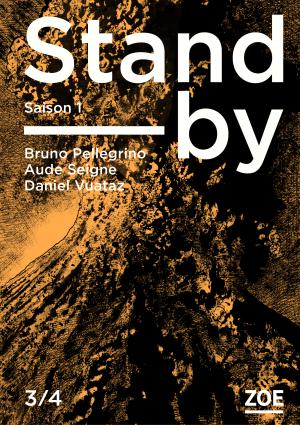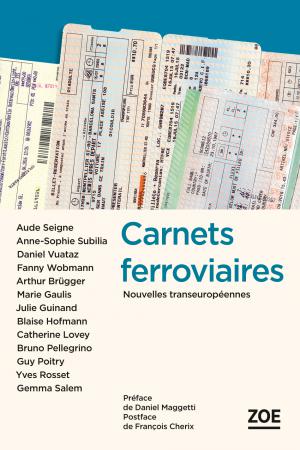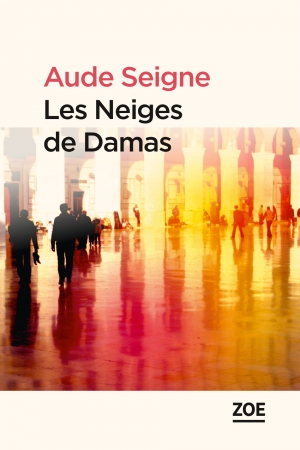parution juin 2011
ISBN 978-2-88182-710-5
nb de pages 144
format du livre 140 x 210 mm
prix 25.00 CHF
Chroniques de l'Occident nomade
résumé
Lectrice du monde et d'elle-même, Aude Seigne, bourlingueuse du 21e siècle, écrit avec une acuité et une souplesse inédites sur le voyage et ses amours lointaines.
Le voyage ? Un exercice de légèreté. Un ravissement aussi : parce que parfois la beauté est terrassante, complète, trop forte, une illumination, une sorte d’orgasme métaphysique tremblant. « Quelque chose craque en moi, une paroi se rompt sans crier gare, la possibilité de l’abîme se dévoile en même temps que celle du bonheur absolu. »
L’amour ? Les premières fois, un flirt qui peut « la laver de tout », ou encore le grand amour.
Chroniques de l’Occident nomade a tout d’un roman d’apprentissage. Aude Seigne tatônne autour du globe comme dans sa narration, elle le sait et le revendique. Le voyage certes, mais pour être plus présente au monde.
Ouvrage disponible en poche : http://editionszoe.ch/livre/chroniques-de-l-occident-nomade-1
À 15 ans, un camp itinérant en Grèce révèle à Aude Seigne ce qui sera sa passion et son objet d’écriture privilégié pendant les dix années qui suivront : le voyage. En parallèle de ses études gymnasiales, elle commence donc à voyager pendant l’été : Grèce, Australie, Canada, La Réunion. Le lycée terminé, elle découvre le temps d’une année sabbatique l’Europe du Nord, de l’Est, et le Burkina Faso. Elle effectue ensuite un bachelor puis un master en lettres – littérature françaises et civilisations mésopotamiennes – pendant lesquels elle continue d’écrire et de voyager autant que possible : Italie, Inde, Turquie, Syrie. Tous ces voyages, ainsi que la rêverie sur le quotidien, font l’objet de carnets de notes, de poèmes et de brefs récits.
C’est à la suite d’un séjour en Syrie qu’Aude Seigne décide de les raconter sous la forme de chroniques poétiques. Parues en 2011 aux éditions Paulette, ces Chroniques de l’Occident nomade seront récompensées par le Prix Nicolas Bouvier au festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo, et sélectionnées pour le Roman des Romands 2011. La même année, le livre est réédité aux éditions Zoé.
En 2015 paraît Les Neiges de Damas, suivi en 2017, d'Une toile large comme le monde. Parallèlement, Aude Seigne travaille, avec Bruno Pellegrino et Daniel Vuataz, à la série littéraire Stand-by, dont les deux saisons sont publiées respectivement en 2018 et 2019.
Aude Seigne, lauréate du prix Nicolas Bouvier 2011 pour "Chroniques de l'Occident nomade"
Le Temps
« Ce petit livre emmène ses lecteurs dans l’intimité d’une jeune voyageuse avec une légèreté qui n’a rien de frivole mais qui nous ramène à notre propre apprentissage du monde, jamais terminé. » Isabelle Rüf
L'Hebdo
« Présentées sous forme de petits textes organisés en chapitres où "tout est vrai, sauf les noms des personnages", ces Chroniques de l’Occident nomade racontent l’état exalté ou triste du voyage. Mais aussi l’amour, l’abîme, le cheminement, le lire et l’écrire, et le lien intrinsèque entre tous ces concepts. » Isabelle Falconnier
Livreshebdo
« Aude Seigne semble avoir incorporé ses lectures et ses admirations, les honorant sans se sentir accablée par l’héritage, pour trouver un ton personnel et contemporain, la voix de la voyageuse occidentale du XXIe siècle, qui allie la fraîcheur de la jeunesse – sans la candeur – à la sagesse de l’expérience et n’idéalise jamais le statut du voyageur. » Véronique Rossignol
Ecriture vagabonde
Les récits d'une jeune voyageuse occidentale. Ni journaliste, ni ethnologue, elle égrène ses impressions au gré des continents traversés et nous entraîne dans un "état nomade" proche de Nicolas Bouvier.
Le Jour des silures (2023)
Dans un futur proche, la montée des eaux a eu lieu. Jeune présidente d’une ville pratiquement engloutie, Colombe croit à la décrue. Alors que la population se serre dans les derniers étages des immeubles et mène une vie nouvelle, communautaire, aquatique, Boris et Salömon, un duo de scaphandriers, plongent dans les rues à la recherche de vestiges et d’archives. Une mission qui n’est pas sans danger – surtout quand disparaissent les enfants et que rôdent les silures.
Terre-des-Fins (2022)
Terre-des-Fins est une ville minière sur le déclin, un terminus du monde uniquement accessible par le rail. Liv, une jeune femme graffeuse, délinquante à ses heures, y voit débarquer Sora, une ambitieuse fille de la capitale, qui vient chercher en urgence l'œuvre d’un artiste. Liv se retrouve à servir de guide à la jeune citadine, dont le souhait le plus cher est de rencontrer cet artiste qu’elle vénère tant. Un récit d’émancipation sauvage et intime sous des allures de roman de gare.
Daniel Vuataz, Aude Seigne et Bruno Pellegrino écrivent à six mains depuis la série littéraire Stand-by. Ensemble, ils ont créé une écriture qui conjugue vitesse, observation et amour de la narration.
Les Neiges de Damas (2022)
En 2005, Alice passe l’hiver au Musée national de Damas pour répertorier des tablettes d’argile sumériennes. Entre le présent suspendu et les fragments millénaires, elle vit la fin de son adolescence et perd ses illusions sur l’état plane et serein que serait l’âge adulte. Cette expérience, elle la raconte six ans plus tard, quand la Syrie n’est plus que conflits. Mais plus qu’à la géopolitique, Alice s’intéresse à l’archéologie intime du monde. En cherchant une cohérence aux choses, elle apprend à être heureuse avec des questions plutôt que des réponses.
Postface de Véronique Rossignol
L'Amérique entre nous (2022)
Pendant trois mois, un couple parcourt les États-Unis en voiture. Ciels, villes, animaux, tout les émerveille. Ils en profitent pour vérifier les clichés européens sur l’Amérique. Elle interviewe les stars et tente de distinguer le vrai de la fiction ; lui photographie les geais bleus et les loups. Elle assiste à un mauvais match de baseball, ils traversent des incendies. La narratrice a pourtant un objectif plus important : elle aime deux hommes à la fois mais ne cesse de retarder le moment d’en parler à son compagnon.
Dans ce roman sur l’Amérique et l’amour libre, la narratrice procède à une enquête passionnée. Un va-et-vient vertigineux entre exaltation et blessures, doutes et ténacité, qu’accompagne une play-list accordée à la tonalité de chaque partie.
Stand-by - saison 2 (2019, Stand-by. Le feuilleton littéraire)
Trois adolescents en cavale avec une journaliste quadragénaire lancée dans une quête mystique en Italie. Un médecin napolitain fraîchement diplômé, sur le point de mourir au Groenland, dans une base militaire abandonnée. Une jeune femme qui écume New York pour retrouver son ex-petite amie disparue. Chacun doit se frayer un chemin dans un monde profondément bouleversé par l’éruption d’un supervolcan qui, après avoir paralysé l’espace aérien européen, est en train de faire chuter la température sur toute la planète.
Une Italie post-apocalyptique, une Europe plongée dans l’écologie totalitaire, des États-Unis où le slogan « Make America White Again » est devenu la norme : voici la saison 2 du feuilleton littéraire Stand-by, à lire indépendamment ou à la suite de la première saison.
Langue précise et sensible, atmosphères et personnages au plus proche du monde d’aujourd’hui, Stand-by, écrit à six mains par Bruno Pellegrino, Aude Seigne et Daniel Vuataz, réconcilie littérature et séries télé.
Stand-by - l'intégrale de la saison 1 (2019, Stand-by. Le feuilleton littéraire)
Suite à une éruption sans précédent à Naples, toute l’Europe se retrouve paralysée sous les cendres.
Sur le point de s’envoler de Paris pour New York, la journaliste Alix Franzen est contrainte de revoir ses plans. Nora, Vasko et Virgile, trois adolescents en vacances dans les Balkans, se retrouvent sans adultes et découvrent l’indépendance, grisante et inquiétante. Au Groenland, une équipe de jeunes Européens en mission climatique reste bloquée, loin de tout secours.
Au fil des premières heures qui suivent cette apocalypse volcanique, chacun va devoir s’en remettre à ses ressources personnelles pour affronter la réalité d’un monde nouveau.
Langue précise et sensible, atmosphères et personnages au plus proche du monde d’aujourd’hui : écrit à six mains par Bruno Pellegrino, Aude Seigne et Daniel Vuataz, le feuilleton Stand-by réconcilie littérature et séries télé. Voici la version intégrale de la première saison, récompensée en 2018 par le prix de la relève de la Fondation vaudoise pour la culture.
Stand-by 4/4 (2018, Stand-by. Le feuilleton littéraire)
Une semaine après l’éruption du supervolcan près de Naples, Alix a décidé de gagner l’épicentre du cataclysme : un périple dans une Italie apocalyptique.
Au Groenland, les Green Teens restés au camp de base sont tirés d’affaire, mais il faut retrouver les autres, disparus dans la tempête alors qu’ils étaient partis chercher de l’aide.
À Podgorica, Virgile, Nora et Vasko découvrent in extremis l’horrible secret d’Aden. En fuite après avoir laissé un corps inanimé, ils plongent dans l’excitation et la paranoïa, tandis que leur road trip balkanique se transforme en une course-poursuite infernale.
Le temps accélère, les actions se densifient : pas de happy end artificiel pour ce dernier épisode, mais un feu d’artifice qui clôt en beauté cette première saison de Stand-by.
Dessins de Frédéric Pajak
Stand-by 3/4 (2018, Stand-by. Le feuilleton littéraire)
Au Groenland, la neige engloutit les repères, tandis que les cendres commencent de voiler le ciel français. Sur les paysages monténégrins, les pluies acides laissent des sillons noirs.
Le supervolcan « crache, depuis des jours, des milliers d’années de roches patiemment mitonnées », et les protagonistes de Stand-by sont confrontés à de nouvelles réalités : l’oncle Aden a du sang sur les mains ; la mort frappe les Green Teens ; Alix n’est plus seule sur la route.
Dessins de Frédéric Pajak
Stand-by 2/4 (2018, Stand-by. Le feuilleton littéraire)
Un Groenland progressivement hostile, un Monténégro sous les cendres, une campagne française inquiétante et déserte : le décor de Stand-by est planté, place à l’action !
Alix a quitté Paris et entame une longue marche à travers la France, bravant les risques que peut courir une jeune femme isolée en pleine campagne.
Nora, Vasko et Virgile décident de partir pour Podgorica, où Vasko est attendu pour l’ouverture du testament de son père. Ils seront accueillis par l’oncle Aden, l’étrange frère du défunt.
Quant aux Greens Teens, ils sont condamnés à espérer un avion qui ne vient pas. Mais c’est sans compter un nouvel accident tragique qui va transformer leur attente en enfer.
Dessins de Frédéric Pajak
Stand-by 1/4 (2018, Stand-by. Le feuilleton littéraire)
Lorsqu’un volcan dans la région de Naples entre en éruption, un prodigieux nuage de cendres paralyse progressivement l’Europe, clouant les avions au sol et brouillant les communications. Sur le point de s’envoler pour New York depuis Paris, Alix Franzen doit revoir ses plans. Au Monténégro, Nora, Vasko et Virgile, trois adolescents, se retrouvent sans adultes et découvrent l’indépendance, grisante et inquiétante. Au même moment, les Green Teens – une équipe de jeunes Européens qui accomplissent leur Service climatique obligatoire – reste bloquée au cœur du Groenland, loin de tout secours.
Voici le récit des premières vingt-quatre heures qui suivent l’éruption.
Dessins de Frédéric Pajak
Sous nos trottoirs et nos océans, des millions de mails transitent chaque seconde à travers des câbles qui irriguent le monde. Surfant sur ce flux continu, Pénélope, June, Birgit et Lu Pan mènent leur existence de « millénials » aux quatre coins de la planète. Fascination ou familiarité, dépendance ou dégoût, leur rapport au web oscille, dans leur travail comme dans leur vie amoureuse. En découvrant l’univers de boîtes et de fils qui les relient bien plus concrètement qu’ils n’imaginent, ils élaborent un plan vertigineux pour atteindre leur but commun : mener une existence hors de la Toile.
Ce roman est un génial selfie du monde contemporain, dans lequel virtuel et réel sont toujours plus intriqués.
Vous avez lu le roman et souhaitez en savoir plus sur l'empreinte écologique du Web, l'installation des câbles sous-marins ou le fonctionnement d'un data-center ? Rendez-vous sur https://wordswideweb.tumblr.com, le blog d'Une toile large comme le monde !
Que ce soit de Lausanne à Paris, de Vienne à Genève ou de Glasgow à Londres, chacun des treize auteurs de ce recueil situe son histoire à bord d’un train qui parcourt l’Europe. À l’occasion d’un long trajet en chemin de fer, l’une se souvient de son voyage dix ans plus tôt, elle traque la différence entre son être d’hier et d’aujourd’hui. Un autre se remémore la géniale arnaque dont il a été l’auteur, un troisième retrace l’incroyable hold-up ferroviaire du South West Gang dans l’Angleterre de 1963.
Ces nouvelles donnent une vue d’ensemble inédite sur la manière de concevoir l’Europe comme espace physique et symbolique. Les auteurs étant de générations très diverses, le lecteur appréciera les différentes manières d’appréhender notre monde proche et de s’y situer.
Nouvelles de Aude Seigne, Blaise Hofmann, Anne-Sophie Subilia, Gemma Salem, Bruno Pellegrino, Arthur Brügger, Daniel Vuataz, Marie Gaulis, Fanny Wobmann, Catherine Lovey, Julie Guinand, Guy Poitry, Yves Rosset.
Préface de Daniel Maggetti, postface de François Cherix
Les Neiges de Damas (2015)
Voici un livre sur Damas qui ne parle pas de Damas. C’est un hivernage intime, un trajet de taupe, un enfouissement. Une saison d’hiver passée en 2008 dans le sous terrain du musée national de Damas à dépoussiérer, photographier et répertorier des tablettes sumériennes. Alice raconte cette aventure six ans plus tard quand la Syrie n’est plus celle qu’elle a connue. Alice est une jeune femme qui, quittant l’adolescence, perd l’illusion que l’âge adulte est un état plane et heureux, qui serait le résultat du chemin tortueux de l’adolescence.
Aude Seigne a de l’appétit, et sa faim est plus grande que le doute, pourtant constant chez elle. Sa curiosité est immense, réjouissante et captivante. Sa finesse d’analyse douce et précise. Son ouverture sur le monde lumineuse. Sur Les Neiges de Damas, elle dit : « C’est un nouveau type de voyage. C’est un livre contre l’obligation de conclure. » C’est un livre de la génération de ceux qui regardent le monde depuis l’après mur de Berlin. Une écriture non pas militante mais engagée d’une grande voyageuse au repos, qui cherche à apprendre à être heureuse avec des questions plutôt que des réponses.
Chroniques de l'occident nomade (poche) (2013, Zoé poche)
Bourlingueuse du xxie siècle, Aude Seigne écrit avec acuité et souplesse. Ses chroniques sautent allègrement d’un continent à l’autre, mettent en correspondance des pays et des bouts de souvenirs, des images, des gens, comme autant d’éclats de cet « état nomade » cher à Nicolas Bouvier.
« Je lis L’Idiot à Ouagadougou et l’idiot ne me rend pas heureuse mais me sort du temps où je vis. Dans le silence vertical de la rue ouagalaise aux heures brûlantes, je vois s’élever une datcha, des calèches, des duvets de neige. »
Chroniques de l'Occident nomade: extrait
I
Comment cela a-t-il commencé au juste ? Pourquoi ce mouvement tout à coup, ces ailleurs, ces hommes ? Est-ce que j’écris sur les voyages, est-ce que j’écris sur l’amour ? Difficile à dire. Au début du mouvement, je vois un ferry qui arrive sur la Grèce un matin de juillet.
J’ai quinze ans. Je me couche un soir sur le pont à Brindisi. J’ai quinze ans. Je vois mes compagnons de voyages dérouler un fin matelas de camping sur le ponton crasseux. Il n’y a pas un mètre carré de libre, il faut enjamber ces îles humaines comme on traverserait une rivière au lit peu marqué. J’entends d’ici la réaction petite bourgeoise qui crie en moi. Mais, on ne va pas dormir ici quand même ? Je me réveille plus tôt que je ne le fais jamais par moi-même parce que j’étouffe de chaleur. Il est à peine 7 heures mais le soleil semble déjà se diriger vers nous de tous les horizons à la fois. Un de ces étouffements inouïs, incroyablement violents et un peu agréables. Il faut imaginer ce que doit être la ouate chaude quand elle oppresse et bourdonne, comme un mal de tête qu’on peut soigner à l’ombre une après-midi d’été. Comment tout cela a-t-il commencé ? Peut-être à ce moment précis. Je me redresse, les yeux bouffis. Sans même me lever de ma couchette de fortune, j’ai devant moi la mer scintillante comme un désert bleu. La vision est coupée en deux. Le désert de glace aveugle et défile alors que le ciel est d’un bleu pâle infini. J’ai quinze ans mais je ne me suis jamais réveillée sur un tel panorama et des milliers de générations d’humains ont dû le faire tous les jours avant moi. Quelque chose craque en moi ce jour-là, une paroi se rompt sans crier gare, la possibilité de l’abîme se dévoile en même temps que celle du bonheur absolu. J’ai quinze ans, je pars en Grèce avec vingt autres ados et trois qui ne le sont à peine plus. Je suis en Grèce et fais des choses insensées. À Santorin, nous marchons deux heures sans eau, en plein soleil, au bord d’une route où passent des cars de touristes. Dans un petit restaurant d’Antiparos, nous mangeons une côte de bœuf chacun, deux fois plus large que l’assiette et que nous dévorons à mains nues. Pour le 1er août, nous achetons des sandales de cuir aux bergers et des robes très courtes qui ne masquent rien de nos corps d’adolescentes bronzées. À l’aube, nous marchons vite dans la partie déserte de l’île pour tenter de se coucher avant que le soleil ne se lève. Je m’étale dans le sable sous un buisson. Quand j’ouvre les yeux quelques heures plus tard, le visage rond et tendre du moniteur italien endormi fait face au mien. Je m’en rapproche encore un peu et referme les yeux. Un jour, nous mettons nos habits dans de grosses casseroles noires et traversons à la nage vers une île déserte en les poussant à la surface de l’eau. Nous passons la journée à parcourir ce caillou vierge que des centaines de jeunes arrogants ont dû, comme nous, fouler avec l’exaltation des grands découvreurs. Les pierres sont rouges, blanches, l’herbe drue. À l’opposé de l’île, nous traversons encore sur une île plus petite. Le désir d’aller au bout, tout au bout, d’aller le plus au bout que l’on puisse aller, comme j’irai au Cap Nord quand je serai en Norvège, comme j’irai dans les Pouilles quand je serai en Italie. En Grèce, nous chantons dans la rue, nous mangeons des gyros, nous dormons sur des plages dont il faut s’éloigner rapidement le matin car cela est interdit. Nous buvons des tequilas boum boum dans les bars de Ios et je prends des antibiotiques pour une allergie aux araignées qui nous visitent, monstrueuses, pendant nos nuits champêtres. Dans les rues d’Ios, une jeune femme noire tombe, Vera pleure et un homme que je ne vois pas me brûle en haut de la cuisse avec sa cigarette. Je fume parfois des cigarettes sur les ponts des ferrys, la nuit. Je n’aime pas cela, je ne sais pas vraiment le faire et d’ailleurs je ne le fais même pas. Je tiens mal la cigarette, je n’aspire pas la fumée, je me retiens de tousser et j’ai mal à la gorge. Nous dormons parfois à l’intérieur des ferrys, dans les escaliers des restaurants chics dont la climatisation renforce le mal de gorge. Un jour, je me réveille sur le quai, debout, sac au dos. On me dit qu’on a eu de la peine à me réveiller, là-bas, dans le bateau, mais que je me suis finalement levée, que j’ai pris mon sac et que j’ai suivi le groupe. Somnambulisme. J’ai des fourmis dans la main sur laquelle j’ai dormi. Il faut des preuves de ce qui arrive parfois. Nous nous lavons tous les quatre jours, tous les cinq jours. Le matin, les moniteurs découpent deux pains dans les grosses casseroles noires et donnent le signal du départ avant que la foule de boutonneux que nous formons ne se jette dessus. Nous achetons des cookies dans les kiosques des ports pour calmer la faim. Je porte toujours mon short en jeans très court, moulant, légèrement au-dessus de ma cicatrice de cigarette. À Paros, le moniteur italien me dessine de loin, sans que je le sache. Je suis assise en travers d’une chaise de toile, à l’ombre des pins. Il nous demande si nous avons déjà fait l’amour. À Athènes, il soigne mon insolation, qui me rapproche de l’idée de la mort. Nous sommes deux par lit dans un sous-sol couvert de blattes où il fait jour et nuit plus de 40 degrés sans air. Il pose des tissus de fraîcheur sur ma peau brûlante, tremblante. Je porte un soutien-gorge de petite fille. J’aurais de la peine à revivre aujourd’hui la scène sans y ajouter la dimension du désir, mais au fond peut-être que le désir y était déjà. En Grèce encore – mais sur quelle Cyclade, dans quelle fatigue heureuse ou insouciante ? – Vera et moi nous douchons nues et blondes dans un camping. Nous comparons les marques de notre bronzage, résultat surprenant d’un écran solaire indice 60. On commence peut-être à se trouver belles, on rit beaucoup. Il faut encore partager les couchettes des trains lors du retour en Suisse via l’Italie. Nous buvons de la tequila ainsi que l’ouzo rapporté pour les parents. À Milan, le groupe entasse les sacs dans un coin de la gare et part en quête de petit déjeuner. Vera et moi sommes laissées pour les surveiller. Nous nous allongeons les bras en croix sur la cinquantaine de sacs poussiéreux et chauds en songeant que nous sommes ivres de tout pour revenir à Genève et retrouver nos parents quelques heures plus tard. C’est peut-être ainsi que tout a commencé. À Genève, je me lave trois fois des pieds à la tête. Je me lamente sur ce sable grec qui s’en va pour de bon dans la conduite de douche suisse. Je mets une robe de coton rouge, je joue au ping-pong dans le demi-soleil d’une après-midi bourgeoise, je me trouve étrangement bien. Oui, c’est peut-être ainsi que l’envie de voyager est venue. Je lirai, bien des années plus tard : « Je n’avais jamais pensé qu’on pouvait être aussi heureux. C’est cet été boréal qui m’a fait comprendre que l’état nomade avait quelque chose à m’apprendre.» (Nicolas Bouvier). L’état nomade. Quelle douce antithèse quand même. Je n’ai aujourd’hui plus la moindre idée de ce qui m’a fait partir cet été-là, je ne serais pas en mesure de donner le plus petit début de raison. J’étais amoureuse pour la première fois cet été-là aussi. Je l’avais appelé de Brindisi, au retour, entre les heures que nous avions à tuer dans la ville et les toilettes immaculées du Mac Donald qui nous donnaient l’impression jouissive de retourner à la civilisation. La cabine téléphonique était rouge, très british. J’avais acheté une carte en lires italiennes. J’avais appelé plusieurs fois pour lui proposer un cinéma dès mon retour. Aussi parce que l’appel d’ailleurs veut toujours dire plus que le même appel envoyé du quotidien. Il ne répondait pas, il était en vacances. J’écrivais sur un minuscule calepin des sentiments nouveaux et pourtant tant de fois redits, tant de fois mal dits. C’est cet été-là que tout, vraiment, a commencé. Une année après ce serait l’Australie, deux ans plus tard encore le Canada, puis l’Italie, le Maroc, La Réunion, la Croatie, la Turquie, le Burkina Faso, l’Europe de l’Est, l’Inde, la Syrie. On ne sait pas très bien pour quoi on s’embarque quand on commence à voyager, mais comme dans un roman, tout est déjà là dès l’incipit. L’ignorance des causes qui nous gouvernent et la relativité de ces causes, la difficulté à partir et l’inexplicable attrait qui nous y pousse, la souffrance latente et la capacité décuplée au bonheur. Autant les souvenirs de mes quinze ans sont flous, autant je sais que tout était déjà là. Et que je ne me suis jamais demandé si j’avais regretté ce premier voyage.
II
C’est cela que je dois faire. Ce n’est pas me forcer à écrire des histoires cohérentes, bouclées, finies, sur des voyages que je ne vois plus de manière isolée. J’ai besoin de dire le travail de la mémoire, le bruit du vase qui se vide. C’est une question de santé d’esprit. Il faut dire pour une question de vie, pour laisser la place. Ce sentiment que j’ai eu très tôt – je me rappelle avoir écrit en rentrant d’Europe de l’Est que j’étais trop petite pour ce que je vivais – me revient aujourd’hui comme une nécessité, un appel à l’aide. J’étais dans une petite ville universitaire tchèque quand j’ai eu pour la première fois cette impression. Olomouc. Sur toutes mes cartes, sur mon atlas de poche soigneusement badigeonné d’itinéraires pas encore accomplis, rien ne passait par Olomouc et je n’avais même pas prévu d’y aller. Ce n’est qu’un Américain rencontré en Hongrie trois semaines plus tôt qui m’en avait parlé comme d’un paradis nomade. Il m’avait fait mirer une auberge de jeunesse tenue par deux routards australiens : « On veut y rester trois jours et on y reste trois semaines » avait-il dit. En arrivant sur place, j’avais trouvé quatre ou cinq Anglo-saxons affalés sur des canapés bleu gris – affalés parce qu’il n’y a pas d’autre terme pour rapprocher davantage l’activité humaine éveillée de la position horizontale. De grandes pièces aux parquets de bois. Un appartement qui laissait traverser la lumière. Des fenêtres blanches sur une rue silencieuse. Comme rien n’était bien grand dans cette ville, on atteignait facilement à pieds la gare, par où j’étais arrivée de Vienne. Est-ce dans cette ville que j’ai pour la première fois senti que tout cela en moi débordait ? Je sais que c’était dans un restaurant aux larges tables de bois sombres, aux murs bordeaux, dans une pièce allongée, pas très grande. Quelques habitués au bar, une table d’Américains, et moi, dînant seule face à la fenêtre, la vue sur une place où il faisait nuit. Le repas avait été délicieux. Je m’octroyais un verre de vin. J’écrivais. C’était dans un lieu où mon Lonely Planet ne pouvait plus m’apprendre grand-chose. Après Bedecker, Michelin, le Guide Bleu et le Routard, les guides Lonely Planet claironnent inlassablement et quelle que soit la destination : « Guide de survie : passeport, dollars et Lonely Planet ». J’aimerais bien voir un corps désincarné passer une journée dans le souk du vieux Delhi avec rien d’autre qu’un passeport, des dollars, et un Lonely Planet. Lonely Planet ou pas, on a chaud, c’est difficile, c’est gras. Ce ne sont pas tant les mouches, même en été, il fait bien trop chaud pour elles aussi à vrai dire. Un soir à Jaipur, la ville rose, nous marchions le long de la route pour aller dans un restaurant italien. Sur le toit d’un immeuble abandonné de douze étages, nous nous offrions pour le 1er août une vraie pizzeria. Il faisait déjà nuit et j’aimais ces instants où la marche du monde elle-même rendait plus difficile aux Indiens de nous identifier comme étrangères, blanches. Ils nous regardaient toujours de loin mais plissaient les yeux et ce n’est que tout proches de nous – c’est-à-dire trop tard pour élaborer un plan d’attaque de la touriste européenne – qu’ils nous reconnaissaient comme absentes. Ce soir-là pourtant, je n’avais pas très envie de marcher sur cette route. Je ne sais plus pourquoi. De ce bizarre malaise de voyage, physique mais de cause inconnue, aux symptômes peu profonds, qui suscite vite la paranoïa. Alors vite, vite, penser à autre chose. C’est ce que j’ai toujours fait. Un homme en moto s’est arrêté près de nous sur le bord gauche de la route. Il nous a demandé quelque chose et j’ai répondu « non » sans écouter. Il a tout de suite enchaîné : « Je ne comprends pas pourquoi les femmes européennes sont si froides avec les hommes de mon pays. » Il était scandalisé. J’avais envie de lui répondre qu’un homme de son pays était venu se masturber devant moi quelques jours auparavant. J’avais envie de lui cracher dessus peut-être, comme j’aurais pu cracher sur ce pauvre homme qui secouait son pénis au pied du Baby Taj pendant que je contemplais la rivière sacrée et son étrange beauté grise. Cracher sur les gens ? Il y a des moments où je ne sais plus très bien d’où viennent certains confins de moi-même. J’ai toujours su qui j’étais et je me demande s’il n’est pas facile, contrairement à ce que l’on pense, de ne se définir que par des nuances. Comment expliquer ce suspens heureux alors, quand un train ou un bus bloque toute la journée par le déplacement terrestre et la traversée de paysages inconnus ? Par la garantie que le moment sera clos sur lui-même peut-être, cernable, dicible. Je dois me dire au fond de moi que l’intégrité de l’instant est sauve, que je ne ferai, c’est certain, que rouler dans des paysages qui pourraient bien se passer de moi. C’est souvent un problème pour les gens qui voyagent avec moi. Dès que nous montons dans un bus, ma pensée cesse de leur répondre. Je me tais, regarde par la fenêtre. Qu’il fasse jour ou nuit, mon corps n’est plus qu’un paquet à l’arrêt, stable même s’il est douloureux, et mon esprit s’y base pour de longues dérivations. Je me rappelle avoir vécu dans ces bus des moments semblables à celui passé derrière mon verre de vin dans cette ville tchèque. Nous avons pris un bus de ce genre depuis Dharamsala jusqu’à Delhi. Les étoiles trouent la nuit de campagne. Les champs d’Inde du Nord sont d’une obscurité imparfaite. Les herbes sont plus hautes que les hommes. Les rares villages traversés tournent autour d’une épicerie toujours ouverte. Un petit vieux bedonnant dans un marcel blanc est assis devant, dans une chaise en plastique, sous une grosse lampe à néon où bourdonnent des insectes. Le bus tourne lentement dans cette chaleur nocturne et sage. On sent qu’on ne craint rien mais que le monde est ainsi et que le monde, en soi, est effrayant. La route surplombait des rivières plates que la lune rendait claires. Je pensais que j’allais être malade. En réalité, c’était une grosse boule de sanglots au fond de ma gorge qui n’arrivait pas à sortir. C’était d’une beauté terrassante, complète, comme on dit « je me suis endormie dans un monde complet » (Bouvier quelque part). C’était un bus de nuit, un bus dont le couloir central comprenait en parallèle des couchettes qu’il fallait occuper par groupe de deux. Helen était du côté du couloir, dans le sens inverse de la marche. J’étais contre le mur, dans le sens où le bus roulait. Le rideau voletait au-dessus de moi, laissant apparaître des étoiles trop blanches, vivantes. J’avais des peurs insensées, comme celle qu’une bête – grenouille ou phasme géant particulièrement vorace – m’arrive dessus, projeté à travers la fenêtre ouverte. De temps en temps c’était le cas des branches, qui rendaient la route étroite, et projetaient alors sur mon corps fiévreux et clair des petits morceaux de plantes inconnues. Le vent soulevait le rideau, que je tentais en vain de fermer car j’étais dans cet état somatique où tout le corps est opaque, chaud, mais couvert d’une sueur froide. Le vent me hérissait la chair. J’avais la bouche sèche mais je me concentrais pour ne pas avoir besoin d’aller aux toilettes pendant les douze heures que durerait notre trajet. J’ai à peine dormi cette nuit-là. Quand l’angoisse devenait trop forte et trop belle, je me redressais et regardais par la fenêtre oblongue les étoiles palpitantes au-dessus des champs clairs. C’était d’une beauté enivrante et cyclique, comme révélatrice d’une vérité du monde, d’une petite, toute petite parcelle des choses telles qu’elles sont. En arrivant à Delhi le matin, nous avons été réveillées en dernier et aussitôt jetées dehors. J’avais de la peine à boucler mes sandales, à bouger ma bouche sèche. Trois minutes après avoir ouvert les yeux, je me retrouvais debout dans la poussière bleue de l’aube de la capitale, sa pollution de brume douce, la chaleur à venir. Les conducteurs de rickshaws nous assaillaient de regards que nous ignorions. J’ai marché comme un zombie dans tout Paraganj. Entrée au Down Town Hotel comme à la maison, et écroulée sous le ventilateur de la première chambre venue tant que les pales brassaient encore un peu de nuit.